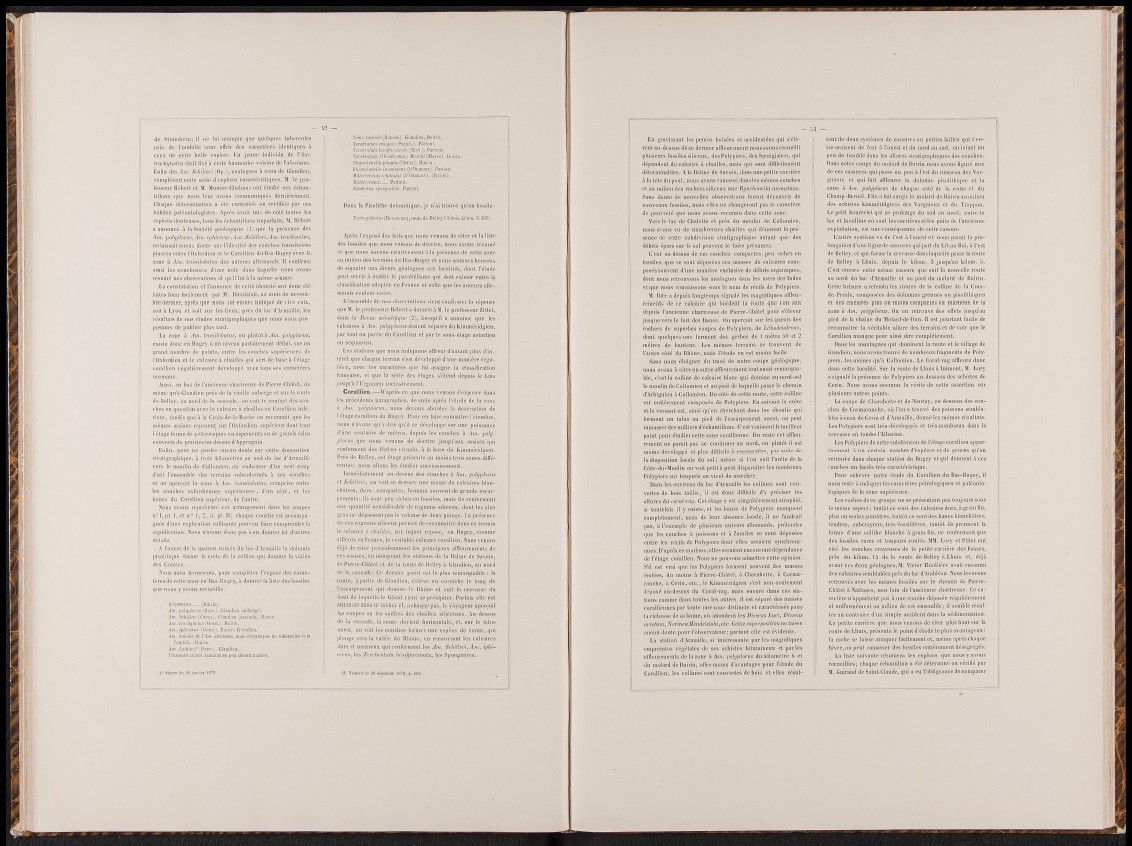
(le Slramlierii; il ne lui manque que quelques Uibercuies
près (le l'omhilic pour ollVir des caraclères idenliques à
cc.ux de ceLle belle espèce. Un Jeune individu de IVA?;?.
irtu'hynnlìis était (ixé à cel l e Animonite voisine de Vabscissu^.
liniin des Am. Sciti lier i (P\ì.), analogues ù c eux de Glandicu,
c o n i p l è t c n l celle série d'espèces caractéristiques. M. le prof
e s s e u r Ilébcrl et .M. Munier-Cliainias onl étudie ces éclianl
i l l o n s f[iie noiis leur avons communiques dernièrement.
Chaque détermination a été contrôlée ou rectiliée par ces
i i a h i l e s ])aléonlologislcs. A|)rès avoir mis de còle tontes les
e s p è c e s douteuses, Ions les éeliantillons imparfails, M. liéherl
a annoncé à la Sociét é géologique (lì que la présence des
Am. pohjphciis^Am. iphicerits, Ain. Schilleri, Am. Irachinolus,
n e laissai t aucun doute sur l'idenliîé des conches transitoires
p l a c é e s entre l'Oxfordien et le Corallien du I3as-Bugeyavec la
z o n e à .Am. iemiilohatns des auteurs allemands. 11 confirma
ainsi les conclusions iriine noie dans laquelle nous avons
r é s u m é nos observations et qu'il lul ù la m ême séance.
La constalat ion el l'annonce de cel t e identité ouï donc élé
f a i l e s bien facilement par M. Dieulafail, au moi s de novembre
dernier, après que nous lui eûmes indiqué de vive voix,
s o i l à Lyon et soit sur les lieux, près du lac d'Armaille, les
r é s u l t a t s de nos éludes slratigraphiques que nous nous pro
p o s i o n s de publier plus tard.
La zone à Ain. iemdlobalus, ou plutôt à//J J I . pohjplocus,
e x i s t e donc en Bugey à un niveau parfaitement défini, sur un
g r a n d nombre, de points, entre les couches supérieures de
l'Oxfordien et le calcaire à chailles qui sert de base à l'étage
c o r a l l i e n régulièreinenl développé avec tous ses caractères
n o r m a u x .
Ainsi, en bas de l'iincienne ciiartreuse de Pierre-Ciiàtei, de
même qu'à Glandicu près de la vieille auberge el sur la roule
de Belley, au nord de la cascade, on voit ie contact des couc
h e s en question avec le calcaire à chai l les ou Corallien infér
i e u r , tandis que à la Croix-dc-la-Roclie on reconnaît que les
mém-es assises reposent sur l'Oxfordien supérieur dont lout
r é l a g e forme de [litloresques escarpements ou de grands talus
c o u v e r t s de prairies au-des sus d'Appregnin.
EnOn, pour ne garder aucun doute sur celle disposition
s t r a t i g r a p h i q u e , à trois kilomètres au sud du lac d'Armaille
v e r s le moulin de Collomieu, on embrasse d'un seul coup
d'oeil l'ensemble des terrains subordonnés à ces couches
e l on aperçoit la zone à Ain. teauîlobaius, com]irise entre
l e s couches oxfordiennes supérieures, d'un côté, et les'
bancs du Corallien supérieur, de l'autre.
A'ous avons représenté cet arrangement dans les coujies
n" [, pl. 1, et n"' J, 2, 3, pl. II; chaque couche est accompag
n é e d'une exjilicaîion suffisante pour en faire comprendre la
s i g n i f i c a t i o n . Nous n'avons donc pas à e n donner ici d'autres
d é t a i l s .
A l'ouest de !a maison ruinée du lac d'Armailie !a dolomie
p i s o l i t i q u c forme la crête de la colline qui domine la valiéc
des Culates.
Nous nous bornerons, pour compléter l'exposé des caracl
è r e s d e c o t t e zone en Bas-13ugey, à donner la liste des fossiles
(]ue nous y avons recueillis :
Belemniies (Buiiiu).
Am. poljjplocus (ttEi.v.). Glandicu (auber^p).
Am. SckiUeri (OPPEI.). Glandieu (cascade), I3uini).
Am. tyacliynoUis (OPPEL). Buirin.
Am. ipliiceru.'! (OPPEI.). Buirin, Glnndieu.
/1m. voisine de VAm. abscissus, mais n'ayant pas de tubercules vers
l'orabili.-. Buirin.
Am. Loihari? {OPVEI). Glandicu.
Plusieurs autres Araraoniles peu déterminables.
(I) Séanc-! du 20 janvier 1S73.
Lima lamida (IloeuEn). Glaudieu, Buirin.
Tirebralula irisignls (ScnuD.). Pavloiit.
Terebralidn hisufj'ardniUa (ZIET.). Parloui.
Terebratnla fWnldhemiaJ .VA-SCW (MAYER). Buirin.
ñliyiirhoneUa pinguis (OPPIÏL). Buirin.
Rh'inchoiii'lla incoiislmis (D'ORBIGNY). Parioul.
MiLlmcrirnts echinaUíS (O'ORBIGNV), (Buirin).
Millèricrinus Partout.
¡Nombreux spongiaires. Parioul.
Dans la Pisolithe dolomitique, je n'ai trouvé qu'un fossile :
Turbo globaUis (BUVIGNIER),route de Bellpy ii Ltiuis, kilom. G.500.
Après l'exposé des faits que nous venons de citer et la liste
des fossiles que nous venons de décrire, nous avons résumé
c e que nous savons relativement ù l a présence de celle zone
a u mi l ieu des terrains du Bas-Bugey el nous somme s heureux
d e signaler aux divers géologues ces localités, dont l'étude
peut servir à établir le parallélisme qui doit exister entre la
c l a s s i f i c a l i o n adoptée en France et celle que les auteurs allemands
veulent créer.
L ' e n s e u î b l e de nos observations vient confirmer la réponse
que M. le professeur Hébert a donné e à .M. l e professeur Zillei,
dans la Revue scientifique (2), lorsqu'il a annoncé que les
c a l c a i r e s à .Im. pohjplocus étaient séparés du Kimméridgien,
par tout ou partie du Corallien et par le sous-étage astartien
o u séquiuiien.
Les stations que nous indiquons offrent d'autant plus d'int
é r ê t que chaque terrain s'est développé d'une manière régul
i è r e , avec les caractères que lui assigne la classification
f r a n ç a i s e , el que la série des étages s'étend depuis le Lias
j u s q u ' à l'Urgonien incUisivemeiit.
C o r a l l i e n . — D'après ce <[uc nous venons d'exposer dans
l e s précédents paragraphes, de suite après l'élude de la zone
à Am. pohjplocus^ nous devons aborder la descri[ilion de
l ' é t a g e coral l ien du lUigey. Pour en faire connai lre l'étendue,
n o u s n'avons qu'à dire qu'il se développe sur une puissance
d'une centaine de mètres, depuis les couches à .'\m. pohjplocus
que nous venons de décrire jusqu'aux- assises qin'
r e n f e r m e n t des Oslrea virgula, à la base du Kimméridgien.
Près de Belley, cet étage présente au moins trois zones dilTér
e n l e s ; nous allons les étudier successivement.
[ m m é d i a l e m e n t au-dessus des couches à ^bn. pohjplocus
c l Schilleri, on voit se dresser une masse de calcaires blanc
h â t r e s , durs, compactes, formant souvent de grands escar-
| ) c m e n t s ; Ils sont peu riches en fossiles, mais ils renferment
i n i e quanlilé considérable de rognons siliceux, dont les ])Ius
g r o s ne dépassent pas 1« v o l ume de deux poings. I.a présence
lie ces rognons siliceux permet de reconnaî tre dans ce terrain
le calcaire à chailles, sur lequel l'cpose, en Bugey, comme
a i l l e u r s en France, le véri tabl e calcaire corallien. Nous venons
déjà de citer précédemment les principaux affieurcmenls de
c e s assises, en indicjuant les stations de la Balme de Savoie,
de Pierre-Chàlcl el de la roule de Belley à Glandieu, au nord
d e la cascade. Ce dernier point est le plus remarquable: la
r o u l e , à partir de Glandieu, s'élève en corniche le long de
r c s c a r j ) e m c n t qui «lomine le lihone el suit la crevasse du
liant de laquelle le (¡land vient se précipiter, l'arfoîs elle est
c n l a i l l é e dans le rocher et, àchai iuc pas, le voyageur aperçoit
lo.s coupes ou les saillies des cliailles siliceuses. Au-dessus
d e ia cascade, la roule devient horizontale, cl, sur le talus
o u e s t , on voit les couches former une espèce de voûte, (|ui
p l o n g e vers la val lée du llhùne, en recouvrant les calcaircs
durs et marneux qui renferrnenl les Ani. Schilleri, Am. iphicerus,
les Terebrafula bisu¡larcinaUh les Spongiaires.
En gravissant les pentes boisées et accidentées qui s'élèv
e n t a u - d e s s u s d e c e dernier aflleurement nous avons recueilli
p l u s i e u r s fossiles s i l i c eux, des Polypiers, des Spongiaires, qui
d é p e n d e n t du calcaire à chailles, mais qui sont difficilement
d é l e r n i i n a b l e s . A la Balme de Savoie, dans une pel i l e carrière
à la tète du pont , nous avons ramassé dans l e s m ôme s couches
e t au milieu des rochers si l iceux une Bynchonella inconstans.
Sans doute de nouvelles observations feront découvrir de
n o u v e a u x fossiles, mai s elles n e changeront pas le caractère
d e pauvreté que nous avons reconnu dans celle zone.
Vers le lac de Chalette et près du moulin de Collomieu,
n o u s avons vu de nombreuses chailles (lui dénotent la prés
e n c e de cette subdivision stratigraphique autant que des
d é b r i s é|)ars sur le sol peuvent le faire présumer.
C'est au-dessus de ces couches compactes, peu riches en
f o s s i l e s , que se sont déposées ces masses de calcaires comp
o s é s souvent d'une manière exclusive de débris organiques,
dont nous retrouvons les analogues dans les mers des Indes
e t que nous connaissons sous le nom de récifs de Polypiers.
M. Hier a depui s longtemps signalé les magnifiques affieur
c m e n l s de ce calcaire qui bordent la route que l'on suit
d e p u i s l'ancienne chartreuse de Pierre-Chàlel pour s'élever
j u s q u e vers le fort des Bancs. 0]i aperçoit sur les parois des
r o c h e r s de superbes coupes de Polypiers, de Lilhodendrons,
dont quelques-uns forment des gerbes de 1 mètre 50 el 2
m è t r e s de hauteur. Les mêmes terrains se trouvent de
l'autre côté du Rhône, mais l'étude en est moins facile.
S a n s nous éloigner du tracé de notre coupe géologique,
n o u s avons à ci ter u n autre a f f l eur ement tout aus s i remarquable,
c'est la col l ine de calcaire blanc qui domine au nord-est
l e moul i n de Col lomieu et au pied de laquel l e passe le chemin
d'Avbignicu à Col lomieu. Du côt é de cette route, celle colline
e s t entièrement composée de Polypiers. En suivant la crête
e t le versant est, ainsi qu'en cherchant dans les éboulis qui
f o r m e n t un talus au pied de l'escarpement ouest, on peut
r a m a s s e r des mi l l iers d'échanti l lons. C'est v r a ime n t le mei l leur
p o i n t pour étudier cet t e zone corallienne. Du reste cet aifleur
e m e n t ne parait pas se continuer au nord, ou plutôt il est
m o i n s développé et plus difiicile à reconnaître, par suite de
la disposi t ion locale du sol; même si l'on suit l'arête de la
Côte-du-iWoulin on voi t petit à petit disparaître les nombreux
P o l y p i e r s sur lesquel s on vient de marcher.
Dans les environs du lac d'Armaille les collines sont couv
e r l e s de bois taillis, il est donc difficile d'y préciser les
a l l u r e s du coral-rag. Cet étage y est singul ièrement atrophié,
si toutefois il y existe, et les bancs de Polypiers manquent
c o m p l è t e m e n t ; mais de leur absence locale, il ne faudrait
pas, à l 'exempl e de plusieurs auteurs allemands, prétendre
que les couches à poissons el à Zamites se sont déposées
e n t r e les récifs de Polyi»iers dont elles seraienl synchroniq
u e s . D'après c e sys t ème , el les seraient encore une dépendance
d e l'étage corallien. Nous ne pouvons admettre cel l e opinion.
S'il est vrai que les Polypiers forment souvent des masses
i s o l é e s , du moins à Pierre-Chàtel, à Charaboltc, à Cormar
a n c h e , à Cerin, etc., le Kimméridgien s'est non-sculemcnl
d é p o s é au-dessus du Coral-rag, mais encore dans ces stat
i o n s comme dans toutes les autres, il est séparé des masses
c o r a l l i e n n e s ])ar toute une zone distincte cl caractérisée pour
lu r ichess e de sa faune, où abondent les Diceras Luci, Diceras
arietina, NerineaMendelslohi, cic. Celle super posi lioii ne laisse
aucun doute |)our l 'observateur; partout elle est évidente.
La station d'Armaille, si intéressante par les magnifiques
e m p r e i n t e s végétales de ses schistes bitumineux cl parles
a f f i c u r c m e n t s de la z one ù Am. poljplocus du kilomètre 6 et
d u molard de Buii'in, offre mo ins d'avantages pour l'étude du
C o r a l l i e n ; les collines sont couvertes de boi s et elles résult
e n t de deux systèmes de cassures ou petites failles qui s'en-
I r e - c r o i s e n t de l'est à l'ouest et du nord au sud, en jetant un
peu de trouble dans les allures stratigrapliiques des couches.
Dans notre coupe du molard de Buirin nous avons figuré une
de ces cassures qui passe un peu à l'est du ruisseau des Varg
n i c u x et qui fait afileurer la dolomie pisolithiquc et la
z o n e à Ain. pohjplocus de chaque côté de la route el du
C h a m p - B e r n c l . Elle a fait surgi r le molard de Buirin au milieu
des schistes kimméridgiens des Vargnîeux el du Trappon.
Le petit bourrelet qui se prolonge du sud au nord, entre le
l a c el la c o l l ine où sont les carrières e l l e s puits de l'ancienne
e x p l o i t a t i o n , est une conséquence de cel l e cassure.
L'autre système va de l'est à l 'ouest et nous paraît la prol
o n g a t i o n d'une l igne de cas sure s qui part du Lit-au-Roi, à l'est
d e Belley, et qui forme la crevas s e dans laquel l e passe la roui e
d e Belley à Lhuis, depuis le kilom. 3 jusqu'au kilom. 5.
C'est encore celle même cassure que suit la nouvelle roule
au nord du lac d'Armaille et au pied du molard de Buirin.
Cette brisure a refendu les strates de la colline de la Crasd
e - P r e s l e , composées des dolomîes grenues ou pisolilhiques
c l des calcaires plus ou moins compactes ou marneux de la
z o n e à .Am. pohjplocus. On en retrouve des effets jusqu'au
j)ied de la chaîne du Molard-de-Don. Il est pourtant facile de
r e c o n n a î t r e la véritable allure des terrains et de voir que le
Corallien manque pour ainsi dire complélenjent.
Dans les montagnes qui dominent la route et le vi l lage de
Glandieu, nous avons trouvé de nombreux fragment s de Poly-
])iers, les m ême s qu'à Collomieu. Le Coral-rag affleure donc
dans cette localité. Sur la roul e de Lhui s à Inimonl , ï\f. Lory
a s ignal é la présence de Polypiers au-dessous des schistes de
Cerin. Nous avons reconnu la vérité de celle assertion sur
p l u s i e u r s autres points.
La coupe de Charabolte el de Nantuy, en dessous des couc
h e s de Cormaranche, où l'on a trouvé des poissons semblab
l e s à c e u x de Cerin e l d'.\rmaillc, donne les même s résultats.
Les Polypiers sont très-développés et très-nombreux dans la
c r e v a s s e où tombe l'Albarine.
Les Polypiers de c c l l c subdivi s ion de l'étage coral l ien appart
i e n n e n t à un certain nombre d'espèces et de genres qu'on
r e t r o u v e dans chaque station du Bugey et qui donnent à ces
c o u c h e s un faciès très'caractérislique.
Pour achever notre élude du Corallien du Bas-Bugey, il
n o u s rest e à indique r les caractères pélralogîques et paléontol
o g i q u e s de la zone supérieure.
Les roches d e c e groupe ne se présentent pas toujours sous
l e môme aspect: tantôt c e sont des calcaires durs, à grain fin,
p l u s ou moins jaunâtres, tantôt c e sont des bancs blanchâtres,
t e n d r e s , subcrayeux, très-fossilifères, tantôt ils prennent la
forme d'une oolithe blanche à grain fin, ne renfermant que
des fossiles rares el toujours roulés. MM. Lory cl Pillet onl
c i t é les couches crayeuses de la petite carrière des Fosses,
près du kilom. 15 delà route de Belley à Lhuis et, déjà
avant ces deux géologues, M. Victor Thiol l ière avait reconnu
des calcaires semblables près du lac d'Ambléon. Nous les avons
r e t r o u v é s avec les mêmes fossiles sur le chemin de Pierre-
Chàlel àNatlages, non loin de l'ancienne chartreuse. Ce car
a c t è r e n'appartient pas à une couche déposée régulièrement
c l uni formément au milieu de cet ensemble; il sembl e résult
e r au contraire d'un simple accident dans la sédimentation.
La petite carrière que nous v enons de citer plus haut sur la
r o u t e de Lhuis, présente le point d'étude le plus avantageux :
la roche se laisse attaquer facilement el, même aprèschaquc
h i v e r , on peut ramasser des fossiles ent ièrement désagrégés.
La liste suivante résumera les espèces que nous y avons
r e c u e i l l i e s ; chaque échantillon a été déterminé ou vérifié par
M. Guirand de Saint-Claude, qui a e u l'obligeance de comparer