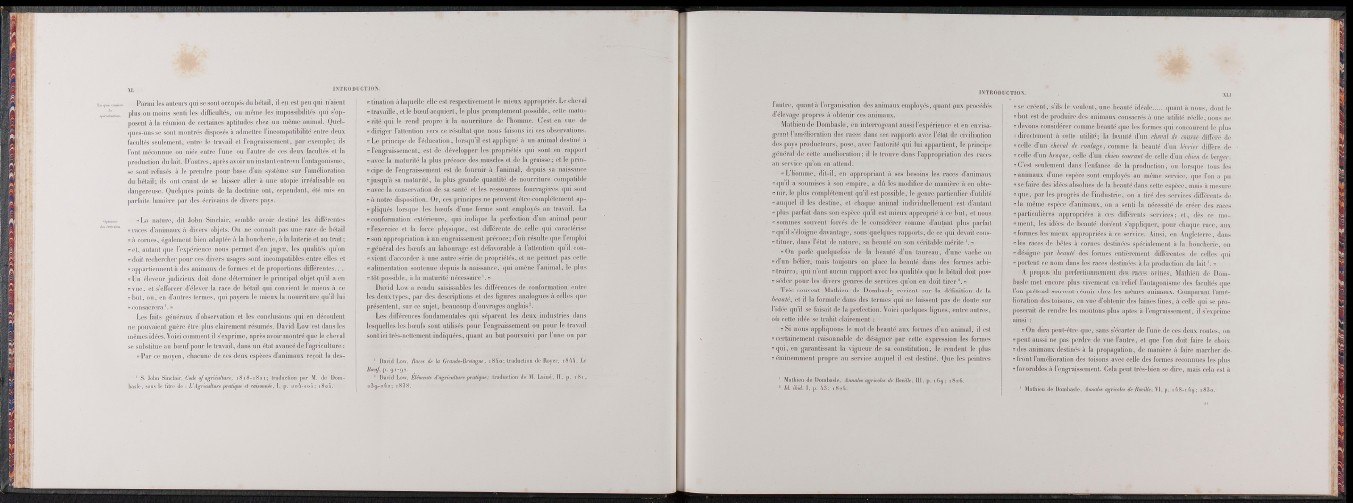
li
INÏKODlJCTlOiN.
l^iriiii k's ciiiUnii-s qui se sonf occiipds du hétiiil, il en est peu qui naienl
plus ou moins senli les fliiTiculi.és, ou mémo les impossibilités (jui sopposenl
<î la réuiiion de certaines aptitudes chez un môme uninuil. (}uel-
(|ues-uiisse soul nionlrés disposes à admettre l'inconipalibilité entre deux
facultés seulement, entre le travail et l'en^rraissement, par exemple; ils
l'ont méconnue on niée entre Tune ou l'autre de ces deux lacultés et la
pi'oduction dn lait. D'autres, apri'S avoir un instantentrevu Fanlag-onisme,
se sont reÎiisés à le prendre pour base d'un système sur ramélioralion
(lu hélail; ils ont craint de se laisser aller à une utopie irréalisable ou
daujvereuse. Quehpies points de la doctrine ont, cependant, été mis en
parfaite lumière par des écrivains de divers pays.
«La nature, dit John Sinclair, semble avoir destiné les dillerentes
traces (ranimaiix à divers objels. On ne connaît pas une race de bétail
t à cornes, également bien adaptée à la boucherie, à la laiterie el au trait;
«cl, aulani que rexpérience nous permet d'en juger, les qualités qu'on
«doit rechercher pour ces divers usages sont incompatibles entre elles et
ff a])partieunent à des animaux de formes el de proportions dilTérentes.. .
ffVii éleveur judicieux doit donc deterniinei- le principal objet qu'il a en
«•vue, et s'ellbrcer d'élever la race de bétail qui convient le mieux à ce
':bul, ou, en d'autres termes, qui payera le mieux la nourriture qu'il lui
ff consacnn-a '.-n
Les faits généraux d'observation el les conclusions qui en découlent
ne pouvaient guère être plus clairement résumés. David Low est dans les
mêmes idées. Voici conuiient il s'exprime, après avoir montré que le cheva
se substitue au boeuf pour le travail, dans un étal avancé de l'agriculture c
ce moyen, chacune de ces deux espèces d'animaux reçoit la des-
Ktinalion à laquelle elle est respectivement le mieux appropriée. Le cheval
retravaille,elle boenfacquiert, le plus promptement possible, cette nuituwrilé
qui le rend propre à la nourriture de l'homme. C'est en vue de
ff diriger l'altention vers ca résultat {[ue nous- faisons ici ces observations.
«Le principe de l'éducation, lors([u'it est appli(|ué à un animal destiné ii
ff l'engraissement, est <le développer les propriétéis (jui sont en rapport
rr avec la maturité la plus précoce des muscles et de la g'raisse ; el le priurfcipe
de l'engraissement est de fournir à l'animal, depuis sa naissance
cf jusqu'à sa maturité, la plus grande quantité de nourriture compatible
«avec la conservation de sa sanlé et les ressources fourragères ([ui sont
ffà notre disposition. Oi-, ces principes ne peuvent être complétenuini apfr])
liqués lorsque les boeufs d'une Ferme sont employés au travail. La
«conformation extérieure, (|ui indique la perfection d'un animal pour
ff l'exercice et la force physique, est dilTérente de celle qui carcictérise
« son appropriation à un engraissement précoce; d'où résulte (|ue l'emploi
«général des boeufs au labourage est défavorable à l'allention (pril. conf
vient d'accorder à une autre série de propriétés, et ne permet pas cette
«alimentation soutenue depuis la naissance, qui amène ranimai, le plus
" tôt possible, à la maturité nécessaire n
David Low a rendu saisissables les difl'érences de conformation (Mitre
les deux types, par des descriptions et des figures analogues à celles que
présentent, sur ce sujet, beaucoup d'ouvrages anglais-.
Les dilTérences fondamentales qui séparent les deux industries dans
esquelles les boeufs sont utilisés pour l'engraissemenl ou pour le travail
sonlici très-nettement indiquées, quant au butpoursuivi par l'uue ou par
INTRODUCTION.
1 autre, quanta l'organisation des animaux employés, quani {lux prociVh's
d'élevage propres k obtenir ces animaux.
Mathieu de Dombasle, en interrogeant aussi l'expérience et en envisageant
l'amélioration des races dans ses rapports avec l'état de civilisation
dos pays producteurs, pose, avec l'autorité ([ui lui appartient, le principe
général de cette amélioration; il le trouve dans rapproj)rial.ion des races
au ser\ice qu'on en attentl.
«L'homme, dit-il, en appropriant à ses besoins les races d'animaux
«qu'il a soumises à son empire, a du les modifier de manière à en ohte-
« nir, le plus complètement qu'il est possible, le genre particulier d'utilité
ffauipiel il les destine, el chaque animal individuellement est d'autant
«plus parlait dans son espèce ([u'il est mieux approprié à ce but, et nous
«sommes souvent forcés de le considérer comme d'aufant plus parfait
«qu'il s'éloigne davantage, sous quelques rapports, de ce (|ui devait cons-
« liluer, dans l'état de nature, sa beauté ou son véritable mérite w
«On parle quelquefois de la beauté d'un taureau, d'une vache ou
«d'un bélier, mais toujours on place la beauté dans des formes arbi- .
«traires, qui n'ont aucun rapport avec les qualités que le bétail doit pos-
«séder pour les divers genres de services (|u'on en doit tirer
Très-souvent Mathieu de Dombasle revient sur la délinition de la
beauté^ et il la formule dans des termes qui ne laissent pas de doute sur
l'idée qu'il se faisait de la perfection. Voici quelques lignes, entre autres,
où cette i(l(^e se trahit clairement :
«Si nous appliquons le mol de beauté aux formes d'un animal, il est
«certainement raisonnable de désigner par cette expression les formes
«qui, en garantissant la vigueur de sa constitution, le rendent le plus
«éminemment propre au service auquel il est destiné. Que les peintres
' MiUhieu de Do m baste, Ânmies (i(rncoles de Roville. III. p. i6ç); 189 G.
Id. ibid. I, p. 189^1.
«se créent, s'ils le veulent, une beaul,é idéale (pianl à nous, dont le
«but est de |)roduire des animaux consacrés à une utilil,é réelle, nous ne
«devons considérer comme beauté <p]e les formes qui con(;ourent le plus
«directement à cette utilité; la beauté d'un cheval de. counc diffère de
«celle d'un cheval île roulafre, comme ht beauté'd'un lévrier diilère de
«celle d'un braque, celle d'un chien covrant de celle d'un .chien de bei:(rer.
«C'est seulement dans l'enfance de la production, ou lorsque tous les
«animaux d'une espèce sont employés au même service, (jne Ton a pu
«se laire des idées absolues de la beauté dans cette espèce, mais à mesure
«que, par les progrès de l'induslrie, ou a tiré des services diilerents de
«la même espèce d'animaux, on a senli la nécessité de créer des races
«particulières approprii'ses à ces diiîerents services;.et, di's ce nio-
«nu'nt, les idées de b(iau(,é doivent s'appliquer, pour chaque race, aux
«formes les mieux appropriées à ce service. Ainsi, en Angleterre, dans
«les races de -bêtes à cornes destinées spécialement à la boucherie, on
«fl'ésigne par heauté des formes entièrement diiTérentes de celles ¡pii
« portent ce nom dans les rac(is destinées à hi production dn lait n
A propos du perfectionnement des races ovines, Mathieu de Dombasle
met encore plus vivement en relief l'antagonisme des facultés ([ue
l'on prétend souvent réunir chez les mêmes animaux. Comparant l'ami^-
lioration des toisons, en vue d'obtenir des laines fines, à celle qui se proposerait
de rendre les moul.ons plus aptes à l'engraissement, il s'exprime
ainsi :
«On dira pent-ètre (pie, sans s'écarter de l'une de ces deux routes, on
«peut aussi ne pas perdre de vue l'antre, et que l'on doit faire le choix
«des animaux destinés à la propagation, de manière à faire marcher de-
«front l'amélioration des toisons avec celle des formes reconnues les plus
«favorables à l'engraissement. Cela peut très-bien se dire, mais cela est à
' M a 111 i eu fie Doml)asle, Ayinalcs a^rncoles de Boville, VI, p. i'18-1/19; i83o.