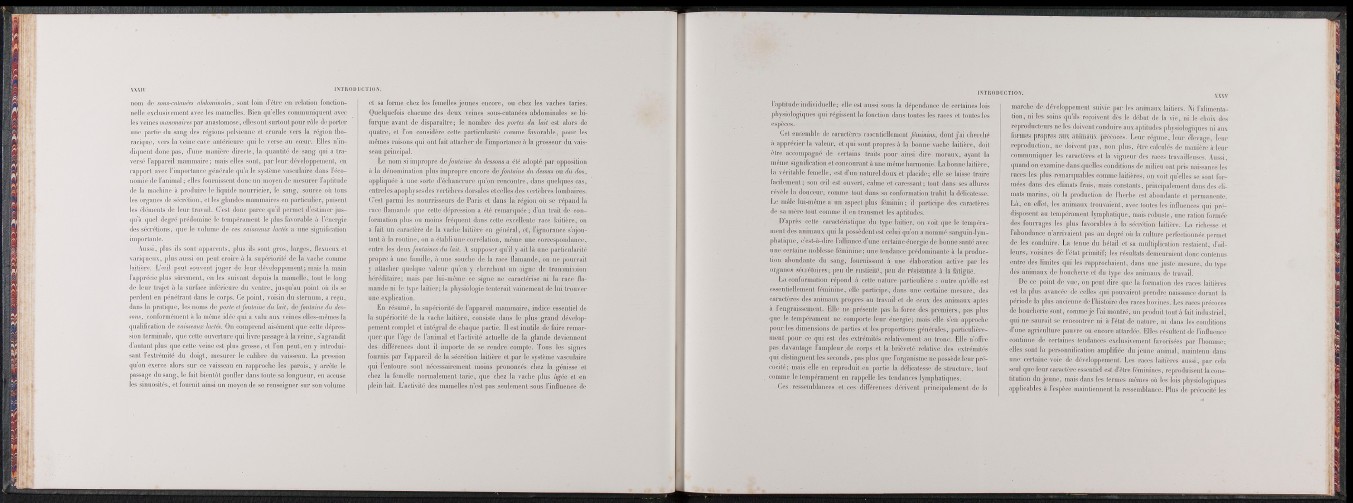
'M
n::
J «
SXMV ISTl lOUUC
iioni sotiS'i:iilaiii!e.i alnlomiualea, sont loin (rèlre cii i-i'lalion i'oncLioniiolli>
cxfhisivi'nicnl, avec los mamelles. Bien qu'elles connniinilinent aïec
les veines niiimmairefi par anastomose, el lesont surtout pour rôle de porter
u n e partie du san{>- (les réj^ions |)elvieuiie et crurale vers la ré^rion tlioraciipi.
e, vers la veine cave antérieure i[ui le verso au coeur. Elles n'ui-
( l i t | u e iU donc pas, (l'une niauière directe, la (punitité de sang- (]ui a trav
e r s é Fappareil mamnuiirc; niais elles sont, par leur développement, en
ra])port avec rinipoiiance générale ipi'a le syslème vasculaire dans Fécon
o m i e de l'animal ; elles Iburnisseut donc un moyen de mesurer l'aptitude
d e la machine à p rodui r e le liipiide nourricier, le saujj-, source où tous
les orjj-aues de sécrét ion, et les glandes mannnai res en particulier, puisent
les éléments de leur travail. C'est donc parce (]u'il permel d'estimer jus-
( p u i (|uel degré prédomine le tempérament le plus favoralile à l'éncrjTie
d e s sécrét ions. (|ue le volume de ces vaisseaux lactés a une signilication
i n i p o r l a n t e .
\ n s s i , plus ils sont apparents, plus ils sont gros, larges, Ilexueux et
v a r i ( p i e u x , plus aussi on peut croire à la supériorité de la vache comme
l a i t i è r e . L'oeil peut souvent juger de leur développement; mais la main
l ' a p p r é c i e plus sirrement, en les suivant depuis la mamelle, tout le long
d e leur li-ajet à la surface inférieure du venire, justpi'au point où ils se
p e i ' d e n t en pénétrant dans le corps. Ce point , voisin du s ternum, a reçu,
dans In prati([ue, les noms de porlf et fontaine- du lait, de fontaine (ht dessous,
conformément à la même idée (|ni a A a l u aux veines elles-mêmes la
( p i a l i l i c a l i o n de vaisseaux laetés. On comprend aisément (|ue cette dépress
i o n terminale, (jue cette ouverture (jui l ivre p a s s age à la veine, s'agrandit
d ' a u t a n t plus cjue cette veine est plus grosse, et l'on peut, en y introduis
a n t l'extrémité du doigt, mesurer le calibre du vaisseau. La pression
( j u ' o n exerce alors sur ce vaisseau en rapproche les parois, y arrête le
p a s s a g e du s ang, le fait l)ientôt gonfler dans toute sa longueur , en accuse
les sinuosités, et fournit ainsi u n moyeu de se renseigner sur son volume
e t sa forme chez les femelles j eune s encore, ou chez les vaches taries.
( Q u e l q u e f o i s chacune des deux veines sous-cutanées abdominales se bil
' u r ( [ u e avant de disparaître; le nombre des portes du lait est alors de
( ¡ u a t r e , et l'on considère cette particularité comme favorable, pour les
m ê m e s raisons qui ont fait a t tacher de l'importance à la gi'osseur du vaiss
e a u principal.
L e nom si imp r o p r e de fontaine du dessoaa a été adopt é par opposition
à la dénominat ion plus impropr e encore de fontaine da dessus on du dos,
a p p l i q u é e à une sorte d'échanceure qu'on rencontre, dans (¡uel(|lies cas,
e n t r e l e s apophysesdes "\ e r t è l j r e s dor sales et cel les des ver tèbres lombaires.
C'est parmi les nourrisseurs de Paris et dans la région où se répand la
r a c e l lamande que cette dépressiou a été remar(piée ; d 'un trait de couf
o r m a t i o n plus ou moins fréquent dans cette excellente race laitière, on
a fait un caractère de la vache laitière en général, et, l'ignorance s'ajont
a n t à la rout ine, on a établi u n e corrélation, même une correspondance,
e n t r e les deux fontaines du lait. .V s u p p o s e r ipi'il y ait là une |)articularité
J i r o p r e à une famille, à une souche de la race llinnando, on ne pourrait
y attacher {|uelque valeur qu'en y cherchant un signe de transmission
h é r é d i t a i r e ; mais par lui-même ce signe ne caractérise ni la race flam
a n d e ni le type laitier; la physiologie tenterait vainement de lui trouver
u n e explication.
E n résumé, la supér ior i t é de l'appareil mammai re, indice essentiel de
l a supériorité de la vaclie laitière, consiste dans le plus grand développ
e m e n t complet et intégral de chaque partie. Il est inut i l e de faire remar-
( p i e r que l'âge de l'animal et l'activité actuelle do la glande deviennent
d e s diflérences dont il importe de se rendre compte. Tous les signes
f o u r n i s par l'appareil de la sécrétion laitière et par le système vasculaire
q u i l'entoure sont nécessaii-ement inoins prononcés chez la génisse et
c h e z la femelle normalement taiàe, que chez la vache plus âgée et en
p l e i n lait. L'activité des mamelles n'est pas seulement sous rinllueucc de
INTBODUCTIOiX,
l ' a p t i t u d e individuel le; elle est aussi sous la dépendance de certaines lois
p l l j ' s i o l o g i i p i e s (|ui régissent la fonction dans toutes les l'aees et toutes les
e s p è c e s .
Cet ensembl e de caractères essentiellement féminins, dont j'ai cherché
il apjiréciin- la valeur, et (pii sont pi'opres à la bonne vache laitière, doit
ê t r e accompagné de certains traits pour ainsi dire moraux, ayant la
m ê m e signification et concour ant à une même harmonie. La b o n n e laitière,
la véritable lemelle, est d'un natui-el doux et placide; elle se laisse traire
l a c i l e m e n t ; son oeil est ouvert, calme et caressant ; tout dans ses allures
r é v è l e la douceur, conmic tout dans sa conforiuation trahit la délicatesse.
Le mâle lui-même a un aspect plus féminin; il participe des caractères
d e sa mère tout comme il en transmet les aptitudes.
D ' a p r è s cette caractéristique du type laitier, on voit (pie le tempéraj
n e n t des animaux (|ui la possèdent est celui qu'on a n ommé sanguin-lyml
l h a t i q u e , c'èst-à~dlre l'alliance d 'une certaine énergi e de bonne sant é avec
u n e certaine noblesse féminine; une tendance p rédominant e à la product
i on abondante du sang, fournissant à une élaboration active par les
o r g a n e s sécrétoires; peu de rusticité, peu de résistance à la fatigue.
La conlormation répond à cette nature particulière ; out re qu'elle est
e s s e n t i e l l e m e n t féminine, elle participe, dans une certaine mesure, des
c a r a c t è r e s des animaux propres au travail et de ceux des animaux aptes
à l'engraissement. Elle ne préseule pas la force des jiremiers, pas plus
( | n e le tempérament ne compoi'te leur énergie; mais elle s'en approche
p o u r les d imens ions de parties et les p ropor t ions générales, parliculièrement
pour ce qui est des extrémités relativement au tronc. Elle n'oH're
p a s davantage l'ampleur .de corps et la brièveté relative des extrémités
(|ui distinguent les seconds, pas plus que l'organisme n e pos sède l eur préc
o c i t é ; mais elle en reproduit en partie la délicalesse de structure, tout
c o m m e le tempérament en rappelle les tendances lynipliatiqnes.
• C e s ressemblances et ces diirérences dérivent principalement de la
n i a r e h o de développement snii ie piu- les animaux laitiers. .M l'alimentat
i o n , ni les soins (pi'ils reçoivent di'S le début de la vie, ni le choix des
r e p r o d u c l e n r s ne les doivent conduire aux aptitudes physiologiques ni aux
l o r i n e s propres aux animaux précoces. Lenc régime, leur élevage, leur
r e p r o d u c t i o n , ne doivent pas, non plus, être calculés de manière à leur
c o m m u n i q u e r les caractères et la vigueur des races travailleuses. Aussi,
( j u a n d on examine dans quel les condilions de milieu ont pris naissance les
r a c e s les plus remarquables comme laitières, on \-oit ([u'elles se sont foim
é e s dans des climats b-ais, mais constants, principalement dans desclim
a l s mar ins, où la product ion de l'Iierbe est abondant e et permanente.
L à , en elTet, les animaux trouvaient, avec toutes los influences qui préd
i s p o s e n t au tempérament Ijinpbaliqne, mais robuste, ime i-ation IbruM'e
d e s fourrages les plus favorables à la sécrétion laitière. La richesse et
l ' a b o n d a n c e n'arrivaient pas au degré oii la eidtnre perfectionnée permet
d e les conduire. La tenue du bétail et sa nudtiplicatlon restaient, d'aill
e u r s , voisines dé l'état primitif; les résultats demeuraient donc contenus
e n t r e des limites (|ui les rapprochaient, dans une juste mesure, du typi;
d e s animaux de boucherie et du type des aniniaiix de travail.
De ce point de vue, ou peut dire (|ue la formation des races laitières
e s l la plus avancée de celles (pii pouvaient prendre naissance diu-ant la
p é r i o d e la plus ancienne de l'histoire des races bovines. Les races précoces
d e boucherie sont, comme j e l'ai mont r é , un produit tout à fait industriel,
q u i ne saurait se rencontrer ni à l'état de nature, ni dans les condilions
d ' u n e agriculture pauvre on encore attardée. Elles résultent (le l'influence
c o n t i n u e de certaines tendances exclnsi\enient favorisées par l'homme;
e l l e s sont la personnification ampliliée du jeune animal, maintenu dans
u n e certaine voie de (lévelo|)peinent. Les races laitières aussi, par cela
.s.eul que leur caractèi' c essentiel est d'être féminines, reproduisent la con.st
i t u t i o n (bi j e u n e , mais dans les termes mêmes où les lois physiologiques
a p p l i c a b l e s à l'espèce maintiennent la resseniblancc. Plus de précocité les