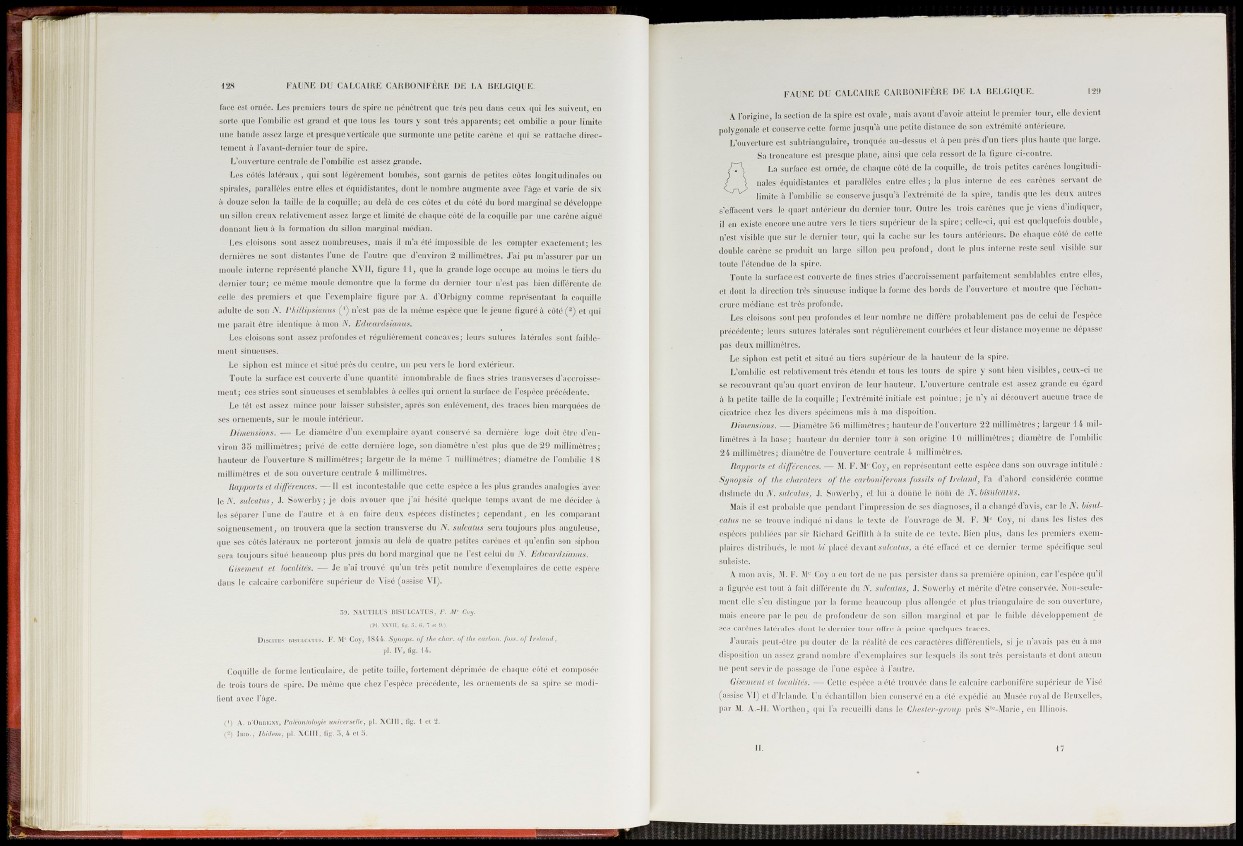
i 28 FALNE DU CAIXAIRIi CARBOMFÈRE DE LA ÜELGLQUE,
FAUNE DU CALCAIRE CAI IBONIFÈRE DE LA BELÍ Í IQIE. 1-29
l'ace est ornée. Les premiers tours de spire ne pénèlrcnl que très peu clans ceux ([ui les suivent, en
sorle ipie l'ombilic est gr and et que tous les tours y sont très appa r ent s ; eel ombilic a pour limite
une bande assez lai-ge et presque verticale que surmonte une petite carène et qui se rattache directement
à r avant -de rni e r lour de spire.
L'ouverture centrale de l'ombilic est assez gr ande .
Los côtés l a t é r aux, ([ui sont légèrement bombés, sont garnis de pelites côtes longitudinales ou
spirales, parallèles entre elles et équidistantes, dont le nombre augment e avec l'âge et varie de six
à douze selon la taille de la coquille; au delà de ces côtcs et du côté du bord marginal se développe
un sillon creux relativement assez lai'ge et limité de chaque côté de la coquille pai- une carène aigué
donnant lieu ù la formation du sillon marginal médian.
Les cloisons sont assez nombreuses , mais il m'a été impossible de les compter exa c t ement ; les
dernières ne sont distantes l'une de l'autre que d'environ 2 millimètres. J'ai pu m'assurer par un
moule interne représenté [)lanche XVIJ, figure 11, que la gr ande loge occupe au moins le tiers du
dernier torn-; ce même moule démontre que la l'orme du dernier lour n'est pas bien dilTéreute de
celle des premiers et ipie Texemplaire figuré par A. d'Orbigny comme représentant la coquille
ailulte de son A". ¡'hiUipskimis ( ' ) n'est pas de la même espèce que le j eune liguré à côte ( - ) et qui
me parait être identique à mon A". Edwanhianus.
Les cloisons sont assez [irofondcs et régulièrement concaves; leurs sutures latérales sont faiblement
sinueuses.
Le siphon est mince et situé près du centre, un peu vers le bord extérieur.
Toute la surface est couverte d'une quantité innombrable de fines stries transverses d'accroissement
; ces stries sont sinueuses et semblables à celles qui ornent la surface de l'espèce précédente.
Le tel est assez mince pour laisser subsister, après son enlèvement, des traces bien ma rqué es de
ses ornements, sur le moule intérieur.
Dimensions. — Le diamètre d'un exemplaire ayant conservé sa dernière loge doit être d'environ
33 millimètres; privé de cette dernière loge, son diamètre n'est plus que de 2î) millimètres;
hauteur de l'ouverture 8 millimètres ; largeur de la même 7 millimètres ; diamètre de l'ombilic 18
millimètres el de son ouverture centrale h millimètres.
liupporls et (li/férences. — Il est incontestable que cette espèce a les plus grandes analogies avec
leA". sulcaius, .1. Sowe r b y ; je dois avouer que j'ai hésité quelque temps avant de me décider à
les séparer Tune de l'autre et à en faire deux espèces distinctes; c ependant , en les comparant
soigneusement, on trouvera que la section transverse du N. sulcalus sera toujours plus anguleuse,
(|ue ses côtés latéraux ne porteront j ama i s au delà de quatre petites carènes et ([u'enfin son siphon
sera toujours silué beaucoup plus prés du bord marginal ([ue ne l'est celui du A. Edwardsianns.
Gisement el localités. — Je n'ai trouvé qu'un très petit nomlire d'excni[)laircs de cette espéce
dans le (!alcaire carbonifère supérieur de Visé (assise VI).
r>9. NAUTI LIS lilSl LCATl'S, F. M' Cuy.
(i'I. XXVII, fig. 3, C, 1 ei SI.)
Discites kisi lcati's. V. vr Coy, \Ui. Sj/nops. of ihe clutr. of lliu rurOon. foss. ofirchnul,
pi. IV, iig. 1/,..
Coquille de forme lenticulaire, de petite taille, fortement déprimée de chaque coté et composée
de trois tours de spire. De incme que chez l'espèce précédente, les ornements de sa spire se modilienl
avec Tàge.
(1) A. D'OiiniGNV, l'uléonlologu-tinicersclle, pl. XClll, lig. 1 el '2.
(2) iiMii., miMn, pl. XCIII, ô, 4 Cl 5.
A Forigine, la section de la spire est ovale, mais avant d'avoir atteint le premier tour, elle devient
polygonale et conserve cette forme jusqu'à une petite distance de son extrémité antérieure.
L'ouverture est sui)triangula!re, tronquée au-dessus et à ¡leu près d'un tiers plus haute que large.
Sa troncature est presque plane, ainsi que cela ressort de la figure ci-contre.
La surface est ornée, de chaque côté de la coquille, de trois petites carènes longitudinales
équidistantes et parallèles entre elles ; la plus interne de ces carènes servant de
limite à l'ombilic se conserve jusqu'à l'extrémité de la spire, tandis (pie les deux autres
s'effacent vers le quart antérieur du dernier tour. Outre les trois carènes que j e viens d'indiquer,
il en existe encore une aut r e vers le tiers supérieur de la spi r e ; celle-ci, qui est quelquefois doubl e ,
n'est visible que sur le dernier tour, qui la cache sur les tours antérieurs. De chaque côté de cette
double carène se produit un large sillon peu profond, dont le plus interne reste seul visible sur
loute l'étendue de la spire.
Toute la surface est couverte de fines stries d'accroissement parfaitement seml)lables entre elles,
et dont la direction très sinueuse indique la forme des bords de l'ouverture et mont re que l'échancrure
médiane est très profonde.
Les cloisons sont peu profondes et leur nombr e ne dilïère probablement pas de celui de l'espèce
précédente; leurs sutures latérales sont régulièrement eoui'bées et leur distance moyenne ne dépasse
pas deux milliniètres.
Le siphon est petit et situé au tiers supérieur de la h a u t e u r de la spire.
L'oml)ilic est relativement très étendu et tous les tours de spire y sont bien visibles, ceux-ci ne
se recouvrant qu'au quart environ de leur hauteur. L'ouvertui'e centrale est assez gr ande eu égard
à la petite taille de la coquille; l'extrémité initiale est pointue ; j e n'y ai découvert aucune trace de
cicatrice chez les divers spécimens mis à ma dispoition.
Dimensions. — Diamètre 3G millimètres; haut eur de l'ouverture 2 2 millimètres ; largeur -14 millimètres
à la ba s e ; haut eur du dernier tour à son origine 10 millimètres; diamètre de l'ombilic
24 millimètres; diamètre de l'ouverture centrale A- millimetres.
Rapports el différences. — M. F, .M'' Coy, en représentant celte espèce dans son ouvrage intitulé :
Synopsis of lite chara (ers of the carboniferous fossils of Ireland, l ' a d ' a b o r d c o n s i d é r é e c o n r m e
distincte du N. sulcatus, J. Sowe rby, et lui a donné le nom de lY. Oisulcatuif.
Mais il est pi'ol)ablc que pendant l'impression de ses diagnoses, il a changé d'avis, car le l\. hisulcatus
ne se trouve indiqué ni dans le texte de l'ouvrage de M. F. .M'' Coy, ni dans les listes des
espèces publiées par sir Richard Grillitli à la suite de ce texte. Rien plus, dans les premiers exemplaires
distribués, le mol bi place ikv ml s idea lus, a été efi'acé et ce dernier terme spécifique seul
subsiste.
A mon avis, M. F. >1'' Coy a eu tort de ne pas persister dans sa première opinion, car l'espèce qu'il
a figijrée est toiil à fait différente du A', sulcatus, J. Sowerby et mérite d'être conservée. Non-seulement
elle s'en distingue ¡¡ar la forme beaucoup plus allongée et plus triangulaire de son ouverture,
mais encore par le peu de profondeur de son sillon marginal et par le faible développement cle
ses carènes latérales dont le dernier tour offre à peine quelques traces.
•l'aurais peut-être pu douter de la réalité de ces caractères différentiels, si je n'avais pas eu à ma
disposition un assez grand nombre d'excmi)laircs sur lesquels ils sont très persistants et dont aucun
ne peut servir (le passage de l'une espèce à l'autre.
(Useiiient et tocalilés. — Celte espèce a été trouvée dans le calcaire carbonifère supérieur de Visé
(assise VI) et d'Irlande. Un échantillon bien conservé en a élé ex|)édié au .Musée royal de Bruxelles,
par M. A.-ll. Wor the i i , (|ui l'a recueilli dans le Cheslcr-yroup près S''-'-Marie, en Illinois.