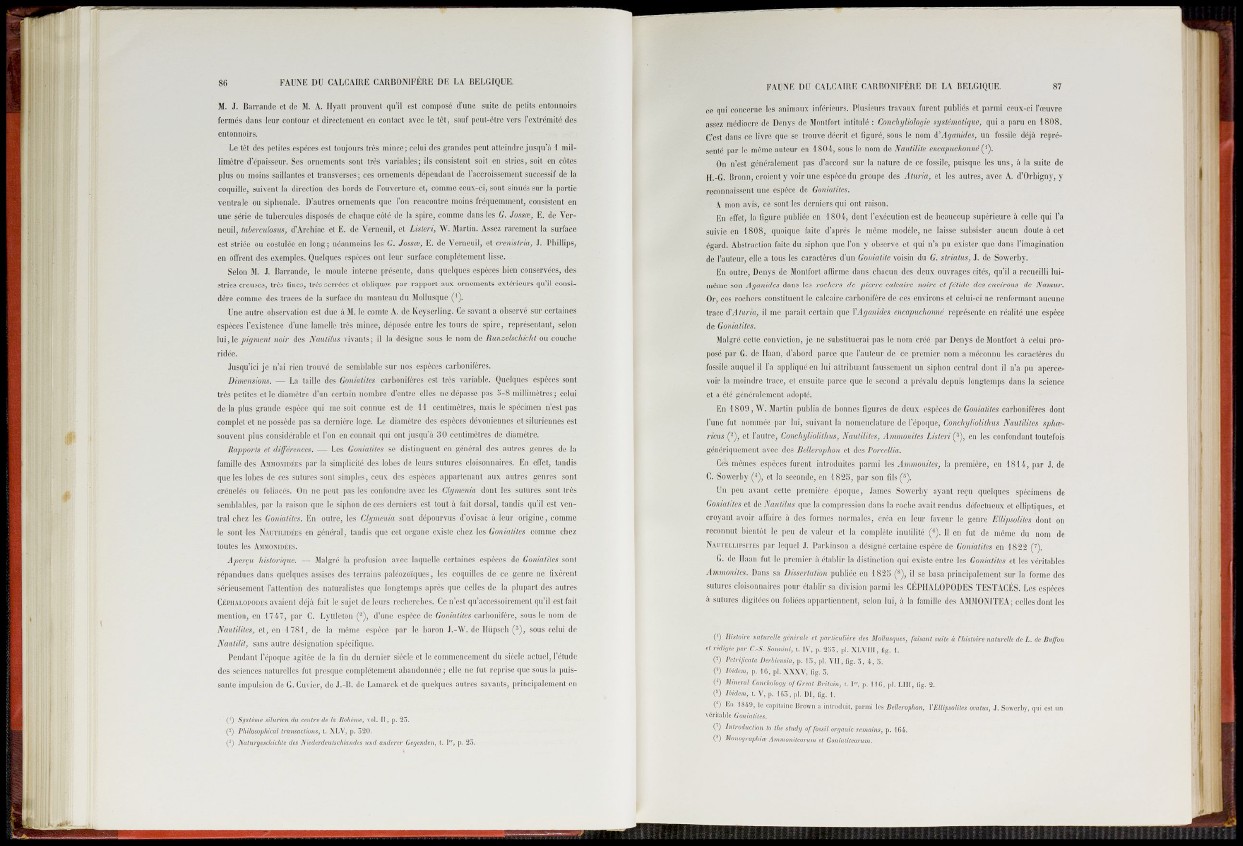
86 F A U N E DU C A L C A I R E C A R B O N I F È R E DE LA B E L G I Q U E .
F A U N E NU C A L C - M R E C A R B O N I F È R E DE LA B E L G I Q U E . 87
ï i i
31. J. Ba r r ande et de M. A. Ilyall prouvent qu'il est composé d'une suite de petits entonnoirs
fermés dans leur contour el directement en contact avec le t é t , sauf peut-être vers l'extrémité des
enionnoirs.
Le tôt des petites espèces csl toujours très minc e ; celui des grandes peut atteindre jusqu' à i millimétré
d'épaisseur. Ses ornements sont très variables; ils consistent soit en stries, soit en cotes
plus ou moins saillantes et transverses; ces ornements dépendant de l'accroissement successif de la
coquille, suivent la direction des bords de l'ouverture et, comme ceux-ci, sont sinués sur la partie
ventrale ou siphonale. D'autres ornements que l'on rencontre moins f r équemment, consistent en
une série de tubercules disposés de chaque coté de la spire, comme dans les G. Jossa-, E. de Verneuil,
fuberculosiis, d'Archiac et E. de Verneuil, et iisleri, W. Martin. Assez r a r ement la surface
est striée ou costulée en long; néanmoins les G. Jossoe, E. de Verneuil, el crenistria, J. Phillips,
en oiïrenl des exemples. Quelques espèces ont leur surface complètement lisse.
Selon M. J. fiarrande, le moule interne présente, dans quelques espèces bien conservées, des
stries creuses, très fines, très serrées et obliques par rapport aux ornements extérieurs qu'il considère
comme des traces de la surface du manteau du Mollusque (i).
Une autre observation est due à M. le comte A. de Keyserling. Ce savant a observé sur certaines
espèces l'existence d'une lamelle très mince, déposée entre les tours de spi r e , représentant, selon
lui, le pigment noir des Nautilus vivant s ; il la désigne sous le nom de Runzelschichl ou couche
ridée.
Jusqu'ici je n'ai rien trouvé de semblable sur nos espèces carbonifères.
Dimensions. — La taille des Gonialiles carbonifères est très variable. Quelques espèces sont
très petites et le diamètre d'un certain nombre d'outre elles ne dépasse pas S - 8 millimètres; celui
d e l à plus grande espèce qui me soit connue est de 11 centimètres, mais le spécimen n'est pas
complet et ne possède pas sa dernière loge. Le diamètre des espèces dévoniennes et siluriennes est
souvent plus considérable el l'on en connail qui ont jusqu' à 30 centimètres de diamètre.
Rapports et ililfèrences. — Les Gonialiles se distinguent en général des autres genres de la
famille des Ammo.nidées par la simplicité des lobes de leurs sutures cloisonnaires. En eiïet, tandis
que les lobes de ces sutures sont simples, ceux des espèces appartenant aux autres genres sont
crénelés ou foliacés. Ou ne peut pas les confondre avec les Clymenia dont les sutures sont très
semblables, par la raison que le siplion de ces derniers est tout à fait dorsal, tandis qu'il est ventral
chez les Gouialites. En outre, les Clymenia sont dépourvus d'ovisac à leur or igine , comme
le sont les >'.iOTiLmÉKS en général, tandis que cet organe existe chez les Goniatites comme chez
toutes les Ammonidées.
Aperçu historique. — Malgré la profusion avec laquelle certaines espèces de Gonialiles sont
répandues dans quelques assises des terrains pnléozoïques, les coquilles de ce genre ne fixerenl
sérieusement l'attention des naturalistes qne longtemps après que celles de la plupart des autres
Céphalopodes avaient déjà fait le sujet de leurs recherches. Ce n'est qu'accessoirement qu'il est fait
mention, en I 7 i T , par C. Lyttleton (2), d'une espèce de Gonialiles carbonifère, sous le nom de
NaïUilites, e t , en 1 7 8 1 , de la même espèce par le baron .l.-W. de llupsch (5), sous celui de
Nautilit, sans autre désignation spécifique.
Pendant l'époque agitée de la fin du dernier siècle et le commenc ement du siècle actuel, l'étude
des sciences naturelles l'ut presque complètement abandonnée ; elle ne fut reprise que sous la ])uissante
impulsion de G. Cuvier, de J.-B. de Lama r ck cl de quelques autres savants, principalement on
(') Système silurien du centre de la Bohême, \ol. Ii, p, 25.
(S) Philosophical transactions, t. XI.\', p. 520.
yuturgeschiditc des Niederdculsdtlandes ^índ anderer Gegenden, i. 1", p- 25.
ce qui concerne les animaux inférieurs. Plusieurs travaux furent publiés et parmi ceux-ci l'oeuvre
assez médiocre de Denys de Monlfort intitule : Conchyliologie systématiqxie, qui a paru en 1 8 0 8 .
C'est dans ce livre que se trouve décrit el figuré, sous le nom A'Aganides, un fossile déjà représenté
par le même auteur en 1 8 0 4 , sous le nom de Nautilile encapuchonné
On n'est généralement pas d'accord sur la nature de ce fossile, puisque les u n s , à la suite de
ll.-G. Bronn, croient y voir une espècedu groupe des Aluria, et les autres, avec A. d'Orbigny, y
reconnaissent une espèce de Gonialiles.
A mon avis, ce sonl les derniers qui ont raison.
En effet, la figure publiée en 1 8 0 4 , dont l'exéculion est de beaucoup supérieure à celle qui l'a
suivie en 1 8 0 8 , quoique faite d'après le jnème modèle, ne laisse subsister aucim doute à cet
égard. Abstraction faite du siphon que l'on y observe et qui n'a pu exister que dans l'imagination
de l'auteur, elle a tous les caractères d'un Goniatite voisin du G. slriatus, J. de Sowerby.
En oulre, Denys de Montforl adi rmc dans chacun des deux ouvrages cités, qu'il a recueilli luimême
son Aganides dans les rochers de pierre calcaire noire et fétide des environs de Namur.
Or, ces rochers conslituent le calcaire carbonifère de ces environs et celui-ci ne r enf e rmant aucune
trace d'Aluria, il me parait certain que ['Aganides encapuchonné représente en réalité une espèce
de Gonialiles.
Malgré celte conviction, je ne substituerai pas le nom créé par Denys de Montforl à celui proposé
par G. de Ilaan, d'abord parce que l'auteur de ce premier nom a méconnu les caractères du
fossile auquel il l'a appliqué en lui attribuant faussement un siphon central dont il n'a pu apercevoir
la moindre trace, et ensuite parce que le second a prévalu depuis longtemps dans la science
et a été généralement adopté.
En 1 8 0 9 , W. Martin publia de bonnes figures de deux espèces de Goniatites carbonifères dont
l'une fui nommée par lui, suivant la nomenclature de l'époque, Conchtjliolithus NauliUies sphoericus
(-), et l'autre, Conchyltolilhus, Naulilites, Ammonites ÎJslerii^), en les confondant toutefois
génériquement avec des Beikrophon cl des Porcellia.
Ces mêmes espèces furent inlroduiles parmi Ammonites, la pi'emière, en 181'5., par J. de
C. Sowe rby (<), et la seconde, en 1 8 2 8 , par son fils (=).
Un peu avant celle première époque , James Sowe rby ayant reçu quelques spécimens de
Goniatites et de NautHus que la compression dans la roche avait rendus défectueux et elliptiques, et
croyant avoir alTaire à des formes normales, créa en leur faveur le genre Ellipsolites dont on
reconnut bientôt le peu de valeur et la complète inutilité C^). Il eu fui de même du nom de
N,vuTi:LLiPsrTEs par lequel .1. Parkinson a désigné certaine espèce de Goniatites en 1 8 2 2 ( ' ) .
G. de Haan fut le premier à établir la distinction qui existe entre les Goniatites et les véritables
Ammonites. Dans sa Dissertation publiée en 182i) («), il se basa principalement sur la forme des
sutures cloisonnaires \)am établir sa division parmi les CÉPHALOPODES TESTACÈS. Les espèces
à sutin'es digitécs ou foliées appartiennent, scion lui, à la famille des AMMONITEA: celles donl les
C) Histoire naturelle rjé7térak et particvliére dos Mollusqws, faisant suite à l'hisloire naturelle de L. de
et rédi'jce par C.-S. Sonnini, I. IV, p, pl. Xl.VIII, iig. 1.
H Petrifícala Derbiensia, |). iîj, pl. VU, iig. 3, i ,
e ) lOidcm, p, 16, pl. XXXV, iig.3.
(<) Hlimral Conchology of Great Briiain, I. I", p, I1G, pl. LUI, fig. 2.
(») Ibidem, i. V, p. lC5,pl. Dl.lig. I.
C) lîii 184-9, le eopitainc Brown a ialroduil, parmi les Bdlcrophon, VEilipsoiiles ovatus, J. Sowerby, qui
\ériiatilc Gonialiles.
C) Inlrodticlicn to Ihe study of fossil organic retnains, p. 164.
(') Monographioe A7nmonileoiiim et Goniatileorim.