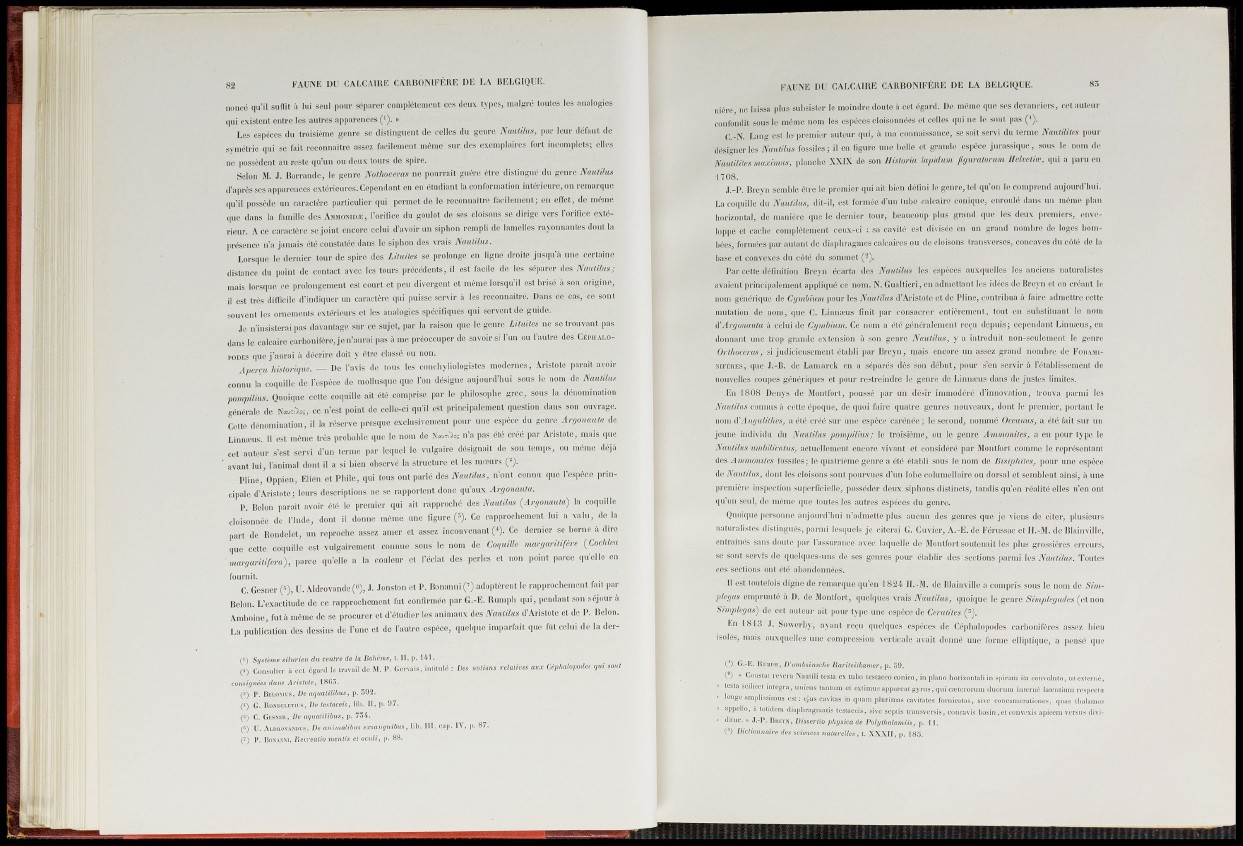
82 FAUNE DU CAÍXAIRE CARBONIFÈRE DE BELGIQUE
noncó qu'il suíTíl à lui seul pour séparer compicleineiU ces deux lypes, ma lgr é toutes los mialogies
qui existent cui r e les autres appa r enc e s ( ' ) . »
Les espèces du troisième genr e se tlislinguent de celles du genr e Naiilihis, par leur dé f aut de
symétrie c|ui se fail re conna î t re assez facilement même sur des exemplaire s fori incomplets; elles
ne possèdent au reste (pi'un ou deux lours de spire.
Selon M. J. Ba r r a n d e , le g e n r e Noihoceras ne pour r a it guère élre distingué du genr e Nautilus
d'après ses appa r enc e s extérieures. Cependant en eu étudiant la conformation inlérieurc, on r ema r q u e
qu^il possède un caractère parliculier qui pe rme t de le r e conna î t re f a c i l ement ; en e f f e t , de même
t[uc dans la famille des kmi o ^wM, rorilice du goulot de ses cloisons se dirige ve r s l'orifice extérieur.
A ce c a r a c t è r e se joinl encore celui d'avoir un siphon rempli de lamelles r ayonnant e s dont la
présence n'a j ama i s été constatée dans le siphon des vrais Naulilus.
Lorsque le de rni e r lour de spire des Limites se prolonge en ligne droite jusqu' à u ne cerlaine
distance du point de c o n t a d avec los tours précédents, il esl facile de les séparer des Naïui/us;
mais lorsque ce prolongemenl est courl el peu divergent et même lorsqu'il est brisé à son or igine ,
il esl très difficile d'indiquer un caractère qui puisse servir à les reconnaître. Dans ce cas, ce sont
souvent les ornement s extérieurs et les analogies spécifiques qui servent de guide .
Je n'insisterai pas davantage sur ce suj e t , par la raison que le genr e Litaitcs ne se t rouvant pas
dans le calcaire carbonifère, j e n ' a u r a i pas à me préoccuper de savoir si l'un ou l'autre des Cép>iai.o^
PODES que j^un-ai à décrire doit y être classé ou non.
Aperçu historique. — De Favis de lous les conchyliologistes mo d e r n e s , Aristote parait avoir
connu la coquille de l'espèce de mollusque que l'on désigne a u j o u r d 'h u i sous le nom de Nautilus
pompilius. Quoique celte coquille ail été comprise par le philosophe g r e c , sous la déuoniinalion
générale de RWJ . ; , ce n'est point de celle-ci qu'il est principalement question dans son ouvrage,
a u c dénomina t ion, il la r é se rve pr e sque exclusivement pour u ne espèce du genr e Arffomula de
Linna'us. Il est même très probable que le nom de n'a pas été créé par Arislole, ma i s que
cet aut eur s'est servi d'un t e rme par lequel le vulgaire désignait de son t emp s , ou môme déjà
• avant lui , l'animal dont il a si bien ol)servé la s t ruc tur e el les moeu r s
Pline, Oppi en, Elien et Phi l e , qui tous ont parlé des Nautilus, n'ont connu que l'espèce p r i n -
cipale d'Arislote; leurs descriptions ne se r appor l ent donc qu' aux Argonauta.
P. Belon parait avoir été le pr emi e r qui ait r approché des Nautilus (Arçjomuta) la coquille
cloisonnée de l ' Inde, dont il donne même u ne figure Ce r approchement Ini a v a l u , d e l à
pari de Ronde l e t , un r eproche assez ame r et assez inconvenant Ce de rni e r se b o r n e à dire
que celte coquille est vulga i r ement c o n n u e sous le n om de Coquille marffarUifére {Cochlea
margaritifera), parce qu'elle a la couleur et l'éclat des perles et non point parce (¡u'elle en
fournit.
C. Gesner (5), U. Aldrovande(«) , J. Jonslon et P. Bonanni (") adoptèrent le r a p p r o c h eme nt fait par
Belon. L'exaclitude de ce r approchement fui conf i rmée par G.-E. Rnmp h qui , pendant son s é j o u r à
Amboine, fut à même de se procur e r et d'étudier les animaux des Naulilus d'Aristote et de P. Belon.
La publication des dessins de Tune et de l'autre espèce, quelque impa r f a i t que fût celui de la de r -
(i) Sxjslème siUirioidn centre de la Bohème, (. li, p. t 4 l .
(i) Consulter à cei égard le travail de M. P. Gênais, iiililulc : Des notioi
muignées dans Arislole, 1865.
(=) V. BF.LO>iii;s, De aqualilibus, p. 392.
C) G. Rondkletiis, De lestaceis, 111). II, p- 97.
(5) C. Gesnbr, De aqualilibus, p. 754.
(C) II. Alduovandus, De onmalibus exsangiiibns, lib. III, cai). IV, p. 87.
{') P. Oo.NASM, ]\ecreaUo mentis el ocxdi, p. 88.
eliUives anx Céphalopodes qui sont
FAUNE DU CALCAIRE CARBONIFÈRE DE LA BELGIQUE. 85
nièrc, ne laissa plus sul)sisler le moindr e doute à cet égard. Do même que ses devanciers, cel aut eur
conCondil sous le même nom les espèces cloisonnées et celles qui ne le sont pas ( ' ) .
C.-N. Lang esl le premie r autour qui, à ma connaissance, se soil servi du lerme NaïUililes pour
désigner les Naulilus fossiles; il en figure u n e belle et g r a n d e espèce j u r a s s i q u e , sous le nom de
Naiitilitesmaximus, planche XXIX de son Î/isloria lapidum fxjuratorum lielvelioe, qui a paru en
•1708.
J.-P. Bixn n semble être le pr emi e r qui ait bien défini le genr e , tel qu'on le compr end aujourd'hui .
La coquille du Nautilus, dit-il, esl formée d'un tube calcaire conique, enroulé dans un môme plan
horizontal, de manière que le de rni e r tour, beaucoup plus gr and que les deux premiers, env(!-
loppe et cache compiètement ceux-ci : sa cavité est divisée en un gr and nondj r e de loges b ombées,
formées par autant de di aphr agme s calcaires ou de cloisons transverses, concaves du coté de la
hase et convexes du côté du sommet ( - ).
Par cette définition Breyn écarla des Naiitiliis les espèces auxcpielles les anciens naturalistes
avaient principalement ai)pliqué ce nom. N. Gualtieri, en adme t l anl les idées de Br eyn el en créant le
nom générique de Cymbium pour les Naulilus d'Arislote et de Pline, contribua à faire adme l l r e cette
mutalion de n om, que C. Linnoeus finit par cons a c r er enl i è r emenl , lonl en substituant le nom
({''Arf/07iuula à celui de Cymbium. Ce nom a été généralement reçu depui s ; cependant Linna?us, en
donnant une trop gr ande extension à son genre Naulilus, y a introduit non- s eul ement le genr e
Orthoceras, si judi c i eus ement établi pa r Br e y n , mais encore un assez gr and n omb r e de Foua.mi-
MFÉRES, que J.-B. de Lama r c k en a séparés dès son d é b u t , pour s'en servir à l'établissement de
nouvelles coupes génériques et pour r e s t r e indre le genr e de Linnaîus dans de jus l e s limites.
En 1 8 0 8 Donys de 3Iontforl, poussé pai- un désir immodé r é d' innova t ion, trouva parmi les
Naulilus connus à celle époque, de quoi faire qua t r e genr e s nouveau.^, dont le pr emi e r , portant le
nom iVAiiffulilhes, a été créé sur une espèce caréné e ; le second, n ommé Occanus, a été fait sur un
jeune individu du Naulilus pompilius; le troisième, ou le g e n r e Ammonites, a eu pour type le
Nautilus umbilicatus, acluellement encore vivant et considéré pa r Jîontforl comme le r epr é s ent anl
des Ammonites fossiles; le (luatrième genr e a élé élabli sous le nom de Bisiphites, pour une espèce
Ai^. Nautilus, donl les cloisons sont pourvues d'un lobe cohimellaire ou dorsal et s embl ent ainsi, à une
première inspection superficielle, posséder deux siphons distincts, tandis qu'en réalité elles n'en ont
qu'un seul, de même que toutes les autres espèces du genre.
Quoi(|ue j)ersonne aujourd'iiui n'admelte plus aucun des genres que je viens de ciler, plusieurs
naturalistes distingués, parmi lesquels j e citerai G. Cuviei', A.-E. de Férussac el II.-M. de Blainville,
enlrainés sans doute pa r l'assurance avec laquelle de Monlfort soutenait les plus grossières erreurs,
se sont servis de quelques -uns de ses genr e s pour établir des sections i>armi les Naulilus. Toutes
ces sections onl été abandonnées.
Il esl loulefois digiie de r ema r q u e qu'en 182/i. 11. -31. de Blainville a compr i s sous le nom de Simpleyas
emprunt é à D. de .Montlbrl, quelques vrais Nautilus, quoique le genr e Simplegades (et non
Simpkfjas) de cel auteur ait pour t\|)e une espèce de Ceratiles
En 1 8 1 3 J. Sowe rby, a y a n l reçu quelques espèces de Céphalopodes carbonifères assez bien
isolés, mais auxquelles une compression verticale avait donné une forme elliptique, a pensé que
ilulo,(Hexlei'nù
leiitium rcspccti
C) G.-E. Uiiini, D'amljoinsche Rarileilkamer, p. oO.
« Coiisiai rcYcra Xauiili losia ex tubo lestacco conico, in piano horizonlali in spiram il
testa scilicctinicgra, unieus tantum et cxtiimis apparcat gynis, (¡ni coeterorum Juoruin im
longe iimplissimus cst:cjus cavitas in qiiam plurimas ca\ilalcs fornicatas, sive coucamerationes, quos tlial
appello, à totidcm diaphragmatis tcstaeois, sive scptis transversis, concavis basin.ei convoxis apiecm versus
(litur. » J.-P. Brrvn, Disserlio pkysica de Volylhalamiis, p. H.
Diclionnaire des scieiices naturelles, t. XXXII, p. 18o.