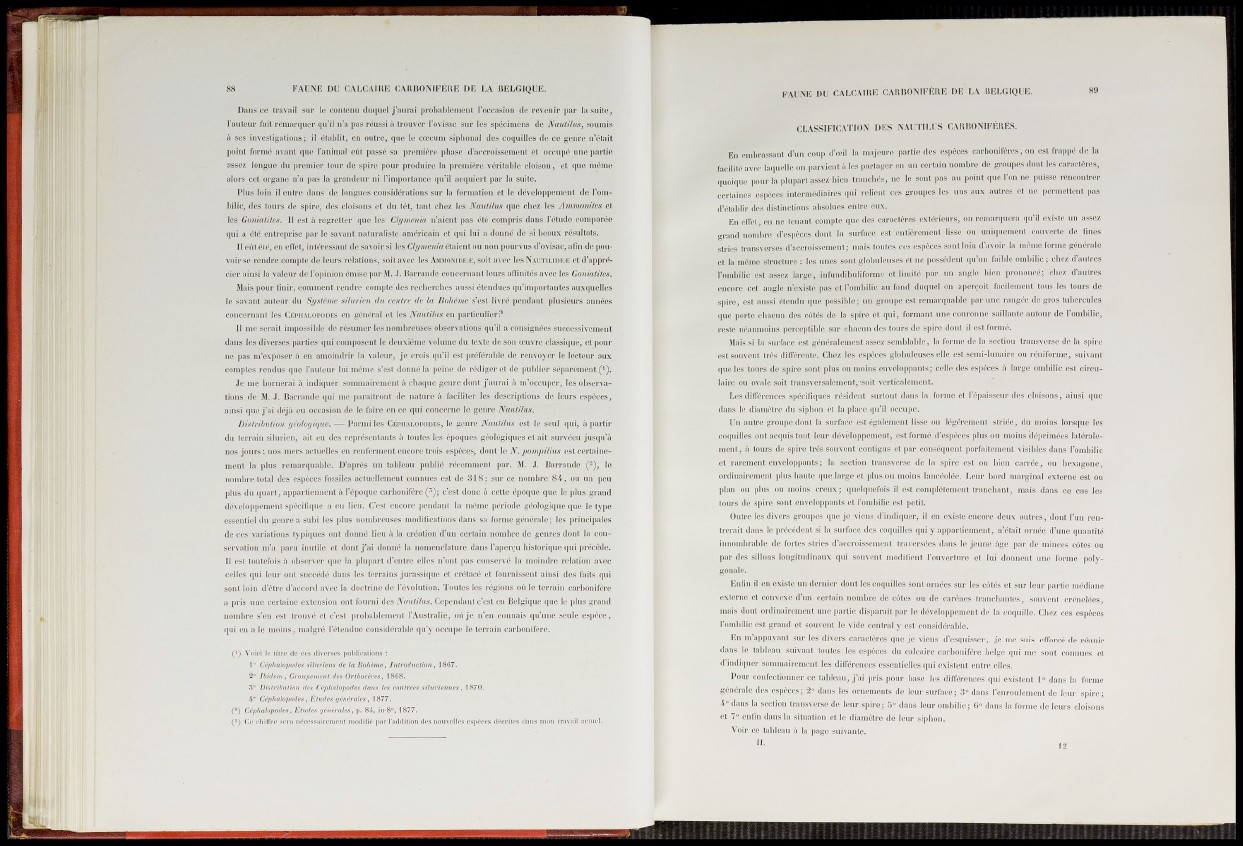
88 FAUNE DU CALCAI IOE CAHBOiMFÉKE DE LA BELGIQUE.
D;ins ce Ij'avail s u r le conl enu duque l j ' a u r a i probitJdenieiU l'occasion de r e v e n i r pa r la siiile,
l'aulenr fail reniarciuor <|u'il n'a pas réussi à t r o u v e r i'ovisac sur les s p é c ime n s de Nautilus, soumi s
à SOS inve s t iga l ions ; il élal)lil, en o u t r e , (pie le eoec um siplional de s coquilles de ce g e n r e n'élait
point f o rmé avant <pie l'aDima! oùl passé sa ju'cmiere pliuse d'aecroissenienl et oc cupé u n e pa r t i e
assez longue du pi'emier lour de spire pour p r o d u i r e la p r emi è r e vé r i l abl e c lo i so n , et ((ue même
alors cet organe n'a pas la g r a n d e u r ni r ini | )or l anc e qu'il a cqui e r t pa r la suile.
Plus loin il e n t r e dans de longue s cons idé r a t ions sur la forma t ion et le déve loppemenl de l 'ombilic,
de s lour s de spire, des cloisons et du ièt, lanl che z les Nmililits que che z les Anmoniles cl
les Goniuiilcs. 11 est à r e g r e l l e r (pie les Clymcnia n' a i ent pa s été compr i s dans l ' é tude c omp a r é e
qui a été ent r epr i s e pa r le s avant na(uraliste amé r i c a in et qui lui a d o n n é de si b e aux résultats.
Il e i i l é i é , en ellet, intéressant de savoir si les C/ywe« /« étaient ou non p o u r v u s d'ovisac, afin de pouvoir
se l'endre compt e de l eur s relations , soit avec les A.mmomde.ic, soit aNcc les Naut i l ide ^ e et d' appr é -
cier ainsi la v a l e u r de l'opinion émise ¡larM. J. Ba r r an d e c o n c e r n a n t leurs aiTlnilés avec les Goinaiifcs.
Mais p o u r linir, c omme n t r e n d r e compt e des r e c h e r c h e s aussi é t endue s q u ' imp o r t a n t e s auxque l l e s
le s avant a u t e u r du Si/stème sUunen du centre de la Bohème s'est livré p e n d a n t plus i eurs an n é e s
concernant les Céphai.opoues en géné r a l et les Nautilus en pa r t i cul i e r p
Il me serait impossible de r é s ume r les n omb r e u s e s obs e rva t ions (pi'il a consignée s suc c e s s ivement
dans les dive r s e s parties qui compos en t le d e u x i ème v o h u n e du texte de son oeu v r e classique, et pour
ne pas m' expos e r à en amoind r i r la valeuj-, je ci-ois qu'il est pr é f é r abl e de r e n v o y e r le lecteur a u x
comptes r e n d u s que l'auteu)' lui même s'est d o n n é la pe ine de r édige r et de p u b l i e r s é p a r éme n t ( ' ) .
J e me bo rn e r a i à i n d i q u e r sommaii-ement à c h a q u e g e n r e dont j ' a u r a i à m' o c c u p e r , les o b s e r v a -
tions de 31. J. Ba r r a n d e qui me pa r a î t ront de n a t u r e à faciliter les de s c r ipt ions de leurs e spè c e s ,
ainsi que j'ai dé j à eu occasion de le f ai re en ce qui co n c e r n e le g e n r e Nautilus.
Dis/riùution (jèoloijique. — P a r m i l e s C é p i i a l o i > o d f : s , le g e n i ' e Nautiluíí e s t le s e u l q u i , à p a r t i r
du te r r ain silurien, ait eu de s r ep r é s en t an t s à toutes les époque s géologique s et ail survé cu j u s q u ' à
nos j o u r s ; nos me r s actuelles en r e n f e r n i e nt encor e trois espèces, dont le N. pompilius est c e r t a ine -
ment la plus r ema n p i a b l e . D' a p r è s un tal)Ieau publ i é r é c emme n t pa r . >1. J. Ba r r a n d e ( - ) , le
nombi'e total des espèces fossiles a c tue l l ement connue s est de 3 1 8 ; s u r ce nom!)re 8 4 , ou un pe u
plus du q u a r t , ai )pa r l iennenl à l'époque c a rboni f è r e (5); c'est donc à cette époqu e q u e le plus g r a n d
développement spécilique a eu lieu. C'est encor e pendant la même pé r iode géologi(|ue q u e le type
essentiel )hi g e n r e a subi les plus n omb r e u s e s modifications dans sa l'orme g é n é r a l e ; les pr inc ipa l e s
de c e s va r i a t ions tyi)i((ues ont d o n n é lieu à la création d'un cer tain n omb r e de g e n r e s dont la c o n -
servation m' a pa ru inutile et dont j'ai d o n n é la n ome n c l a t u r e dans l ' ape r çu hi s tor ique qui précède.
11 est toutefois à obs e rve r que la p lu p a r t d' ent r e elles n'ont pa s cons e rvé la mo i n d r e relation avec
celles qui leur ont suc c ède dans les t e r r a ins j u r a s s i q u e el crétacé et foui'iiissenl ainsi de s faits ipii
sont loin d' è l r e d'accord avec la doc t r ine de l'évolution. To u t e s les r égions où le t e r r a in c a rboni f è r e
a pris u n e c e r t a ine extension ont fourni de s Naiilihis. Cep en d ant c'est en Be lgique que le plus g r a n d
nombre s'en est t rouvé et c'est p r o b a b l eme n t l 'Aus t r a l i e , où j e n' en conna i s q u ' u n e seule e s p è c e ,
(pii en a le mo i n s , ma l g r é l ' é t endue cons idé r abl e q u ' y oc cupe le ter r ain c a rboni f è r e .
(1) Voici le litre de ces diverses putiticalions :
1° Ccp/ialùpodes siluriens de la Bohème, Inlroduction
Ibidem . Groitpemen! des Orthocères. ISOS.
Dislribulioii clos Céphalopodes datis les conirées silt
Céphulopodes, fUndes générales, 1 8 7 7 .
(2) Céphalopodes. Elndc>> (jénéralos, p. 84-, i n - 8% 1 8 7 7 .
( ' ) C.c chiiTrp ?crn iiécessiiirenient niocliiié pnr l'addilion des
18G7
1870,
spèees iléci'i
FAUNE n u CALCAÏKK CAI ÎBO.MFÈRE DE LV l îKLOIQUE. S9
CLASSIFICATION DES NALTILUS CAKBOMEÈl lES.
En emiirassani, d'un coup d'oeil la ma j e u r e partie de s espèces c a r b o n i f è r e s , on est frappé de la
lacilité avec laquelle on parvient à les pa r t age r eu un ceUain n omb r e de g r o u p e s dont les caractères ,
(pioique pour la plupart assez bien t r a n c h é s , ne le sont pa s au point que l'on ne puisse r e n c o n t r e r
certaines espèces inl e rmédi a i r e s qui relient ces groupe s les u n s a u x aut r e s el ne pe rme t t en l pas
d'établir des distinctions absolues ent r e e u x .
En e l î e i , en ne t enant compt e que de s car actèr e s exIérieui'S, ou r ema r q u e r a (pi'il existe un assez
-rrand n omb r e d'espèces dont la sur f a c e est enl i è r emen! lisse on uni<piement couve r te de fines
.stries trunsverse s d' a c c roi s s ement ; mais toutes c e s espèces .sont loin d'avoir ia même forme géné r a l e
et la mèn^e s t ruc tur e : les une s sont globul eus e s cl ne po.ssèdent qu'un faible omb i l i c ; chez d'auti'cs
l'ombilic est assez l a r g e , infuinlibuliforme et limité pa r un angl e bien p r o n o n c é ; che z d' aut r e s
encore cet angle n'existe pas et rond) i î ic au fond ducpiel on apo' çoi l facilemenl Ions les tour s de
spire, est aussi clendu q u e possible; un g r o u p e csl r ema r q u a b l e |)ar u n e l'angée de gros tube r cul e s
que ))orlc cha cun de s côtés de la spire cl q u i , formanl u n e c o u r o n n e saillante autoui' de l'ombilic,
reste n é a nmo i n s perceptible sur c h a c u n des tours de spire d o n t il csl formé.
Mais si la surface est généi'alcmenl assez s emb l a b l e , la (orme de la section t r ansve r s e de la spire
est souvcnl Irès dilVérente. Chez les espèces globul eus e s elle est s emi - l u n a i r e ou r é n i f o rme , .suivant
que les lours de spire sont plus ou moins e n v e l o p p a n t s ; celle de s espèces à large ombilic est c i r culaire
ou ovale soit t r ansve r s a l ement , - soi t ve r t i c a l ement .
Les différences spécifiques r é s ident surtout dans la forme el l'épaisseur de s c loi sons , ainsi q u e
dans le diamèti'C du siphon et la place qu'il oc cupe .
Un aut r e group e dont la sm-face est éga l ement lisse ou l égè r ement s t r i é e , du moins loi'sque les
coquilles ont acquis tout leur d é v e l o p p eme n t , est f o rmé d'espèces plus ou mo i n s d é p r imé e s latéralement,
à tours de spire très souvent cont igus et pa r cons équent pa r f a i t emen t visibles dans l'onjbilic
et r a r eme n t enveloppants ; la section t r ansve r so de la spi r e est ou bien c a r r é e , ou h e x a g o n e ,
ordinairement plus baute que l a rge et plus ou moins lancéolée. Le u r bord ma rgina l e x t e r n e est ou
plan ou plus ou moins c r e u x ; (pielquefois il est compl è t ement t r a n c h a n t , ma i s dans ce cas les
loui's de spire sont enve loppant s et l'ombilic esl petit.
Outre les divers groupe s que j e viens d' indique r , il en existe encor e d e u x a u t r e s , dont l'un r e n -
trerait dans le pr é c édent si la sur f a c e des coquilles qui y a p p a r l i e n n e n t , n'était orné e d ' u n e quant i t é
innombrable de fortes stries d' a c c roi s s ement t r aver sées dans le j e u n e â g e pa r de minc e s coles ou
par des sillons longi tudinaux qui souvent modi f i ent r o u v c r l u r e et lui d o n n e n t u n e forme polygonale.
En lin il en existe un de rni e r dont les coquilles sont orné e s sur les côtés el s u r l eur partie mé d i a n e
externe et convexe d'un cei'tain n omb r e de cotes ou de c a r ène s t r a n c h a n t e s , souvent c r é n e l é e s ,
mais dont ordina i r ement une partie disparait pa r le d é v e l o p p eme nt de la coquille. Chez ces espèces
roml)ilic e.çt g r a n d et souvent le vide central y est cons idé r abl e.
En m' api )uyanl sur les dive r s caractèi'es que je viens d ' e s q u i s s e r , je me suis efforcé de r é u n i r
dans le t abl e au suivant toutes les espèces du calcaire c a r b o n i f è r e belge ipii me sont c o n n u e s et
d'indiquer s omma i r eme n t les diflërences essentielles qui exi s t ent ent r e elles.
Pour confectionne r ce t abl e au , j'ai pris p o u r base les di f f é r enc es ipii existent 1" dans la forme
générale des espèces; 2° dans les o r n eme n t s de leui- s u r f a c e ; 3- dans r e n r n u l cme n t de l eur s p i r e ;
dans la section t r ansve r s e de l eur s p i r e ; o" dans leur ombi l i c ; 6« dans la forme de leui-s cloisons
et enfin dans la situation et le di amè t r e de leur s iphon.
Voir ce tableau à la page suivant e .
IL