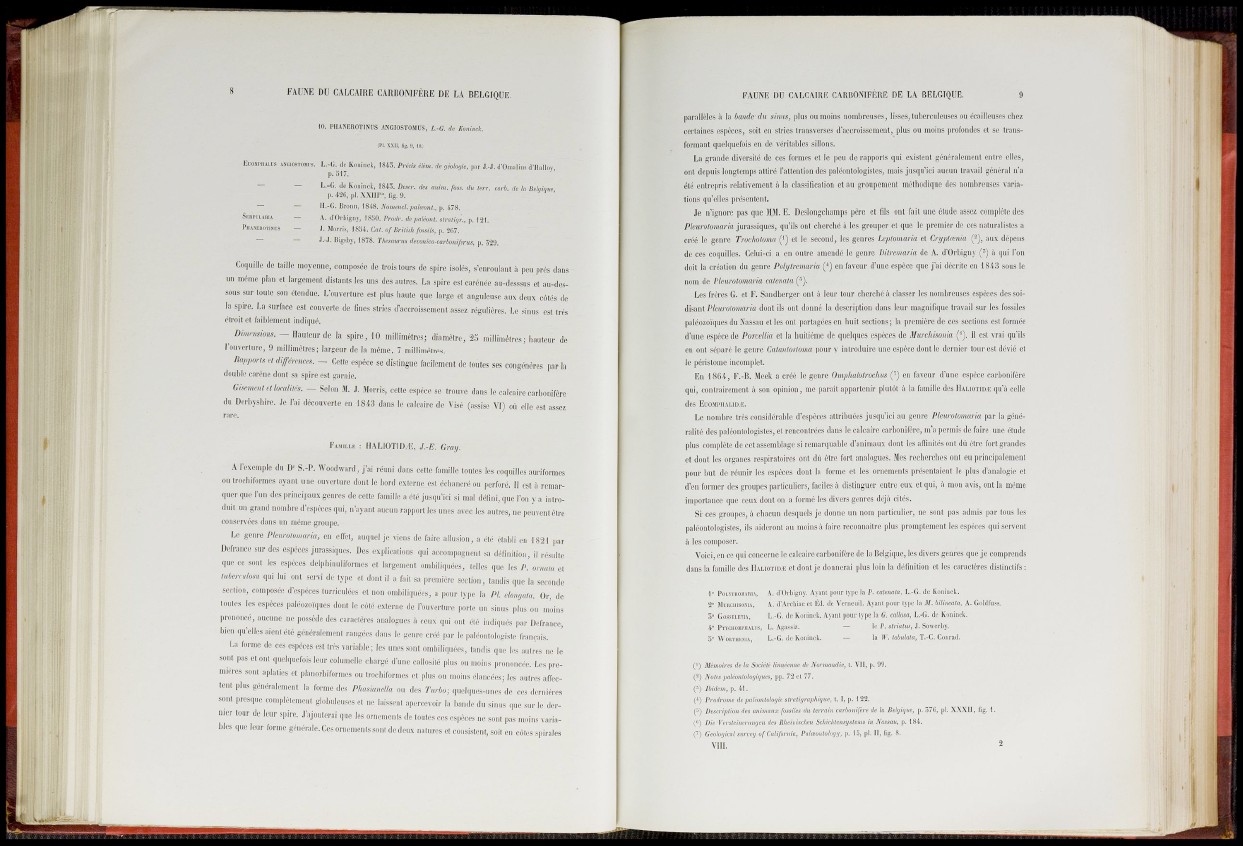
F A U N E DU C A L C A I H R C A R B O I S I F K R E DE L A B E L G I Q U E
10. PHAME110TINÜS ANGIOSTOMUS, L.-G. de Köninck.
JilO.MPil.UlS AXClOSTOMrs
S E R P I I . A R I \
PuASEilOTINtS
(PI. XXII, lis, n. 10.)
; géologie, p.ir J.-J. d'Oin.ilius d'Halloy,
L . - G . dl.' K ö n i n c k , 1 8 i 3 , Prcds elem
p. 5i7.
L.-G. de Köninck, 1843. Dcscr. des
]>. 42(), pl. . \ . \ l | | ' " , lig. 9.
I L - G . B r o n n , 1 8 4 8 . Nomeiicl. pakeont., p. 4 7 8 .
A. < | -Or b i g n y , IfiliO. Prodr. depateont. sfraligr.,
.]- .Morris, 1 8 0 4 . Cat. of Urilish fossils, j>. 2( )7.
J . - J . Bi g s b ) , 1 8 7 8 . T/iesaurus desonico-carbonifer,
•"¡. foss. du lerr. carb. de la Belgique,
p. 121.
Coiiuillc do uiille inoyeiiiie, compos é e de ti'ois lours de spire isolés, s'cnroiilaiit à peu près dans
un mùme plan et iargeinent distants les mis des aulros. La spire es! e a r éué e aii-desssus et tiu-des^
sous sur toute sou olendut). LWv e r t u r e est plus liante q u e large et angul eus e aux d . u x côtés de
la spii'e. La surface est couverte de fines stries d'accroisscnieiil assez régulières, l.e sinus est très
étroit et faiblement indiqué.
Dmnmons. — I l a n l e u r de la s p i r e , 10 millimêircs ; d i amè t r e , 23 mi l l imè t r e s ; haut eur de
r o u v e r l u r e , 9 mi l l imà i r e s ; l a rgeur de la môme , 7 millimètres.
Itapporls et dilfércnces. - Cette espèce se dislingiie facilement de tontes ses congénè r es pa r la
double carène dont sa spire est garnie.
GimurnlHlocalUés. — Selon .H. J. Morris, celle espèce se t rouve dans le calcnii^ecarhouifère
du De rbyshi r e . Je l'ai dé couve r t e en 1 8 i 3 dans le calcaire de Visé (assise VI ) où elle est assez
rui'e.
FAMILLE ; H A L I O T I D . ' E , J.-E. Gray.
A l'exemple du S. -P. Wo o dwa r d , j'ai réuni dans cette famille loules les coquilles aur i formc s
on trociiiformes a y a n t u n e ouve r tur e dont le boni ext e rne est e chanc r c ou perforé. II csl à r ema r -
quer que r u n des jn^incipaux genr e s de celte famille a été jusqu' ici si mal défini, que l'ou y a int roduit
un gi'and n omb r e d'esjieces qui, n' a ya nt aucun r apj ior l l e s une s avec les autres, ne peuvent ê t r e
conservées dans un mê ine gj'oupe.
Le g e n r e Pleurolumaria, eu effet, au(|uel j e viens de faire a l lus ion, a été établi en 1 8 5 1 p r
Defrauce sur des espèces jurassiques. De s explications qui aceonqiagncnt sa dé f ini t ion, il r é sul te
que ce sont les espèces de lphinul i formcs et l a rgement ombi l iqué e s , telles q u e l e s / ' , onmia
UibernUo., qni lui ont servi de t y p e et dont il a fait sa première s e c t ion, tandis q u e la seconde
section, compos é e d'espèces lurriculécs el non ombi l iqué e s , a pour type la PL elonyalu. Or , <lc
toutes les espèces paléozoïques dont le côté ext e rne de l'ouverture porte un sinus plus ou moins
prononcé, aucune ne possède des cnracfères analogues à c eux qui ont été indiqué s par De f r anc c ,
bien qu'elles aient été géné r a l emcnl r angé e s d a n s le g e n r e créé pa r le paléontologiste français,
La forme de ces espà-es est très va r i a bl e ; les unes sont ombi l iqué e s , tandis que les aut r e s ne le
sont pas et ont quelquefois leur columelle cba rgé d'une callosité plus ou muins prononcée. Les pr e -
mières sont aplaties et pl anorbi formes ou trocbiformes et plus ou moins é l anc é e s ; les autres ofTect
e n t p l u s g é n é r a l e n , e n t la forme des PImianolla ou des queb,ue s -nne s de ces de rni è r e s
sont presque complélement globuleuses et ne laissent apercevoir la b a n d e du s inus que sur le d e r -
nier tour de leur spire, .rajouterai q u e les ornement s de toutes ces espèces ne sont pas moins ^a r i a -
ijlcs que leur forme générale . Ces orncmciits soni de .leux na tur e s el consistent, soit en cotes spirales
FAUNE DU CALCMRIÎ: CARBO.MFEUR DE LA BELGIQUE. 9
parallèles à ia bande du sims, plus ou moins n omb r e u s e s , lisses, tuberculeuses ou écailleuses chez
certaines e spè c e s, soit en stries Iransverses d' a c c roi s s ement , plus ou moins profondes et se transformant
quelquefois en de véritables sillons.
La g r a n d e diversité de ces formes et le peu de r appor ts qui existent géné r a l ement ent r e elles,
ont depuis longtemps attire raltenlion des paléontologistes, mais jusqu'ici aucun travail général n'a
été entrepri s relativement ii la classification et au groupemen t mé thodique des nombr eus e s variations
qu'elles présentent.
Je n'ignore pas que MAL E. De s longchamps père et fils ont fail une étude assez complète des
Pleuroiomaria juras.-iiques, qu'ils ont c h e r c hé à les groupe r et q u e le p r emi e r de ces iiaturaiistes a
créé le g e n r e Trocholoma ( ' ) et le s e cond, les genr e s Lcptomaria et Cri/ploenia (-), aux dépens
de ces coquilles. Celui-ci a en out re ame n de le g e n r e Dilremarm de A. d'Orbigny à qui l'on
doit la création du g e n r e Polylremaria {'•) en faveur d'une espèce que j ' a i décrite en 1 8 4 3 sous le
n o m d e Pleuroiomaria calenala
Les f r è r e s G. et F. Sa n d b e r g e r ont à leur tour che r ché ù classer les nombr eus e s espèces des soidisant
Pleuroiomaria dont ils ont donné la description dans leur magni f ique travail sur les fossiles
paléozoïques du Nassau et les ont partagées en huit sections; la pr emi è r e de ces sections est formée
d'une espèce de Porcellia el la huitième de quelques espèces de Murdmonia Il est vrai qu'ils
en ont séparé le g e n r e Catanlosmia pour y int rodui r e une espèce dont le de rni e r tour est dévié et
le péristome incomplet.
En d86/i., F.-B. Meek a créé le g e n r e Omphaloirochus (") en faveur d'une espèce carbonifère
qui, cont r a i r ement à son opinion, me parait appa r t eni r plutôt à la famille des IlAt-ionD/i qu'à celle
des EuoMi>n.\[.iD/E.
Le n omb r e très consi<lérable d'espèces atlril)uées jusqu'ici au g e n r e Pleuroiomaria par la géné -
ralité des paléontologistes, el r encont r é e s dans le calcaire carbonifère, m'a permis de faire une étude
plus complète de cet assemblage si r ema rquabl e d' animaux dont les airinités ont dii être fort grondes
et dont les organes respiratoires ont dù ê t r e fort analogues. Mes r e c h e r c h e s ont eu pr inc ipa l ement
pour hut de r éuni r les espèces dont la forme et les ornement s présentaient le plus d'analogie et
d'en f o rme r des groupe s particuliers, faciles ù distingue r entre eux el qui, à mou avis, ont la même
importance que c eux dont on a formé les divers genr e s déjà c i t é s .
Si ces groupe s , à chacun desquels je donne un nom particulier, ne sont pas admis par tous les
paléontologistes, ils aideront au moins à faire r e conna î t r e plus prompl ement les espèces qui servent
à les composer.
Voici, en ce qui concerne le calcaire carbonifère de la Belgique, les divers g e n r e s que j e compr ends
dans la famille des If.iLiOTiDi: et dont j e donne r a i plus loin la définition et les caractères distinctifs :
1" PoLYTnoMABi.v A. (i'Orbign)'. Ayani pour type la P. catemla, L.-G. tic Köninck,
2» MinciiisoM.v, A. tl'Arcliioe et Éd, de Vcrneuil. Ayant pour type la M. bilineata, A. Goldfuss.
5" GOSSELETI.V, L.-G. do Koninc-k. Ayant pour lype lii G. callosa, L.-G. de Köninck.
4" l>TV(;Hom>n.\us, L. Agassiz. — ie P. slriatus, J. Sowerby.
5" M oiiTMKKU, L.-G. de Köninck. -- la H". labutala, T.-C. Conrad.
( ' ) Miimoires de ia Sociclë liiinécim ' de Novinandie,
VII, 1). 99.
(2) A't»/es ijaiéoiUologùiues, pp. 7'2 •
I 7 7 .
(••) Ibidem, ]>. 41,
( ' ) Prodrome de paléontologie siruligruphiijiie, l. I, p. 1 2 2 .
(5) Oesa ipUon des animaux fossiles du ten-ain carbonifère de la Belgique, p. û 7C, p l . X X X I I , fig, 1.
Die Yerslcimrmiyen des Rlieiiiisclieti Schiclilensyslems in Ao s s a i t , p. 1 8 4 ,
( ' ) Geological surocij of California, PulieonCologij, p. 1 5 , pl. I t , (ig. 8.
VIII. 2