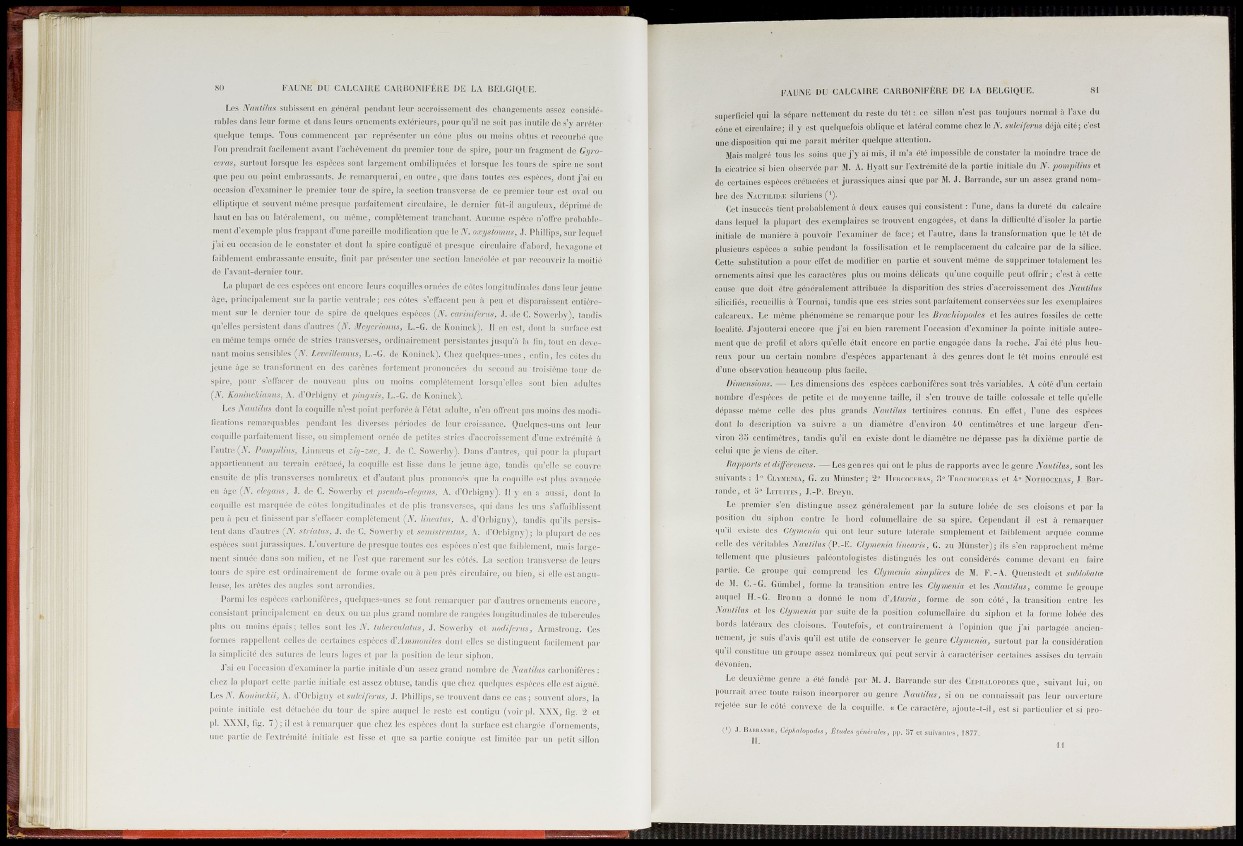
so FAUINE Di : CALCAIUIi: CARBOMPÈRIÎ DE LA BEI.ÎilQLÎi:-
Lcs Naulilns siibissenl en général pondant leur iiccroissûmoiU des cliangemoiits assez considörables
dans leur l'orme cl dans leurs ornements exléj-ieurs, jiour f[u'il ne soit pas inutile de s'y arrèlei'
(liicique temps. Tous eomnicncent par représenter un cône pins ou moins obtus et recourl)é que
l'on prendrait facilement avant l'achèvement du premier tour de spire, pour un fragment de Gi/ivccras,
surtout lorsque les espèces soni largement oml)ili(iuées et lorsque les lours de spire ne soul
que peu ou poiut embrassants. Je remarquerai, en outre, (pie dans toutes ces espèces, dont j'ai en
occasion d'exaniiuer le premier tour de spire, la section transverse de ce premier tour est oval ou
elliptique cl souvent mémo presque parfaitement circulaire, le dernier fùt,-i! anguleux, dépi'imcde
iiauteu bas ou latéralement, ou même, complètement irancbtmt. Aucune espèce n'olîrc probahlcmeut
d'exemple plus frappant d \mo pareille modification que le .V. oxystomus, ,1. Pliillips, sur lequel
j'ai eu occasion de le constater et dont la spire coutiguë et presque cii-cnlaire d'abord, hexagonti et
faiblemeiK embrassante ensuite, fiuit pai' présenter une section lancéolée et par recouvrir la moitié
de ravant-deriiier tour.
La plupart de ces espèces ont eucore leurs coquilles ornées de cotes longiludiuales dans leur jeune
iige, principalement sur la partie veutrale; ces cotes s'eilacent pen à peu et disparaissent entièrenient
sur lo dernier tour de spire de cfuelques espèces (.V. cayiniferuti, .}. de ("l. Sowerby), taudis
(¡u'elles persistent dans d'autres {N. Mcyerkimis, L.-G. de Köninck). Il en est, dont la surface est
eu mémo temps ornée de stries Iransverses, ordiuairement persistantes jusqu'à la liu, toul en devenant
moins sensibles (/V. Loveillcanus, L.-G. de Köninck). Chez quelques-unes, enlin, les côtes du
jeune âge se Iransformoni on des carènes forlement prononcées du second au troisième tour de
spii'e, pour s'efTacer de nouveau plus ou moins complèleinent lorsqu'elles sont bien adultes
(:V. Koiiinckiamts, A. d'Oi-higny et phujuis, L.-G. de Köninck).
Les ¡Suutilus dont la coquille n'est poini perforée à l'état adulte, n'en olTreiU pas moins des modilicatious
reniarqnubles ¡lendant les diverses périodes de leur croissance. Qucbiues-nns ont leur
co(|uillc parfaitemeni lisse, on simplement ornée de petites sirics d'accroissement d'une extrémité à
raulre(.V. PompUina, Linnrcus et zhj-znc, .1. de C. Sowerby). Dans d'autres, qui pour la plupart
appartiennent au terrain crétacé, la coquille est lisse dans le j eune âge, tandis qu'elle se couvre
ensuite de ]ilis Iransverses nombreux et d'autant jilus prononcés que la coquille est plus avancée
en âge (A', elegamt, J. de C. Sowerby et pmido-elefjans, A. d'Orbigny). J1 y en a aussi, dont la
coipiille est manpiée de côtes longitudinales et de plis transverses, qui dans les uns s'affaiblissent
pen à peu et Unissent par s'eflaccr complèlement ( J . lineutiiH, A. d'Orbigny), taudis qu'ils persistent
dans d'autres (iY. sirialiis, .). de C. Sowerby et semistriuUix, A. d'Orbigny); la plujiart de ces
espèces sont jurassiques. L'ouverlure de presque toutes ces espèces n'est que faiblemenl, mais largement
sinuée dans son milieu, et ne Test (|ue rarement sur les cotés. La section Iransverse de leurs
tours de spire est ordinairemeiil de forme ovale ou à peu près circulaire, ou bien, si elle est anguleuse,
les aretes des angles sont arrondies.
Parmi les espèces carbonifères, quclqiies-unes se font remarquer par d'autres ornemenis encore,
consistant principaleiiieul en deux ou un plus grand nombre de rangées longitudinales de tubercules
plus ou moins épais; telles sont les X labermUilus, J. Sowerby et nodiferus, Armstrong. V,es
formes rappellent celles de certaines esjièces (VAmmoni/cs dont elles se dislingucnl facilement jiar
la sini|)licilè des sutures de leurs loges et par la position de leur siphon.
J'ai eu l'occasion d'examiner la partie initiale d'un assez grand nombre ikNaiililus carbonifèi'cs :
chez la plupart celte i)arlie initiale esi assez obtuse, tandis que cbe z quekpies espèces elle est aiguë.
L e s X Küuinckä, A. d'Orbigny sidciferuii, .1. Pliillips, se ti'ouvent dans ce cas; souvent alors, la
pointe initiale est détacbée du tour de spii-e auquel le reste est contigu (voir ¡>1. XXX, lig. 2 et
pl. XXXI, iig. 7) ; il esl à remarquer (pie cbcz les espèces dont la surface est chargée d'oi'ncmcnts,
une partie de l'extrémité initiale est lisse et que sa partie conique (ist limitée par un petit sillon
F A I I N K DU C A L C A I R I Î C A U B O I N I F È R K DE LA B E L G I Q U E . 81
supernciel qui la sépare nettement du reste du tét : ce sillon n'est pas toujours normal à l'axe du
cône et circulaire; il y est quelquefois oblique et latéral comme chez le N. sulci férus déjà cité; c'est
une disposition qui me parait mériter quelque attention.
i\lais malgré tous les soins que j'y ai mis, il m'a été impossible de constater la moindre trace de
la cicatrice si bien observée pa r M. A. Hyatt sur l'extrémité de la partie initiale du N. pompilius et
de certaines espèces crétacées et jurassiques ainsi que par M. J. Barrando, sur un assez grand nomb
r e d e s N.VL'TILID/1-; s i l u i ' i e n s
Cet insuccès tient probablement à deux causes qui consistent: l'une, dans la dureté du calcaire
dans lequel la plupai't des exemplaires se trouvent engagées, et dans la diiliculté d'isoler la partie
initiale de manière à pouvoir l'examiner de face; et l'autre, dans la transformation que le tét de
plusieurs espèces a subie pendant la fossilisation et le remplacement du calcaire par de la silice.
Cette substitution a pour effet de modifier en partie et souvent même de supprimer toliîlement les
ornemenis ainsi que les caractères plus ou moins délicats (ju'une coquille peut olïrir; c'est à cette
cause que doit être généralement attribuée la disparition des stries d'accroissement des Nmililua
silicifiés, recueillis h Tournai, tandis que ces siries sont parfaitement conservées sur les exemplaires
calcareux. Le même phénomène se remarque pour les Brachiopodes et les autres fossiles de celte
localité. J'ajouterai encore que j'ai eu bien rarement l'occasion d'examiner la pointe initiale aulrement
que de profil et alors qu'elle était encore en pani e engagée dans la roche. J'ai été plus heul'cux
pour un certain nombre d'espèces appartenant à des genres dont le tét moins enroulé est
d'une observation beaucoup plus facile.
Dimensions. — Les dimensions des espèces carbonifères sont très variables. A côté d'un certain
nombre d'espèces de petite et de moyenne taille, il s'en trouve de taille colossale cl telle qu'elle
dépasse même celle des plus grands Nautilus tertiaires connus. En effet, l'une des espèces
dont la description va suivre a un diamètre d'environ 40 cenlimètres et une largeur d'environ
33 centimètres, tandis qu'il en existe dont le diamètre ne dépasse pas la dixième partie de
celui que je viens de citer.
Jiapporls el différences. — Les genr e s qui ont le plus de rapjiorts avec le genre Nmailus, sont les
s u i v a n t s : 1° CLVMKXIA, G. zu J l i i n s t e r ; 2° I IERCOCERAS, 3° T n c c i i o c E n A s et NOÏ I IOCERAS , J. B a r -
rande, et LiTciTES, J.-P. Breyn.
Le premier s'en dislingue assez généralement par la suture lobée de ses cloisons et par la
position du sipbon contre le bord columellaire de sa spire. Cependant il est à remarquer
qu'il existe des Cli/menici qui onl leur suture latérale simplement et faiblement arquée comme
celle des véritables IVFLIU/KS (P.-E. Cli/menia linearis, G. zu Munster); ils s'eii rapprochent même
tellement que plusieui's paléonlologistes distingués les ont considérés comme devant en l'aire
partie. Ce grouiie qui comprend les Clymenia simplices de M. F. -A. Quenstedt cl siiblol/aloe
de .M. C.-G. Giimbel, forme la transition entre les Clymenia el les Nuulilus, comme le groupe
auquel JI.-G. Bromi a donné le nom A'Aitiria, forme de son c()té, la transition entre les
iWmtihis el les Clymenia pai' sui le de la position columellaire du siphon el la forme lobée des
bords latéraux des cloisons. Toutefois, et conlraireinent à l'opinion que j'ai partagée anciennement,
je suis d avis qu'il est utile de conserver le genre Clymenia, surtout par la considération
iiuil constitue un groupe assez nombreux qui peut servir à caractériser certaines assises du leri'ain
dévonien.
Le deuxième genre a été fondé par 31. J. Barrande sur des CIÌPÌIALOPODES que , suivant lui, on
i>ourrai) avec toute raison incorporer au genre Nautilus, si on ne connaissait pas leur ouverture
rejelée sur le côté convexe de la coiiuille. « Ce caractère, ajoute-l-il, est si particulier et si jiro-
IURRANDS, Céphalopodes, Éludes gé
I L
2ies, 1877