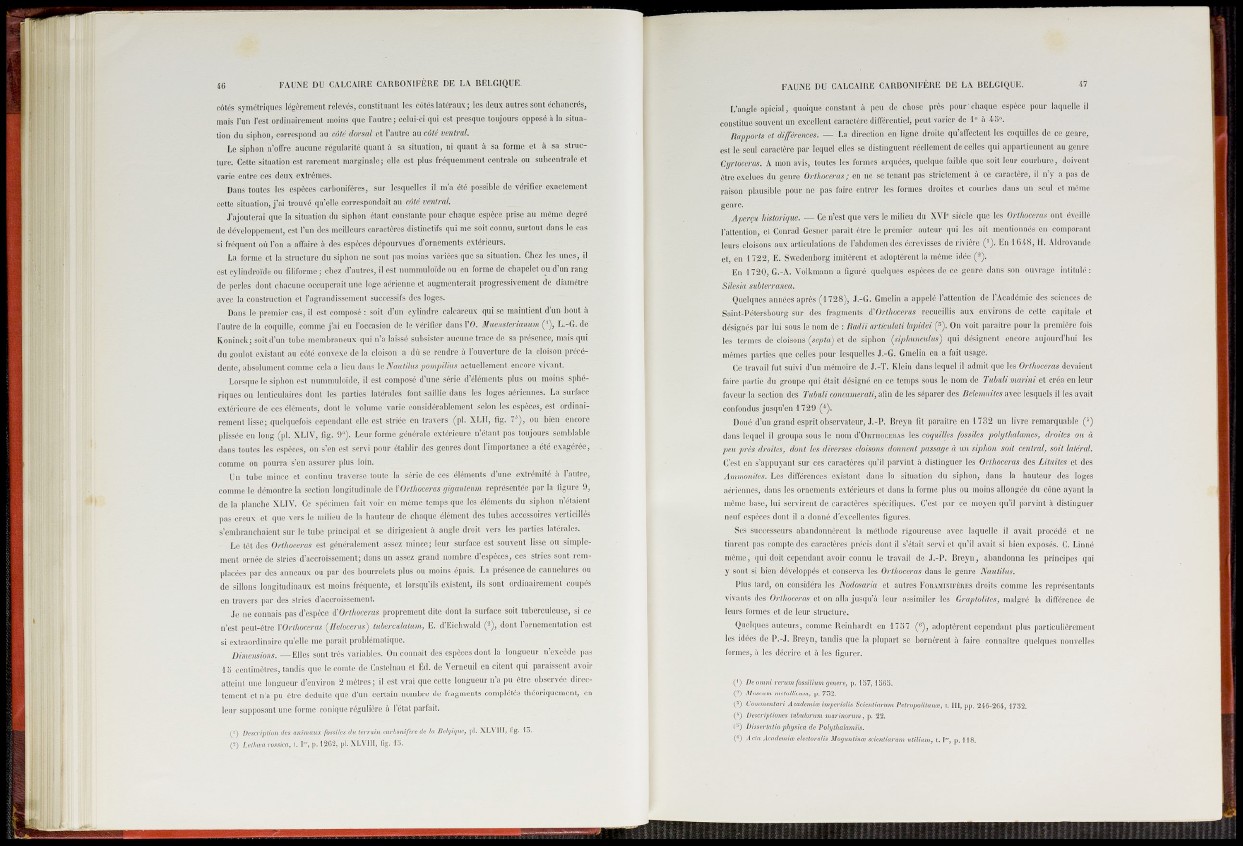
iO FAUNE DU CALCAIRE CARBONIFÈRE DE LA BELGIQUE. FAUNE DU CALCAIRE CARBONIFÈRE DE LA BELGIQUE. Al
cólés symclviqiies légèremont relevés, consiiiuant les côtés latéraux j les deux autres sont ccliancrés,
mais l'un l'est orclinaircmeiil moins que l'autre; celui-ci qui est pr e sque toujours opposé à la situation
du siphon, correspond au câlc dorsal et l'autre au côté ventral.
Le siphon n'oiTre aucune régularité quant à sa situation, ni quant à sa forme et à sa structure.
Cette situation est r a r ement ma rgina l e ; elle est plus f r équemment centrale ou subcentrale et
varie entre ces deux extrêmes.
Dans toutes les espèces carbonifères, sur lesquelles il m'a été possible de vérifier exactement
cette situation, j'ai trouvé qu'elle correspondait au côté ventral.
J'ajouterai que la situation du siphon élant constante pour chaque espèce prise au môme degré
de développement, est l'un des meilleurs caractères distinctifs qui me soit connu, surtout dans le cas
si fréquent où l'on a affaire à des espèces dépourvues d'ornements extérieurs.
La forme et la s lnic lur e du siphon ne sont pas moins variées que sa situation. Chez les u n e s , il
est cylindroïde ou liliformc; chez d'autres, il est numnudoïde ou en forme de chapelet ou d'un r ang
de perles dont chacune occuperait une loge aérienne et augmenterai t progressivement de diamètre
avec la construction et l'agrandissement successifs des loges.
Dans le premier cas, il est composé : soit d'un cylindre calcareux qui se maintient d'un hout à
l'aulre de la coquille, comme j'ai eu l'occasion de le vérifier dans l'O. MueiiSteriamm ( ' ) , L.-G. de
Köninck; soit d'un tube memb r a n e u x qui n'a laissé subsister aucune trace de sa présence, mais qui
du goulot existant au côté convexe de la cloison a dû se r en d r e à l'ouverture de la cloison précédente,
absolument comme cela a lieu dans le Nantiliis pompilina actuellement encore vivant.
Lorsque le siphon est nummuloïde , il est composé d'une série d'éléments plus ou moins sphériques
ou lenticulaires dont les parties latérales font saillie dans les loges aériennes. La surface
extérieure de ces éléments, doni le volume varie considérablement selon les espèces, est ordinairement
lisse; quelquefois cependant elle est striée en travers (pl. XLII, fig. 7^), ou bien encore
plissée en long (pl. XLIV, flg. 9"). Leur forme générale extérieure n'étant pas toujour s semblable
dans toutes les espèces, on s'en est servi pour établir des genres dont l'importance a été exagé r é e ,
comme on pourra s'en assurer plus loin.
Un tube mince et continu traverse toute la série de ces éléments d'une extrémité à l'autre,
comme le démontre la section longitudinale de VOrthoceras gkjantemn représenté e par la figure 0,
de la planche XLIV. Ce spécimen fait voir en même temps que les éléments du siphon n'étaieni
pas c r eux et que vers le milieu de la hauteur de chaque élément des tubes accessoires verticillés
s'embranchaient sur le tube principal et se dirigeaient à angle droit vers les parties latérales.
Le tel des Orthocerus est généralement assez minc e ; leur surface est souvent lisse ou simplement
ornée de stries d'accroissement; dans un assez gr and n omb r e d'espèces, ces stries sont r emplacées
par des anne aux ou par des bourrelets plus ou moins épais. La présence de cannelurcs ou
de sillons longitudinaux est moins fréquente, et lorsqu'ils existent, ils sont ordina i r ement coupés
en travers par des slrics d'accroissement.
J e ne connais pas d'espèce i\Ortkocerus proj)rement dite dont la surface soit tuberculeuse, si ce
n'est peut-être VOrlhoceras {Ueloceras) iubcrculaUm, E. d'Eichwald dont rornemenl a t ion est
si extraordinaire qu'elle me parait problématique.
Dimensions. Elles sont très variables. On connaît des espèces dont la longueur n'excède pas
'1Ü centimètres, tandis que le conile de Castehiau et Éd. de Verneuil en citent qui paraissent avoir
atteiüi une longueur d'environ 2 mètres ; il est vrai que celte longueur n'a pu être observée directement
el n'a pu être déduite que d'un cerlain nombr e de fragment s complétés lliéoriquement, en
leur supposant une forme coni(|ue régulière à l'état parfait.
0) Description (U
limmtx fo Ucs du ten
(-) Lcllioea rossia
12G'2, |)I.Xr.Vl
n carboniere de lu Ddfiiqv
. fÎL'. 10.
pl. XLVill, (:g. U
[/angle apicial, quoique constant à peu de chose près pour chaque espèce pour laquelle il
constitue souvent un excellent caractère dill'érentici, peut varier de à
Rapports et différences. — La direction en ligne droite qu'affectent les coquilles de ce genre,
est le seul caractère par lequel elles se distinguent réellement de celles qui appartiennent au genre
Cyrlocerus. A mon avis, toutes les formes arquées, quelque faible que soit leur courbur e , doivent
être exclues du gein-e Orthoceras ; en ne se tenant pas strictement à ce caractère, il n'y a pas de
raison plausible pour ne pas faire entre r les formes droites et courbes dans un seul et même
genre.
Aperçu histori(jue. - Ce n'est que vers le milieu du XVI" siècle que les Orthoccrui ont éveillé
l'attention, et Conrad Gesner paraît être le premier auteur qui les ait mentionnés en comparant
leurs cloisons aux articulations de l'abdomen des écrevisses de rivière ( ' ) . En 16/i-8, II. Aldrovande
et, en 1T2 2 , E. Swedenborg imitérenl et adoptèrent la même idée ( - ) .
En 1 7 2 0 , G.-A. Yolkmann a figure quelques espèces de ce genr e dans son ouvrage int i tul é :
Silesia subterránea.
Quelques années après ( 1 7 2 8 ) , J.-G. Gmelin a appelé l'attention de l'Académie des sciences de
Saint-Pétersbourg sur des f r agment s VOrlhoceras recueillis aux environs de cette ca|)itale et
désignés par lui sous le nom de : Radii arliculati lapidei Ou voit paraître pour la première fois
les termes de cloisons et de siphon {sipkunculus) qui désignent encore aujourd'hui les
m.êmes parties que celles pour lesquelles J.-G. Gmelin en a fait usage.
Ce ti'avail fut suivi d'un mémoi r e de J . - ï . Klein dans lequel il admi t que les Orthoceras devaient
faire i)ariie du groupe qui était désigné en ce temps sous le nom de Tubulimarini el créa en leur
faveur la section des Tubuli concamerati, afin de les séparer des Belemnifes avec lesquels il les avait
confondus jusqu'en 1 7 2 9
Doué d'un gr and esprit observateur, J . - P. Br eyn fit paraître en i 7 3 2 un livre r ema rquabl e (5)
dans lequel il groupa sous le nom d'ORTiiociîtiAS les coquilles fossiles polythalames, droites ou (i
peu près droites, dont les diverses cloisons donnent passage « iHi siphon soit central, soit latéral.
C'est en s'appuyant sur ces caractères qu'il parvint à distinguer les Orthoceras des Limites et des
Ammonites. Les différences existant dans la situation du siphon, dans la haut eur des loges
aèi'iennes, dans les ornements extérieurs et dans la forme plus ou moins allongée du cône ayant la
même base, lui servirent de caractères spécifiques. C'est par ce moyen qu'il parvint à distinguer
neuf espèces dont il a donné d'excellentes figures.
Ses successeurs abandonnèrent la méthode rigoureuse avec laquelle il avait procédé et ne
tinrent pas compte des caractères précis dont il s'était servi el qu'il avait si bien exposés. C. Linné
même, qui doit cependant avoir connu le travail de J . -P. Dr e y n , abandonn a les principes qui
y sont si bien développés el conserva les Orthocerus dans le g e n r e Naxitilus.
Plus tard, on considéra les Nodosaria et autres FOUAMINIFÈRES droits c omme les représentants
vivants des Orthoceras et on alla jusqu'à leur assimiler les Graplolites, ma lgr é la différence de
leurs formes et de leur structure.
Quelques aut eur s , comme Reinliardt en 1 7 5 7 ("), adoptèrent cependant plus particulièrement
les idées de P. - J . Breyn, tandis que la plupart se bornèrent à faire connaître quelques nouvelles
formes, à les décrire et à les figurei'.
(') De omni rmm fossilium genere, p. Iti7,156ü.
Museum meUilHcum, j). 752.
(') Cowmentari Academiai iniperialis Scientiarum Pctropolilame, i. III, pp. 246-2G4, 1752.
(') Dcscriplionei lubulorum marinorum, p. 22.
: '0 Üisserifítio physica de Polythalamiis.
(«) AcUi Academiie etccloralis Mofjiinlina: sdcnlianm uliliton, 1.1", p. 118,