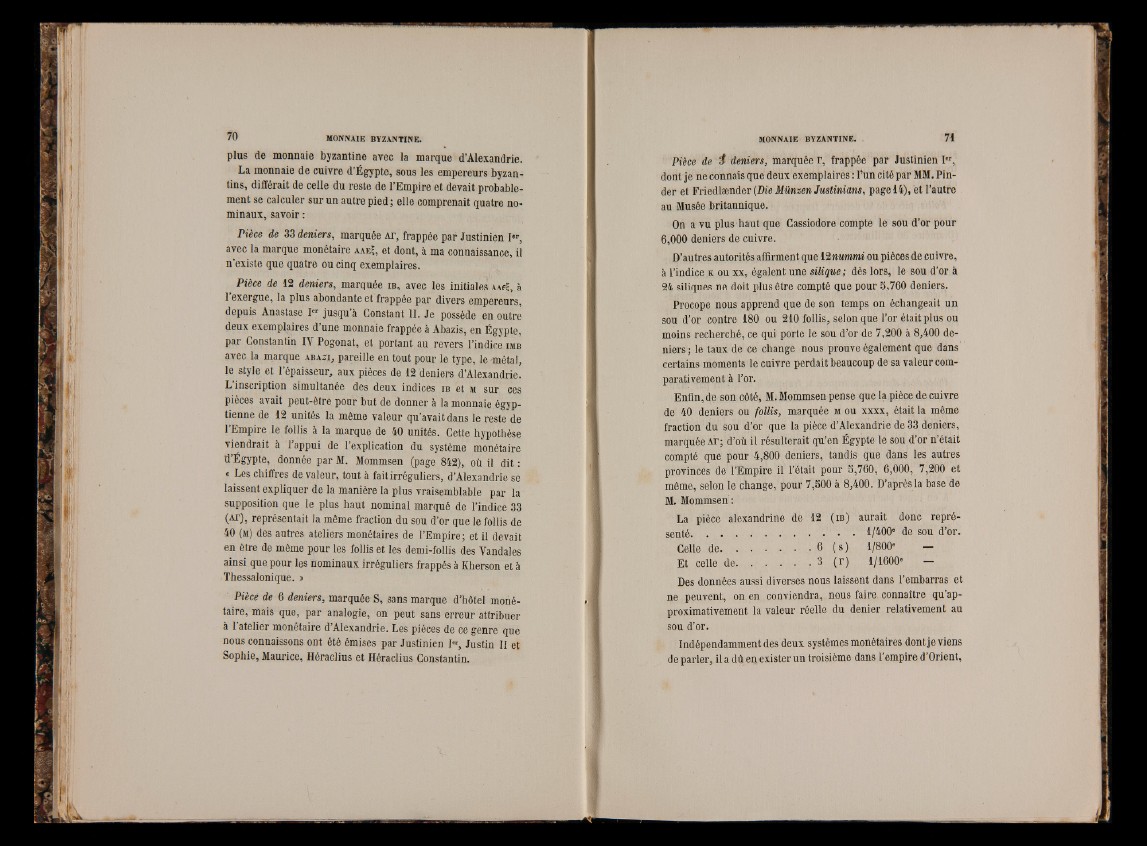
plus de monnaie byzantine avec la marque d’Alexandrie.
La monnaie de cuivre d’Égypte, sous les empereurs byzantins,
différait de celle du reste de l’Empire et devait probablement
se calculer sur un autre pied; elle comprenait quatre no-*
minaux, savoir :
Pièce de 33 deniers, marquée a t , frappée par Justinien I",
avec la marque monétaire aaeÇ, et dont, à ma connaissance, il
n ’existe que quatre ou cinq exemplaires.
Pièce de 12 deniers, marquée ib , avec les initiales aae?, à
1 exergue, la plus abondante et frappée par divers empereurs,
depuis Ânastase Ier jusqu à Constant II. Je possède en outre
deux exemplaires d’une monnaie frappée à Abazis, en Égypte,
par Constantin IY Pogonat, et portant au revers l’indice imb
avec la marque ab az i, pareille en tout pour le type, le métal,
le style et l ’épaisseur, aux pièces de 12 deniers d’Alexandrie.
L’inscription simultanée des deux indices ib et m sur ces
pièces avait peut-être pour but de donner à la monnaie égyptienne
de 12 unités la même valeur qu’avait dans le reste de
l ’Empire le follis à la marque de 40 unités. Cette hypothèse
viendrait à l’appui de l’explication du système monétaire
Ü’Égypte, donnée par M. Mommsen (page 842), où il dit :
« Les chiffres de valeur, tout à fait irréguliers, d’Alexandrie se
laissent expliquer de la manière la plus vraisemblable par la
supposition que le plus haut nominal marqué de l’indice 33
(at) , représentait la même fraction du sou d’or que le follis de
40 (m) des autres ateliers monétaires de l’Empire; et il devait
en être de même pour les follis et les demi-follis des Vandales
ainsi que pour les nominaux irréguliers frappés à Kherson et à
Thessalonique. »
Pièce de 6 deniers, marquée S, sans marque d’hôtel monétaire,
mais que, par analogie, on peut sans erreur attribuer
à l’atelier monétaire d’Alexandrie. Les pièces de ce genre que
nous connaissons ont été émises par Justinien Ier, Justin II et
Sophie, Maurice, Héraclius et Héraclius Constantin.
Pièce de $ deniers, marquée r, frappée par Justinien Ier,
dont je ne connais que deux exemplaires : l’un cité par MM. Pin-
der et Friedlænder (Die Münzen Justinians, page 14), et l’autre
au Musée britannique.
On a vu plus haut que Cassiodore compte le sou d’or pour
6,000 deniers de cuivre.
D’autres autorités affirment que l%nummi ou pièces de cuivre,
à l’indice k ou x x , égalent une silique; dès lors, le sou d’or à
24 siliques ne doit plus être compté que pour 5,760 deniers.
Procope nous apprend que de son temps on échangeait un
sou d’or contre 180 ou 210 follis, selon que l’or était plus ou
moins recherché, ce qui porte le sou d’or de 7,200 à 8,400 deniers
; le taux de ce change nous prouve également que dans
certains moments le cuivre perdait beaucoup de sa valeur comparativement
à l’or.
Enfin, de son côté, M. Mommsen pense que la pièce de cuivre
de 40 deniers ou follis, marquée m ou xxxx, était la même
fraction du sou d’or que la pièce d’Alexandrie de 33 deniers,
marquée a t ; d’ou il résulterait qu’en Égypte le sou d’or n’était
compté que pour 4,800 deniers, tandis que dans les autres
provinces de l’Empire il l’était pour 5,760, 6,000, 7,200 et
même, selon le change, pour 7,500 à 8,400. D’après la base de
M. Mommsen :
La pièce alexandrine de 12 ( ib ) aurait donc représenté
.................................................... 1/400' de sou d’or.
Celle de.......................1 . 6 ( s ) H -
Et celle d e . ........................ 3 ( r ) 1/1600' —
Des données aussi diverses nous laissent dans l’embarras et
ne peuvent, on en conviendra, nous faire connaître qu’ap-
proximativement la valeur réelle du denier relativement au
sou d’or.
Indépendamment des deux systèmes monétaires dont je viens
de parler, il a dû en exister un troisième dans l’empire d’Orient,