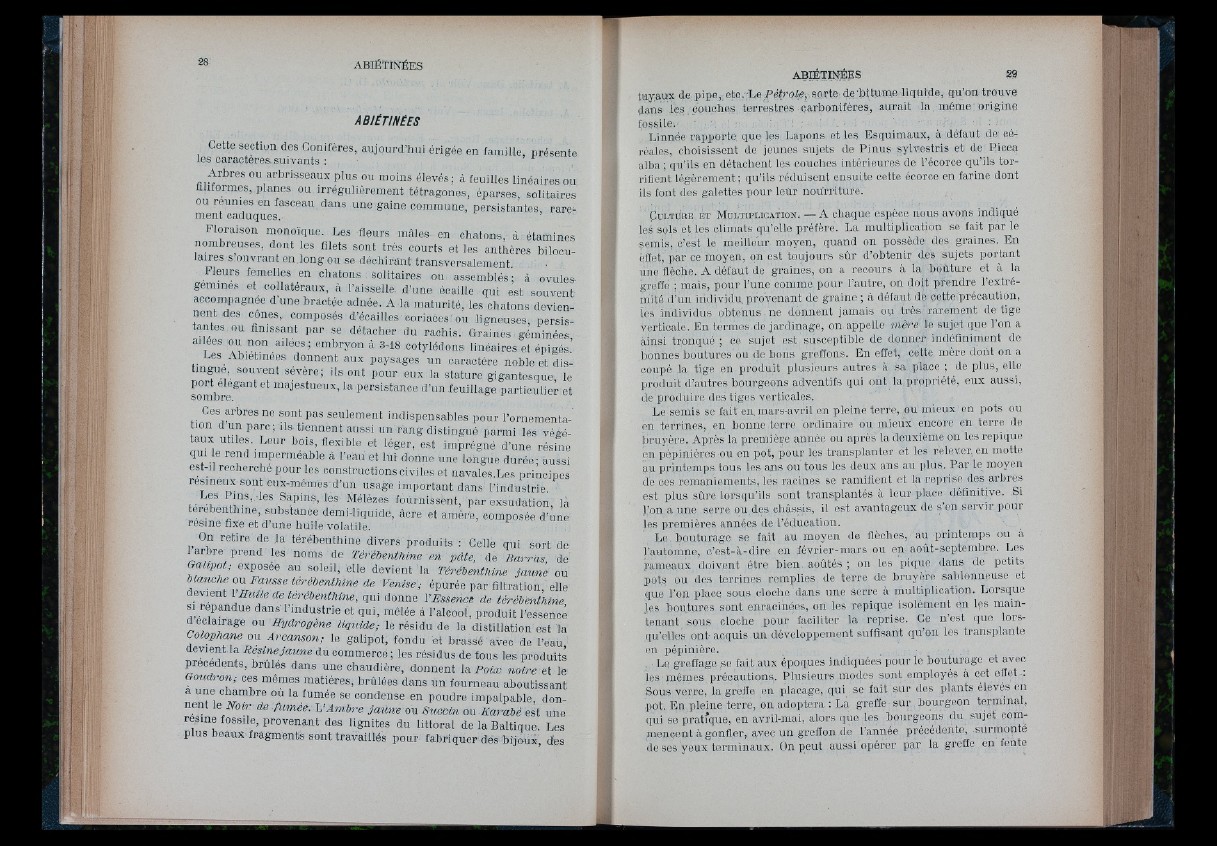
M
ABIÉTINÉES
Cette section des Conifères, a u jo u rd ’h u i érigée en famille, p ré sen te
les caractères, su iv an ts ;
A rb re s ou a rb ris se a u x p lu s ou m oins élevés; à feuilles lin é a ire s ou
filiformes, plan e s ou irrég u liè rem e n t tétrag o n e s, éparses, solita ires
ou reu n ie s en fasceau dans u n e gaine commune, p e rsistan te s , rare^
m en t caduques.
Flo ra iso n m onoïque. Les fleurs mâles en ch ato n s, à é tamines
n om b reu ses, dont les filets so n t très co u rts et les an th è re s bilocu-
laires s o u v ra n t e n ,lo n g ou se d é ch iran t tran sv e rsa lem en t
F leu rs femelles en ch ato n s so lita ires ou a ssem b le s; â ovules-
g emines et co lla té rau x , à l’aisselle, d ’une écaille qui est so u v en t
accompagnée d une bra ctée adnée. A la m a tu rité , les ch ato n s devienn
e n t des cônes, composés d ’éoailles coriaces ou lig n eu se s, p e rs is tan
te s ou fin is san t p a r se d é ta ch e r du raohis. Graines g ém in é e;
dilees ou n o n a ile c s; emb ry o n â .3-18 cotylédons lin é a ire s et épigés.’
Les Abietinees d o n n en t aux p aysages u n c aractère noble et distin
g u e , so uvent sevère; ils ont p o u r eux la s ta tu re g ig an te sq u e , le
p o rt élég an t et m aje stu eu x , la p e rsistan c e d ’un feuillage p a rtic u lie r et
S01TîDr6.
Ces a rb re s ne so n t pas seu lem en t in d isp en sab le s p o u r l’o rn em en ta tio
n d u n p a rc ; ils tie n n e n t aussi u n ra n g d istin g u é p a rm i les végétau
x utile s. L eu r bois, flexible et léger, est im p rég n é d ’une ré sine
qui le ren d imperm éable â l’eau et lui donne une lo ngue d u ré e ; aussi
est-il re ch e rch e p o u r les c o n stru c tio n s civiles et navales.L es p rin cip es
re sm eu x so n t eux-mêmes d ’un usage im p o rta n t d an s l’in d u strie .
-.es .Pins, les Sapins, les Mélèzes fom n is se n t, p a r ex su d a tio n , là
te reb en thm e , sub stan c e demi-liquide, âcre et amère, composée d ’une
re sm e fixe et d ’une hu ile volatile.
On re tire de la téréb en th in e d ivers p ro d u its : Celle qui so rt de
1 a rb re p re n d les n om s de Térébenthine en p â te, de Ba rra s, de
Galipot; exposee au soleil, elle dev ien t la Térébenthine ja u n e ou
blanche on Fausse térébenthine de Venise; épurée p a r filtra tio n , elle
devmnt \ Hu ile de térébenthine, qui d onne l’Essence de térébenthine
SI rép an d u e d an s l’m d u s trie et qui, mêlée à l’alcool, p ro d u it l’essence
d éclairage ou Hydrogène liquide; le ré sid u de la d is tilla tio n est la
Colophane ou A rca n so n ; le g a lipot, fondu, et b ra ssé avee de l’eau
devient la Résiné ja u n e du commerce ; les ré sid u s de to u s les p ro d u its
p ré céd en ts, b rû le s dans u n e ch au d ière , d o n n en t la P o ix n o ire et le
Goudron; ces mêmes m atière s, b rû lée s d an s u n fo u rn e au a b o u tiss an t
a u n e ch am b re ou la fumée se condense en p o u d re imp a lp ab le, donn
e n t le N o ir de fum é e . A m b r e ja u n e ou Su c cin ou K a ra b ê e&i une
resme fossile, p ro v e n an t des lig n ite s du litto ra l de la Baltique. Les
p lu s b e au x fragm en ts so n t trav a illé s p o u r fa b riq u e r des b îja u x , des
tu y au x d e p ip e , etc. L e P é íro tó , sorte d e 'b itum e liq u id e , q u ’on trouve
(laiis les couches te rre s tre s c arb o n ifère s, a u ra it la . même; o rigine
foss.ile. , m ^
Linnée rap p o rte q u e les Lapons et les Esq u imau x , à défaut de céréales,
ch oisissent de jeunes sujets de P in u s sy lv e stris et de Picea
alba ; q u ’ils en d é tachent les couches in té rieu re s de l’écorco q u ’ils tor-
rifient lég è rem en t; q u ’ils réd u is en t ensuite cette écorce en farine dont
ils font des galettes p o u r le u r n o u rritu re .
C üLTDR E E ï M u l t i p l ic a t io n .. — A chaque espèce n o u s avons indiqué
les sols et les climats q u ’elle préfère. La m u ltip lic atio n se fait p a r le
semis, c’est le m e illeu r moyen, q u an d on possède des g raines. En
effet, p a r ce moyen, on est to u jo u rs sû r d ’o b ten ir des sujets p o rtan t
une flèche. A défaut de g raines, on a reco u rs à la b o ù tu re et à la
greffe ; mais, p o u r l’une comme p o u r l’au tre , on doit p re n d re l’ex tré mité
d ’u n individu, p ro v e n an t de g ra in e ; à défaut de cette précaution,
les in d iv id u s ob ten u s ne d o n n en t jamais on trè s ra rem e n t de tige
verticale. En term es.d e jard in ag e , on appelle m è re le su je t que l’on a
ainsi tro n q u é ; ce suje t est susceptible de d o n n e r indéfin imen t de
b onnes b o u tu re s ou de bons greffons. E n effet, cette mère dont on a
coupé la tige en p ro d u it p lu s ieu rs au tre s à sa place ; de p lu s, elle
p ro d u it d’au tre s b o u rg eo n s adventifs qui o n t la p ro p riété, eux aussi,
de p ro d u ire des tiges verticales.
Le semis se fait en. m ars-avril en p leine te rre , ou m ieu x en pots ou
en te rrin e s , en b onne te rre o rd in a ire ou m ieu x encore en te rre de
b ru y è re . A près la première année ou ap rès la deuxième on les repique
on p ép in iè re s ou en pot, p o u r les tra n sp la n te r et les relever., en motte
au p rin tem p s to u s les ans ou to u s les deux ans au plus. P a r le moyen
de ces rem an iem en ts, les ra cines se ram ifien t et la rep rise des a rb re s
est p lu s sû re lo rsq u ’ils so n t tran sp la n té s à le u r place définitive. Si
l’on a u n e serre ou des châssis, il est avan tag eu x de s ’en se rv ir p o u r
les p rem iè re s années de l’éducation.
Le b o u tu rag e se fa it au moyen de flèches, au p rin tem p s ou a
l’automne, c’e s t-à -d ire en fé v rie r-m a rs ou e n ao û t-s ep tem b re . Los
ram e au x do iv en t être b ien aoûtés ; on les pique dans do petits
p o ts ou des te rrin e s remplies de te rre de b ru y è re sablonneuse ot
que l’on place sous cloche dans u n e serre à m u ltip lic a tio n . Lorsque
les b o u tu re s so n t enracinées, on les rep iq u e isolément on les m a in ten
a n t sous cloche p o u r faciliter la rep rise. Ce n ’est que lo rsq
u ’elles on t acquis u n développement suffisant q u ’on les tran sp lan te
on p épinière.
, ■ Le greffage se fait aux époques in diquées p o u r le b o u tu rag e et avee
les-mêmes p ré cau tio n s. P lu s ie u rs modes so n t employés a cet effet :
Sous v e rre , la greffe en placage, qu i se fait su r des p lan ts élevés en
pot. En p leine te rre , on ad o ptera : La greffe su r bo u rg eo n te rm in a l,
qui se p ra tiq u e , en avril-mai, a lo rs que les b o u rg eo n s d u su je t comm
en c en t à gonfler, avec u n greffon de l’année précédente, su rm o n té
de ses y eu x te rm in a u x . On p e u t aussi op é rer p a r la greffe en tente