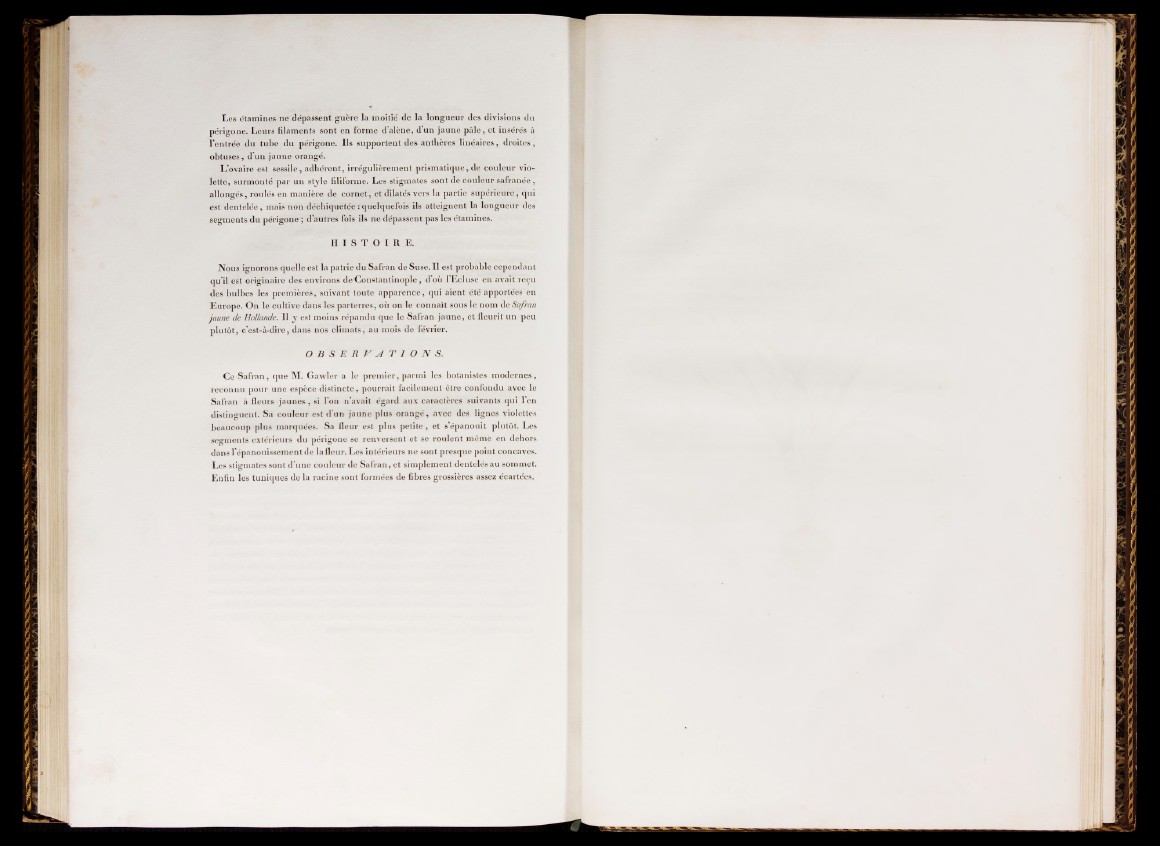
Les e'tamines ne dépassent guère la moitié de la longueur des divisions du
périgone. Leurs filaments sont en forme d’alène, d’un jaune p â le , et insérés à
l ’entrée du tube du périgone. Ils supportent des anthères linéaires, droites,
obtuses, d’un jaune orangé.
L ’ovaire est sessile, adhérent, irrégulièrement prismatique, de couleur violette,
surmonté par un style filiforme. Les stigmates sont de couleur sa franée,
allongés, roulés en manière de cornet, et dilatés vers la partie supérieure, qui
est dentelée, mais non déchiquetée : quelquefois ils atteignent la longueur des
segments du périgone ; d’autres fois ils ne dépassent pas les étamines.
H I S T O I R E .
Nous ignorons quelle est la patrie du Safran de Suse. Il est probable cependant
qu’il est originaire des environs de C onstantinople, d’où 1 Ecluse en avait reçu
des bulbes les premières, suivant toute apparence, qui aient été apportées en
Europe. On le cultive dans les parterres, où on le connaît sous le nom de Safran
jaune de Hollande. Il y est moins répandu que le Safran jau n e , et fleurit un peu
plutôt, c’est-à-dire, dans nos climats, au mois de février.
O B S E R V A T I O N S .
Ce S afran , que M . G awler a le premier, parmi les botanistes modernes,
reconnu pour une espèce distincte, pourrait facilement être confondu avec le
Safran à fleurs jau n e s , si l’on n’avait égard aux caractères suivants qui l’en
distinguent. Sa couleur est d’un jaune plus o rangé , avec des lignes violettes
beaucoup plus marquées. Sa fleur est plus p e tite , et s’épanouit plutôt. Les
segments extérieurs du périgone se renversent et se roulent même en dehors
dans l’épanouissement de la fleur. L es intérieurs ne sont presque point concaves.
Les stigmates sont d’une couleur de S a fran , et simplement dentelés au sommet.
Enfin les tuniques de la racine sont formées de fibres grossières assez écartées.