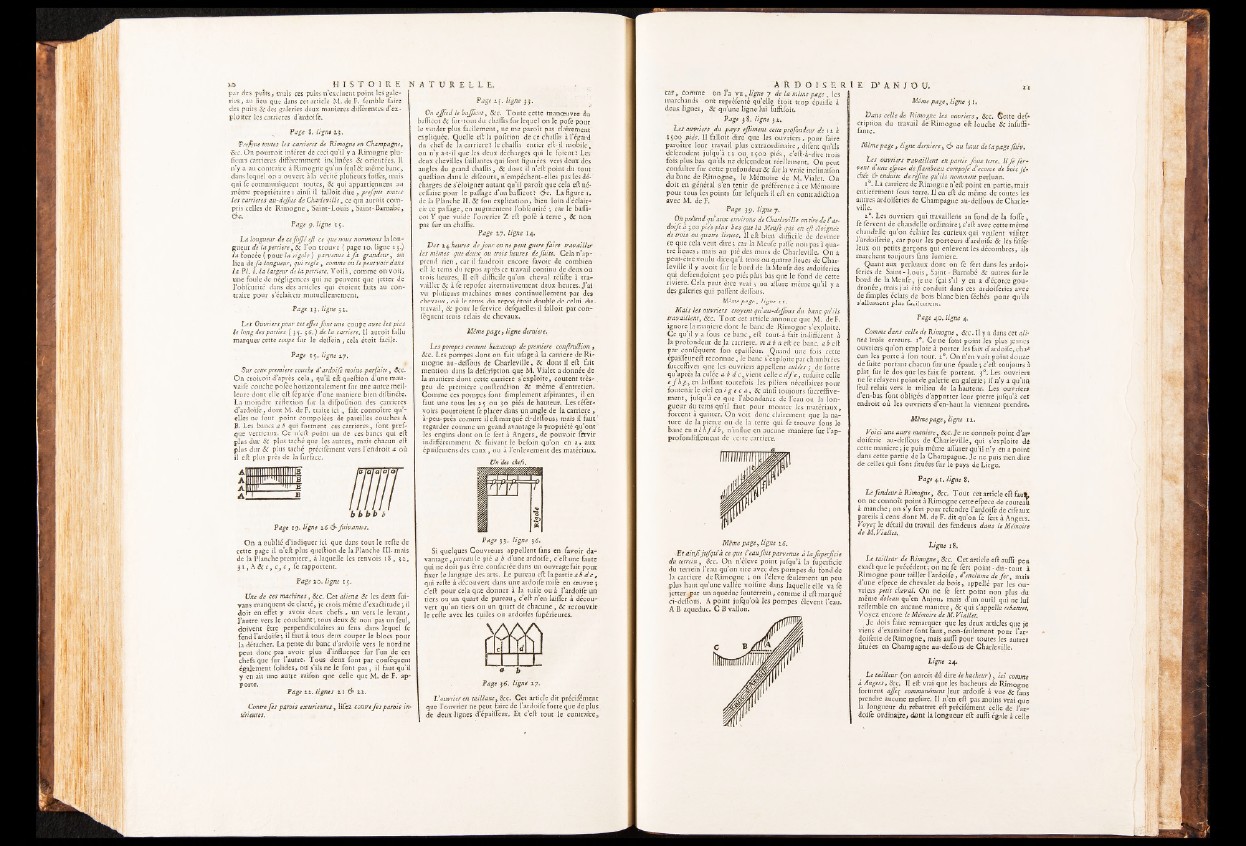
W5 ^ H I S T O I R E
par des puits, mais ces puits n’excluent point lcà galeries,
au lieu que dans cet article M. de F. femble faire
■ des puits &r des galeries deux maniérés différentes d’exploiter
les carrières d ardoife.
Page 8, ligna 43,
P refait toutes les carrières de Rimogne en Champagne,
■ &c. On pourroit inférer de ceci qu’ ii y a Rimogne plu-
fieurs carrières différemment inclinées & orientées. Il
n’y a au contraire à Rimogrie qu’un feul & meme banc,
. dans lequel on a ouvert à la vérité plufîeurs toffes, mais
qui fe communiquent toutes, & qui appartiennent au
même propriétaire : ainfi il falloit dite, prejque toutes
les carrières au-deffus de Charleville, ce qui auroit compris
celles de Rimogne, Saint-Louis, Saint-Barnabe,
&c.
Page è>. ligne 1 ç.
La longueur de cefojjé ejl ce que mus nommons la longueur
de laperriere, 8c l’on trouve ( page io . ligne 23.)
la foncée (p our la rigole ) parvenue à fa grandeur, au
lieu defa longueur, qui réglé, comme on le peut voir dans
la PI. I. la largeur delà perriere. Vo ilà , comme on voit,
une foule de négligences qui ne peuvent que jetter de
l ’obfcurité dans des articles qui étoient faits au contraire
pour s’éclaircir mutuellemement.
Page 1 3. ligne 3 1.
Les Ouvriers pour cet effet font une coupe avec les pics
le long des parties ( 3 f. 36'.) de la carrière. Il auroit fallu
marquer cette coupe fur le deffein, cela .étoit facile.
Page i~y. ligne 27.
Sur cette première couche d.'ardoife moins parfaite, 8cc.
On croiroit d’après cela, qu’il eft queftion d’une mau-
vaife couche pofee horizontalement fur une autre meilleure
dont elle eft féparée d’ une maniéré bien diflinéfce.
La moindre réflexion fur la difpofîtion des carrières
d’ardoife, dont M. de F. traite ici , fait connoître qu’elles
ne font point compofées de pareilles couches A
B. Les bancs a b qui forment ces carrières, font pref-
que verticaux. Ce 11’cft point un de ces bancs qui eft
plus dur 8c plus taché que les autres, mais chacun eft
plus dur 8c plus taché précifément vers l’endroit a où
il eft plus près de la furface.
Page ip. ligne 16 & fuivantes.
N A T U R E L L E . -
On a oublié d’indiquer ici que dans tout le refte de
cette page il n’eft plus queftion de la Planche III. mais
de la Planche première, à laquelle les renvois 18 , 32 ,
3 1 , A 8c c , c , c , fe rapportent.
Page 20. ligne 1 c.
Une de ces machines, & c. Cet aliéna 8c les deux fui-
vans manquent de clarté, je crois même d’exaétitude ; il
doit en effet y avoir deux chefs , un vers le levant,
l’autre vers le couchant-, tous deux & non pas un feul,
doivent être perpendiculaires au fëns dans lequel fe
fend l’ardoife ; il faut à tous deux couper le blocs pour
la détacher. La pente du banc d’ ardoife vers le nord ne
peut donc pas avoir plus d’influence fur l’un de ces
chefs que fur l’autre. Tous deux font par conféquent
egalement folides, otf s’ils ne le font pas, il faut qu’ il
y en ait uno autre raifon que celle que M. de F. apporte.
Page 22. lignes 1 1 & 22.
Contre fe s parois extérieures , lifez contre fe s parois intérieures.
Page 2 f . ligne 35.
On ajfted lebajjicot, &c. Toute cette manoeuvre du
baflicot 8c fur-tout du chalfis fur lequel on le pofe pour
le vuider plus facilement, ne me paroît pas clairement'
expliquée. Quelle eft la pofition de ce chaffis à l’égard
du chef de la carrière? le chaffis entier eft-il mobile,
ou n’y a-t-il que les deux décharges qui le fôientî Les
deux chevilles faillantes qui font figurées vers deux des
angles du grand chaffis, & dont il n’ eft point du tout
queftion dans le difeours, n’empêchcnt-clles pas les décharges
de s’éloigner autant qu’il paroît que cela eft né-
ceffaire pour le paffage d’un baflicot? dre. La figurer,
de la Planche II. 8c fon explication, bien loin d’éclaircir
ce partage, en augmentent l’obfcurité ; car le baflicot
Y que vuide l’ouvrier Z eft pofé à terre , 8c non
pas fur un chaffis.
Page 27. ligne 14 .
Des 24 heures de jour on ne peut guère fa ire travailler
les mêmes que deux ou trois heures de fuite. Cela n’apprend
rien , car il faudroit encore favoir de combien
eft le tems du repos après ce travail continu de deux ou
trois heures. Il eft difficile qu’un cheval refifte à travailler
& à fe repofer alternativement deux heures. J ’ai
vu plufîeurs machines mues continuellement par des
chevaux, où le tems du repos étoit double de celui du ■
travail, 8c pour le fervice defquclles il falloit par conféquent
trois relais de chevaux.
Même page, ligne derniere,
Les pompes coûtent beaucoup de première conflrucHon »
&c. Les pompes donc on fait ufage à la carrière de R imogne
au-deffoiis de Charleville, 8c dont il eft fait
mention dans la defeription que M. Vialet adonnée de
la maniéré dont cette carrière s’exploite, coûtent très-,
peu de première conftruéfcion 8c même d’entretien.
Comme ces pompes font Amplement afpirantes, il en
faut une tous les 2^ ou 30 piés de hauteur. Les réfer-
voirs pourroient fe placer dans un angle de la carrière ,
à-peu-près comme il eft marqué ci-deffous-, mais il faut’
regarder comme un grand avantage la propriété qu’ont '
les engins dont on fe fert à Angers, de pouvoir fièrvir
indifféremment 8c fuivanc le befoin qu’on en a , aux
épuifèmens des eaux, ou à l’enlevement des matériaux.
Un des chefs.
Page 33. ligne 36.
Si quelques Couvreurs appellent fans en favoir davantage
, pureau le pié a b d’une ardoife, c’eftune faute
qui ne doit pas être.confacrée dans un ouvrage fait pour
fixer le langage des arts. Le pureau eft la partie a b d c ,
qui refte à découvert dans une ardoife mife en oeuvre ;
c’eft pour cela que donner à la tuile ou à l’ardoife un
tiers ou un quart de pureau, c’eft n’en laiffer à découvert
qu’un tiers ou un quart de chacune, 8c recouvrir
le refte avec les tuiles ou ardoifes fupérieures.
a b
Page 3 6. ligné 27.
L’ouvrier en taillant, 8cc. Cet article dit précifément
que l’ouvrier ne peut faire de l’ardoife forte que déplus
de deux lignes d’épaiffeur. Et c’eft tout le contraire,
A R D O i S Ë R U
Càf, Comme bn l‘a Vu , ligne 7 de la même page , les
marchands ont repréfentè qifelle étoit trop épaiflè à
deux lignes, 8c qu’une ligne lui îiifïifoit.
Page 38. ligne 32.
L ei ouvriers du pays ejliment cette profondeur de 12 d
I f 00 piés. 11 falloir dire que les ouvriers, pour faire
paroître leur travail plus extraordinaire, difent qu’ils
descendent jufqu’à 12 ou i fo o piés ,efeft-à-dirc trois
fois plus bas qu’ils ne defeendent réellement, On peut
Confulter fur cette profondeur 8c fur la vraie indinaifon
du banc de Rimogne, le Mémoire de M. Vialet. On
doit en général s’en tenir de préférence à ce Mémoire
pour tous les points fur lefqueïs il eft en contradiction
aVec M. de F,
Page J«), ligne 7,
On prétendyiîaux environs de Charleville on dre de l 'ardoife
à 5 00 piés plus bas que la Meûfe qui eh eft éloignée
de trois ou quatre lieues. Il eft bien difficile de deviner
ce que cela veut dire *, car la Meufe paffe non pas à quatre
lieues, mais au pié des murs de Charleville. On a
peut-être voulu direqu a trois ou quatre lieues deGhar-
leville il y avoit fur le bord de la Meufe des ardoiferies
qu^ defeendoient 300 piés plus bas que le fond de cette
riviere. Cela petit être vrai ; on affine même qu’il y a
des galeries qui paflènt deffous,
Même page -, ligne 1 r.
Mais les ouvriers crôyent qiéau-deffous du banc qu’ils
travaillent, 8cc. Tout cet article annonce que M. de F.
ignore la maniéré dont le banc de Rimogne s’exploite.
Ce qu’il y a fous ce banc, eft tout-à feit indifférent à
la profondeur de la carrière, m a b n eft ce banc, a b eft
par conféquent fon epaillèur. Quand une fois cette
epaiflèureft reconnue, le banc s’ exploite par chambrées
fucceflives que les ouvriers appellent culées ; de forte
qu après la culée a b d e , vient celle c d f e , enfuice celle
c f h g , en laiflànt toutefois les piliers néceflàires pour
foutenir le ciel en i g e c a, 8c ainfi toujours fucceffivc-
ment, jufqu’à ce que l’abondance de l’eau ou la longueur
du tems qu’il faut pour monter les matériaux,
Forcent à quitter. On voit donc clairement que la nature
de la pierre ou de la terre qui fè trouve foiis le
banc en ni hfdb, n’influe en aucune maniéré fur l’ap-
profondiflement de cette carrière.
Même pâge, ligne 16 .
-Et a in f jüfqiéà ce que l'eau fo it parvenue à la Jiiperficie
du terrein, 8cc. On n’éleve point jufqu’à la luperficie
du terrein l’eau qu’ on tire avec des pompes du fond de
la carrière de Rimogne ; on l’éleve feulement un peu
.plus haut qu’une vallée voifine dans laquelle elle va fè
jetter jp a r un aqueduc fouterrein, comme il eft marque
ci-defîous. A point jufqu’où les pompes élevent l’eau.
A B aqueduc. C B vallon.
D* A N J O U, xi
Même page, ligne 3 1 »
p a n s celle de Rimogne les ouvriers, 8cc. Çettê defc
cription du travail de Rimogne eft louche & infuffi»
fànte.
Même page, ligne derhiere, & au haut de la page Jîiiv .
'Les ouvriers travaillent en partie fous tene. IL fe fe r-
vent d'une ejpeca defiambeaa compoje d’ecorce de bois jé -
ckée & enduite derefne qu’ils nomment petluau.
i° . Là carrière de Rimogne n eft point en partie, mais
entièrement fous terre. Il en eft de même de toutes lei
àüctes àrdoifèries de Champagne ali-deffous de Charleville.
2°, Les ouvriers qui travaillent au fond de la Foffe,
fe fervent de chandelle ordinaire; e’eft avec cette même
chandelle qu’on éclaire les cürieux qui veulent vifïter
lardoiferie, câr pour les porteurs d’ardoife 8c les faife-
leux ou petits garçons qui enlèvent les décombres, ils
marchent toujours fans lumière.
Quant aux perluaux dont on fe fert dans les ardoiferies
de Saint-Louis, Saint - Barnabe 8c autres furie
bord de là Melife, je ne fçai s’il y en a d’éedree gôu-
dronée, mais j’ai été conduit dans ces ardoiferies avec
de Amples éclats de bois blanc bien féchcs pour qu’ils
s’allument plus facilement,
Page 40. ligne 4,
Comme dans celle de Rimogne, 8cc. il y a dans cet ali*
neà trois erreurs. i° . Ce rte foht point les plus jeunes
ouvriers qu’on emploie à porter les faix d’ardoife, cha*
cun les porte à fon tour. 20. On n’en Voit point douze
de fuite portant chacun fur une épaule ; c’eft toujours à
plàt fur le dos que les faix fe portent. 30. Les ouvriers
ne fe relayent point de galerie en galerie ; il n’y a qu’un
feul relais vers le milieu de la hauteur. Les ouvriers
d’en-bas font obligés d’apporter leur pierre jufqu’à cet
endroit où les ouvriers a en-haut,la viennent prendre.
Même page, ligne 1 i .
Voici une autre maniéré, ôec. J e ne comtois point d’atr
doiferie au-deflous de Charleville, qui s’exploite de
cette maniéré; je puis même affurer qu’il n’y en a point
dans cette partie de la Champagne. J e ne puis rien dire
de celles qui font fîcuées fur le pays de Licge.
Page 4 1 . ligne 8.
Le fendeùra Rimogne , 8cc. Tout cét article eft faut,
on ne connoît point à Rimogne cette cfpece de couteau
à manche; on s’y fert pour refendre l’ardoife de cifeaux
pareils à ceux dont M. de F. dit qu’on fe fert à Angers.
Voyei le détail du travail des fendeurs dans le Mémoire
de M.Viallet,,
Ligne îS ,
Le tailleur de Rimogne , '8cc. Cet article eft auffi peu
exaét que le précédent; on ne.fe feft point-du-tout à
Rimogne pour tailler I’ardoife, d’enclume de fe r, mais
d’ une efpece de chevalet de bo is, appellé par les ouvriers
petit cheval. On ne fe fert point non plus du
même doleau qu’en Anjou, mais d’un outil qui ne lui
reflemble en aucune maniéré, & qui s’appelle rebattret,
Voyez encore le Mémoire de M. Viallet.
J e dois faire remarquer que les deux articles que je
viens d’examiner font feux, non-feulèment pour l’ar-
doiferie de Rimogne, mais auffi pour toutes les autres
fituces en Champagne au-deffous de Charleville.
Ligne 24.
Le tailleur (on auroit dû dire le hachetir) , ic i comme
à Angers, 8cc. Il eft vrai que les hacheurs de Rimogne
forment ajfe[ communément leur ardoife à vue 8c fans
prendre aucune mefüre. Il n’en eft pas moins vrai que
la longueur du rebattret eft précifément celle de l’ar-
doifè ordinaire# dont la longueur eft auffi égale à celle