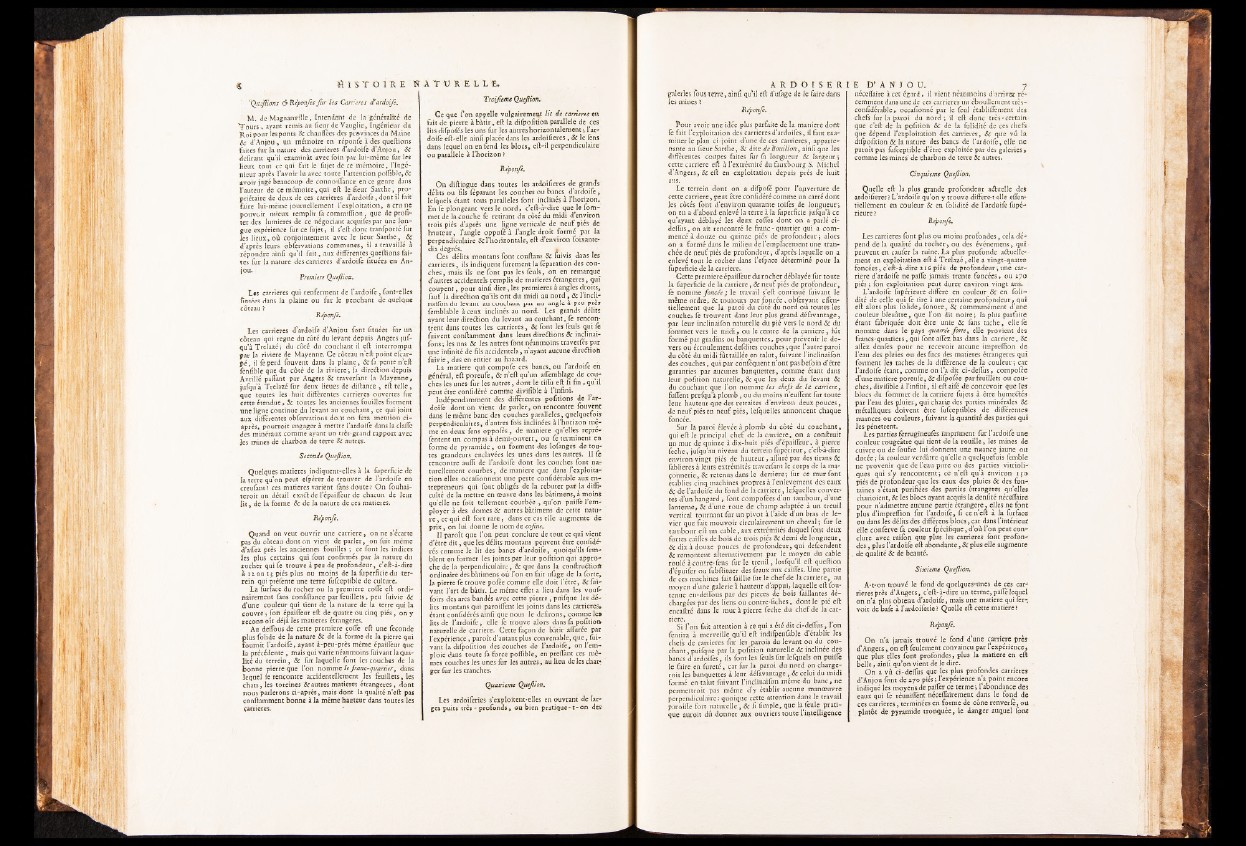
« H i s t o i r e n a t u r e l l e .
'Qtlefiions &Réponfes fu ries Carrières etardoife.
ï M. de Magnanville, Intendant de la'généralité de
Tours-, ayant remis au fieur de Vauglie, Ingénieur du
R o i pour lespdnts 8c chauffées des provinces du Maine 6c d’Anjou-, un mémoire en réponfe à des queftions
Elites fur la nature des carrières d’ardoife d’Anjou, &
délirant qu’il examinât avec foin par lui-même fur les
lieux tout ce qui fait le fitjet de ce mémoire, l’ Ingc-
nieur après l’avoir lu avec toute l’attention poflîble,&
avoir jugé beaucoup de connoiUance en ce genre dans
l ’auteur de ce mémoire, qui eft le fieur Sarthe, propriétaire
de deux de ces carrières d’ ardoife, dont il fait
faire lui-même journellement l’exploitation, a cru ne
pouvoir mieux remplir la commiflion, que de profiter
des lumières de ce négociant acquifes par une longue
expérience fur ce fujet, il s’eft donc tranfporte lur
les lieux, où conjointement avec le fieur Sarthe, &
d’après leurs obfèrvations communes, il a travaillé à
répondre ainfi qu’ il fuit, aux différentes queftions faites
fur la nature des carrières d’ardoifè fituées en Anjou.
,Première Quefiion.
Les carrières qui renferment de fardoifc , font-elles
îîcuées dans la plaine ou fur le penchant de quelque
coteau ? ' ;
Réponfe.
Les carrières d’ardoifè d’Anjou font fituées fur un
coteau qui régné du côté du levant depuis Angers juf-
qu’à Trelazé; du côté du couchant il eft interrompu
par la riviere de Mayenne. Gc coteau n’eft point efear-
p é , il fè perd fouvent dans la plaine, & fa pente n’eft
fenfible que du côté de la riviere ; fa dire&ion depuis
Avrillé paflànt par Angers & traverlànt la Mayenne,
jufqu’à Trelazé fur deux lieues de diftance , eft telle,
que toutes les huit différentes carrières ouvertes’ fur
cette étendue, & toutes les anciennes fouilles forment
une ligne continue du levant au couchant, ce qui joint
aux différentes obfèrvations dont on fera mention c i-
après, pourroit engager à mettre l’ardoife dans la claffè
des minéraux comme ayant un très-grand rapport avec
ics mines de charbon de terre 8c autres.
Seconde Quefiion.
Quelques matières indiquent-elles à la fuperficie de
la terre qu’on peut efpérer de trouver de l’ardoifè en
creufànt? ces matières varient fans doute? On fouhai-
teroit un détail exaét de l’épaiffeur de chacun de leur
l i t , de la forme & de la nature de ces.matières.
Réponfe.
Quand on veut ouvrir une carrière, on ne s’écarte
pas du coteau dont on vient de parler, on fuit même
d’affez près les anciennes fouilles ; ce font les indices
les plus certains qui font confirmés par la nature du
rocher qui fe trouve à peu de profondeur, c’eft-à-dire
à 1 2 ou 13 piés plus ou moins de la fuperficie du ter-
rein qui préfente une terre fufceptible de culture.
L a furface du rocher ou la première code eft ordinairement
fans confiftance par feuillets, peu fuivie &
d’une couleur qui tient de la nature de la terre qui la
couvre s fon épaiffeur eft de quatre ou cinq piés, on y
reconnoît déjà les matières étrangères.
Au deffous de cette première coffe eft une fécondé
plus folide de la nature & de la forme de la pierre qui
fournit l’ardoifè, ayant à-peu-près même épaifïèur que
la précédente , mais qui varie néanmoins fuivant la qualité
du terrein, 8c fur laquelle font les couches de la
bonne pierre que l’on nomme le franc-quartier, dans
lequel fe rencontre accidentellement les feuillets, les
chats, les toreincs 8c autres matières étrangères, dont
nous parlerons ci-après, mais dont la qualité n’eft pas
conftamment bonne à la même hauteur dans toutes les
carrières.
Troi/teme Quefiion.
C e que fo n appelle vulgairement de carrières en
fait de pierre à bâtir, eft la difpofition parallèle de ces
lits difpofés les uns fur les autres horizontalement; l’ar-
doifè eft-élle ainfi. placée dans les ardoificres , & le fens
dans lequel on en fend les blocs, eft-il perpendiculaire
ou parallèle à l’horizon ?
Réponfe*
On diftingue dans toutes les ardoificres de grands
délits ou fils féparaht les couches ou bancs d’ardoife,
lefquels étant tous parallèles font inclinés à l’horizon.
En fe plongeant vers le nord, c’ eft-à-dire quelle fom-
met de la-couche fè retirant du côté du midi d’environ
trois piés d’après une ligne verticale de neuf piés de
hauteur, l’angle oppofe à l’angle droit forme par la
perpendiculaire & l’horizontale, eft d’environ foixante-
dix degrés. •
Ces délits montans font conftans 8c fuivis dans les
carrières, ils indiquent furement la feparation des couches
, mais ils ne font pas les fèuls, on en remarque
d’autres accidentels remplis de matières étrangères, qui
coupent, pour ainfi dire, les premières à angles droits,
fàuf la direction qu’ils ont du midi au nord , 8c l’incli-
naifon du levant au couchant par un angle à-peu-près
femblable à ceux inclinés au nord. Les grands délits
ayant leur direction du levant au couchant, fè rencon*
trent dans toutes les carrières, & font les feuls qui fè
fuivent conftamment dans leurs directions 8c inclinaisons
; les uns 8c les autres font néanmoins traverfés par
une infinité de fils accidentels, n’ayant aucune diredtioh
fuivie, dus en entier au hazard.
La matière qui compofe ces bancs, ou l’ardoife eh
général, eft poreufè, & n’eft qu’un affemblage de couches
les unes fur les autres, dont le tifTu eft fi fin , qu il
peut être confidéré .comme divifible à l’infini. ^
Indépendamment des différentes pofitions de l’ardoifè
dont on vient de parler, on rencontre fouvènt
dans le même banc des couches parallèles, quelquefois
perpendiculaires, d’autres fois inclinées à l’horizon meme
en deux fens oppofés, de manière qu’elles repré-
fèntent un compas à demi-ouvert, ou fè terminent en
forme de pyramide, ou forment des lofanges de toutes
grandeurs enclavées les unes dans les autres. Il fè
rencontre aufli de l’ardoifè dont les couches font nar
turellement courbes, de maniéré que dans l’exploitar
tion elles occafionnent une perte confidérable aux entrepreneurs
qui font obligés de la rebuter par la difficulté
de la mettre en oeuvre dans les bâtimens, à moins
qu’elle ne foit tellement courbée , qu’on puiflè l’employer
à des dômes 8c autres bâtimens de cette nature
, ce qui eft fort ra re , dans ce cas elle augmente de
pr ix , on lui donne le nom de cofine.
U paroît que l’on peut conclure de tout ce qui vient
d’être d it, que les délits montans peuvent être confidé-
rés comme le lit des bancs d’ardoifè, quoiqu’ils fem-
blent en former les joints par leur pofition qui approche
de la perpendiculaire, 8c que dans la conftruétiort
ordinaire des bâtimens où l’on en fait ufàge de la forte,
la pierre fe trouve pofée comme elle doit l’être, 8c fuivant
l’art de bâtir. Le même effet a lieu dans les vouf-
foirs des arcs bandés avec cette pierre, puifque les délits
montans qui paroiflènt les joints dans les carrières,
étant confidérés ainfi que nous le délirons, comme le»
lits de l’ardoife, elle fè trouve alors dans là pofitioiv
naturelle de carrière. Cette façon de bâtir affurée par
l’expérience, paroît d’autant plus convenable, que, fui-,
vant la difpofition des couches de l’ardoifè, on l’emploie
dans toute fâ force poffible, en preflànt ces mêmes
couches les unes fur les autres, au lieu de les charger
fur les tranches.
Quatrième Quefiion.
Les ardoifèries s’exploitent-elles en ouvrant de larges
puits très - profonds, ou bien pratique-1- on des
À R D O î S Ë R
galeries foûs terre, ainfi qu’ il eft d’ufàge de le faire dans
les mines ?
Réponfe.
Pour avoir une idée plus parfaite de la manière dont
fè fait l’exploitation des carrières d’ardoifès, il faut examiner
le plan ci-joint d ’une de ces carrières, appartenante
au fieur Sarthe, 8c dite de Bouillon, ainfi que les
différentes coupes faites fur fâ longueur & largeur 3
cette carrière eft à l’extrémité du fauxbourg S'. Michel
d’Angers, & eft en exploitation depuis près de huit
ans.
Le terrein dont on a difpofe pour I’ovuvcrtüre de
cette carrière, peut être confidéré comme un carré dont
les côtés font d’environ quarante toifès de longueur;
on en a d’abord enlevé la terre à la fuperficie jufqu’à ce
qu’ayant déblayé les deux coftès dont on a parlé ci-
deflùs, on ait rencontré le franc - quartier qui a commencé
à douze ou quinze piés de profondeur ; alors
on a formé dans le milieu de l’emplacement une tranchée
de neuf piés de profondeur, d’après laquelle on a
enlevé tout le rocher dans l’efpace déterminé pour la
fuperficie de la carrière.
Cette première épaiffeur du rocher déblayée fur toute
la fuperficie de la carrière, & neuf piés de profondeur,
fe nomme foncée le travail s’eft continué fuivant le
même ordre, 8c toujours par foncée, obfèrvant effen-
tiellement que la paroi du côté du nord où toutes les
couche» fè trouvent dans leur plus grand défavantage,
par leur inclinaifon naturelle du pié vers le nord 8c du
fommet vers le midi, ou le centre de la carrière, fût
formé par gradins ou banquettes, pour prévenir le devers
ou écroulement defdites couches ; que l’ autre paroi
du côté du midi fût taillée en talut, fuivant l’inclinaifon
des couches, qui par confisquent n’ont pas befoin d’être
garanties par aucunes banquettes, comme étant dans
leur pofition naturelle, & que les deux du levant 8c
du couchant que fo n nomme les chefs de la carrière,
fuffent prefqu’à plomb, ou du moins n’euflent fur toute
leur hauteur que des retraites d’environ deux pouces,
de neuf piés en neuf piés, lefquelles annoncent chaque
foncée.
Sur lâ paroi élevée à plomb du côté du couchant,
qui eft le principal chef de la carrière, on a conftruit
un mur de quinze à dix-huit piés d’épaiflèur, à pierre
feche, jufqu’au niveau du terrein fupérieur, c’eft-à-dire
environ vingt piés de hauteur, affuré par des tirans 8c
fablieres à leurs extrémités traverfant le corps de la maçonnerie
, & retenus dans le derrière; fur ce mur font
établies cinq machines propres à l’enlevement des eaux 8c de l’ardoifé du fond de la carrière, lefquelles couverte^
d’un hangard, font compofees d’un tambour, d’une
lanterne, 8c d’une roue de champ adaptée à un treuil
vertical tournant fur un pivot à l’aide d’un bras de levier
que fait mouvoir circulairement un cheval ; fur le
tambour eft un cable, aux extrémités duquel font deux
fortes caiffes de bois de trois piés 8c demi de longueur,
& dix à douze pouces de profondeur, qui defeendent 8c remontent alternativement par le, moyen du cable
roulé à contre-fèns fur le treuil, lorfqu’il eft queftion
cfépuifer ou fubftitùer des féaux aux caiffes. Une partie
de ces machines fait faillie fur le chef de la carrière, au
moyen d’une galerie i hauteur d’appui, laquelle eft fou-
tenue en-deffous par des pièces de bois {aillantes déchargées
par des liens ou contre-fiches, dont le pie eft
cncaftré dans le mur à pierre feche du chef de la carrière.
t
Si fo n fait attention à ce qui a été dit ci-deffus, 1 on
fèntira à merveille qu’il eft indifpenfàble d’établir les
chefs de carrières fur les parois du levant ou du couchant
, puifque par la pofition naturelle 8c inclinée des
bancs d’ardoifes, ils font les feuls fur lefquels on puiffe
le faire en fureté, car fur la paroi du nord on charge-
roit les banquettes à leur défavantage,, 8c celui du midi
formé en talut fuivant l’ inclinaifon même du banc, ne
permettroit pas même d’y établir aucune manoeuvre
perpendiculaire: quoique cette attention dans le travail
paroifle fort naturelle , & fi fimple, que la feule pratique
auroit dû donner aux ouvriers toute 1 intelligence
Ë D’ A Nî O Ü. 7
neceftaire à cet égard, il vient néanmoins d arriver rc*
cemment dans une de ces carrières un cboullement très-
confidérable, occafionné par le feul établifièment des
chefs fur la paroi du nord ; il eft donc très-certain'
que c’eft de la pofition 8c de la fblidité de ces chefs
que dépend l’exploitation des carrières, & que vû la
difpofition 8c la nature des bancs de l’ardoife, elle ne
paroît pas fufceptible d’être exploitée par des galeries#
comme les mines' de charbon de terre 8c autres.
Cinquième Qaefii&n»
Quelle eft la plus grande profondeur atftüelle deà
ardoifieres? L’ardoifè qu’on y trouve differe-t-elle eflèn*
tiellcment en couleur 8c en fblidité de l’ardoife fupé-
rieurc ?
Réponfe.
Les carrières font plus oü moins profondes, cela dé*
pend dé la qualité du tocher, ou des événemens, qui
peuvent en caufer la ruine. La plus profonde aétuelle*
ment en exploitation eft à T relazé, elle a vingt-quatre
foncées» c’eft-à-dire i \6 piés de profondeur ; une carrière
d’ardoife nepaffe jamais trente foncées, ou 2-70
piés ; fon exploitation peut durer environ vingt ans.
L’ardoifè fupérieure diffère en couleur & en fo li- -
dité de celle qui fè tire à une certaine profondeur, qui
eft alors plus folide, fonore, 8c communément d’une
couleur bleuâtre, que l’on dit noire; la plus parfaite
étant fabriquée doit être unie 8c fans tâche, elle fe
nomme dans le pays quarrée forte, elle provient dés
francs-quartiers, qui font afièz bas dans la carrière, 8c
affez denfès pour ne recevoir aucune impreffion de
l’eau des pluies ou des fucs des matières étrangères qui
forment les taches de la différence de la couleur ; car
l’ardoife étant, comme on l’a dit ci-deffus, compofée
d’une matière poreufè, 8c difpofée par feuillets ou cou*
ches,divifible à l’infini, il eft aife de concevoir que les
blocs du fommet de la carrière fujets à être humeétés •
par l’eau des pluies, qui chât ie des parties minérales 8c
métalliques doivent être fufceptibles de différentes
nuances ou couleurs, fuivant la quantité des parties qui
les pénètrent.
Les parties fèrrugineufès impriment fur I’ardoifè une
couleur rougeâtre qui tient de la rouille * les mines de
cuivre ou de foufre lui donnent une nuance jaune ou
dorée ; la couleur verdâtre quelle a quelquefois fèmble
ne provenir que de l’eau pure ou des parties vitrioli-'
ques qui s’y rencontrent; ce n’eft qu’à environ 1 fo
piés de profondeur que les eaux des pluies 8c des fontaines
s’étant purifiées des parties étrangères qu’elles
charioient, 8c les blocs ayant acquis la denfité néceflàire
pour n’admettre aucune partie étrangère, elles ne font
plus d’impreflîon fur l’ardoife, fi ce n’eft à la furface
ou dans les délits des différens blocs, car dans l’intérieur
elle confcrve fà couleur fpécifique, d’où l’on peut conclure
avec raifon que plus les carrières font profondes
, plus l’ardoifè eft abondante, & plus elle augmente
.. de qualité 8c de beauté.
Sixième Quefiion«
À-tron trouvé le fond de quelques-unes de ces carrières
près d’Angers, c’eft-à-dire un terme,paffélequel
on n’â plus obtenu d’ardoifè, mais une matière quifèr-
voit de bafe à l’ardoiferic? Quelle eft cette matière?
Réponfe.
On n’â jamais trouvé le fond d'une carrière près
d’Angers, on eft feulement convaincu par l'expérience#
que plus elles font profondes, plus la matière en eft
belle, ainfi qu’on vient de le dire.
On a vû ci-deffus que les plus profondes carrières
d’Anjou font de 270 piés ; l'expérience n’a point encoro
indiqué les moyens de paffer ce terme ; l’abondance des
eaux qui fe réunifient néceffairement dans le fond de
ces carrières, terminées en forme de cône renverfé, ou
plutôt de pyramide tronquée, le danger auquel fpmc