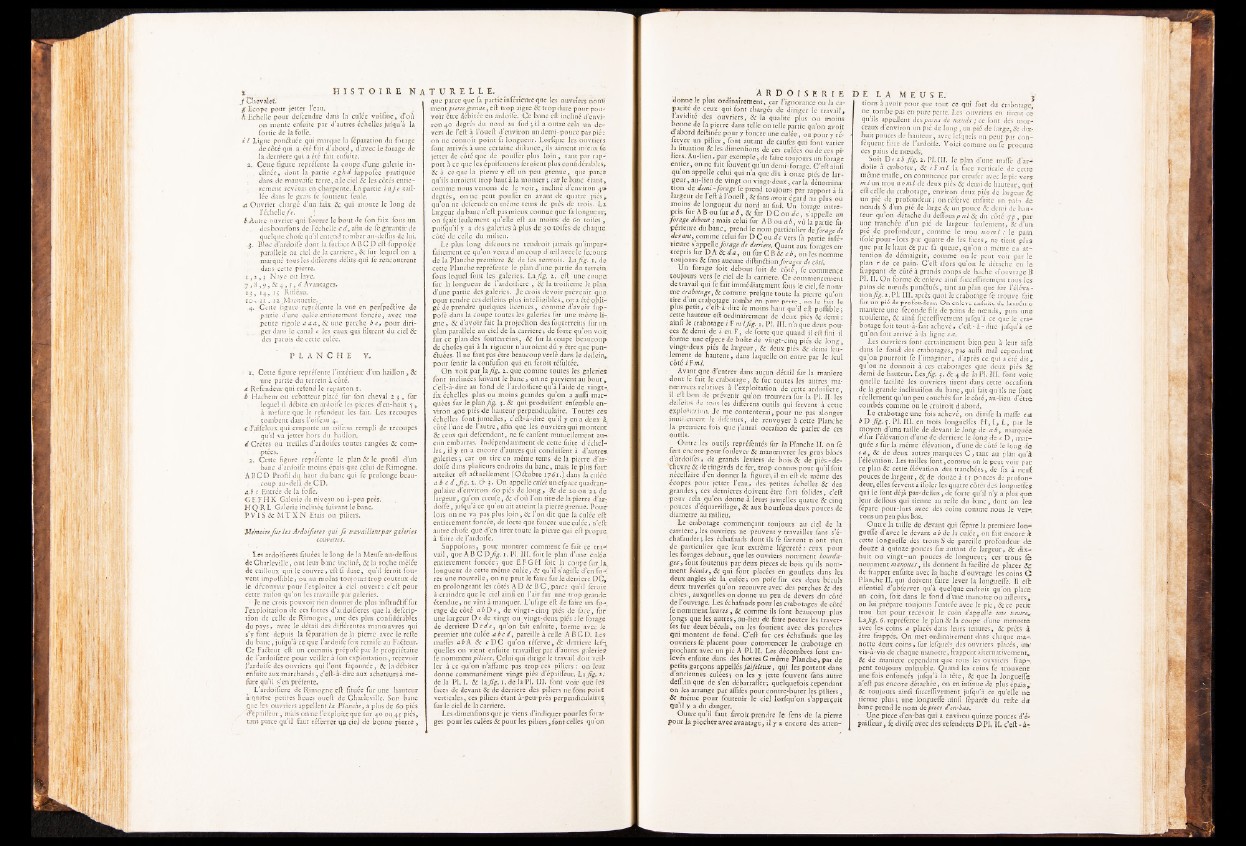
i h i s t o i r e n a t u r e l l e . J Chevalet. g Ecope pour jet ter l’eau. m Echelle pour defcendre dans la culée voifine, d’où
on monte enfuite par d’autres échelles julqu’à la
fortie de la folle.
* l Ligne pon&uée qui marque la réparation du forage
de côté qui a été-fait d’abord, d’avec le forage de
la derniere qui a été fait enfuite.
a. Cette figure reprélènte la coupe d’une galerie in-
. clinée, dont la partie cghd fuppofée pratiquée
dans de mauvailè terre, a le ciel & les côtés entièrement
revêtus en charpente. La partie Infe taillée
dans le grais.fe foutient feule. 41 Ouvrier chargé d’un faix ôc qui monte le long de
l’échelle ƒ?. J
£. Autre ouvrier qui fourre le bout de fon faix fous un
des bourfons de l’échelle cm afin de fe garantir de
quelque chofe qu’il entend tomber au-deffus de lui.
-j. Bloc d’ardoifè dont la furface A B C D eft fuppofée
parallèle au ciel de la car-riere, Ôc fur lequel on a
•marqué tous les différens délits qui fe rencontrent
, dans cette pierre.
1 , 1 , 3 Naye ou laye.
7 , 8 , 2 , Avantages,
i j , 14, iç Rifféau.
10 , ;i.i, ta Macquerie.
4. Cette figure repréfentc la vue en perfpe&ive de
partie d’une culée entièrement foncée, avec une
petite rigole a a a, ôc une perche b e, pour diriger
dans le canal e les eaux qui filtrent du ciel ôc
des parois de cette culée.
P L A N C H E V,
I . Cette figure repréfente l ’intérieur d’un haillon, Ôc
une partie du terrein à côté. a Refendeur qui-refend le reparton r. b Hachcur ou rebatteur placé (ur fon cheval a 3 , fur
lequeLil débite en ardoifè les pièces d’en-haut f ,,
à mefure que le refendeur les fait. Les recoupes
tombent dans l’oifeau 4.
c Faifeleux qui emporte un oi/èau rempli de recoupes
qu’il va jetter hors du haillon. à Crêtes ou treilles d’ardoifes toutes rangées ôc comptées.
y
1. Cette figure repréfente le plan ôc le profil d’un
banc d’ardoilè moins épais-que celui de Rimogne.
A BC D Profil du haut du banc qui fe prolonge beau-
; coup au-delà de CD. ab c Entrée de la foffe.
G EF H K Galerie de niveau ou à-peu près.
HQ R L Galerie inclinée fuivant le banc.
P V IS & M T X N Etais ou piliers.
Mémoire Jùr les Ardofierceousv eqrutie sf.e travaillent par galeries
Les ardoifieres fituées le long de la Mctilè au-defïous
deCharleville, ont leur banc incliné, ôc la roche mêlée
dé cailloux qui le couvre, eft fi dure, qu’il fèroit fou-
vent impoflible, ou au moins toujours trop coûteux de
lé découvrir pour l’exploiter à ciel ouvert : c’eft pour
cette raifon qu’on les travaille par galeries.
- Je ne crois pouvoir rien donner de plus inftruéiif fur
l’exploitation de ces fortes d’ardoifieres que la defcrip-
tion de celle de Rimogne, une des plus confidérables
du pays, avec le détail des différentes manoeuvres qui
s’y font depuis la feparation de la pierre avec le refte
du banc, jufqu'à ce que l’ardoifè foit remife au Faéleur.
Ce Faébeur eft un commis prépofe par le propriétaire
de l’ardôificre pour veiller à fon exploitation, recevoir
l’ardoifè des ouvriers qui l’ont façonnée, ôc la débiter
enfuite aux marchands, c’eft-à-dire aux acheteurs à mefure
qu’il s’en préfente.
L’ardoifiere de Rimogne eft fituée fur une hauteur 2 quatre petites lieues oueft de Charleville. Son banc
que les ouvriers appellent la Planche, a plus de 60 piés
.•ffécaifTeur, mais on ne l’exploite que fur 40 oi\4f piés,
tant parce qu’il faut referver un ciel de bonne pierre ,
que parce que fa partie Inférieure que les ouvriers nomment
pierre grenue, eft trop aigre Ôc trop dure pour pouvoir
être débitée en ardoife. Ce banc eft incliné d’environ
40 degrés du nord au fud ; il a outre cela un devers
de feft-à l’oueft d’environ un demi-pouce parpié:
on ne connoît point fa longueur. Lorfque les ouvriers
font arrivés à une certaine diftance, ils aiment mieux £è
jetter de côté què de pouffer plus loin, tant par rapr
port à ce que les épuifemens fèroient plus confidérables, ôc a ce que la pierre y eft un peu grenue, que parce
qu’ils auroient trop haut à la monter ; car le banc étant,
comme nous venons de le voir, incline d’environ 40»
degrés, on ne peut pouffer en avant de quatre piés,
qu’on ne defccude en même tems de près de trois. La
largeur du banc n’eft pas mieux connue que fit longueur;
on fçait feulement qu’elle eft au moins de <îo toifes ,
puifqù’il y a des galeries à plus de 30 toifes de chaque
côté de celle du milieu.
Le plus long difeours ne rendroit jamais qu’impar-
fiiitement ce qu’on verra d’un coup d’oeil avecle fecours
de la Planche première ôc de fes renvois. La fig. 1. de
cette Planche reprélènte le plan d’une partie du terrein
fous lequel foiit les galeries. La fig. x. eft une coupe
fur la longueur de l’ardoifiere , ôc la troifieme le plan
d’une partie des galeries. Je crois devoir prévenir que
pour rendre ces defleins plus intelligibles, on a été obligé
de prendre quelques licences, comme d’avoir fup-
pofé dans la coupe toutes les galeries fur une même ligne
, Ôc d’avoir fait la projeéHon des fouterreins fur un
plan parallèle au ciel de la carrière ; de forte qu’on voie
fur ce plan des fouterreins, ôc fur la coupe beaucoup
de choies qui à la rigueur n’auroient dû y être que ponctuées.
Il ne faut pas être beaucoup verfé dans le deffein,
pour fèntir la confufion qui en fèroit réfiiltée.
On voit par la fig. 1. que comme toutes les galeries
font inclinées fuivant le banc, on ne parvient au bout,
c’eft-à- dire au fond de l’ard oifiere qu’à l’aide de vingt -v
fix échelles plus ou moins grandes qu’on a auffi mar-;
quées fur le plan fig. 3. ôc qui produifènt enfemble environ
400 piés J e hauteur perpendiculaire. Toutes ces
échelles font jumelles, c’eft-à-dire qu’il y en a deux à,
côté l’une de l’autre, afin que les ouvriers qui montent ôc ceux qui defeendent, ne fè caufènt mutuellement aun
cun embarras. Indépendamment de cette fuite d’échelles
, il y en a encore d’autres qui condüifent à d’autres
galeries ; car on tire en même tems de la pierre d’ar-
doifè dans plufieurs endroits du banc, mais le plus fort
attelier eft actuellement (Octobre 1761.) dans la culée abc d,fig. i.,& 3. On appelle culée un efpace quadran-
gulaire.d’environ 6o piés de long, ôc dé 20 oit '11 de
largeur, qu’on creufè, ôc d’où l’on tire de la pierre d’ar-
doïfe, jufqu’à ce qu’on ait atteint la pierre grenue. Pour
lors on ne va pas plus loin, & l’on dit que la culée eft
entièrement foncee, de forte que foncer une culée, n’eft:
autre chofe que d’en tirer toute la pierre qui eft propre.,
à faire de l’ardoifè.
Suppofons, pour montrer comment fe fait ce trad
vail, que A B C D fig. 1. PI. 111. foit le plan d’une culée
entièrement foncée ; que E F G H foit la coupe fur 1*^
longueur de cette même culée, Ôc qu’il s’agiffe d’en fo-f
rer une nouvelle, on ne peut le faire fur le derrière DC,
en prolongeant les côtés A D ôc B C , parce qu’il jfèroic
à craindre que le ciel ainfi en l’air fur une trop grande
étendue, ne vînt à manquer. L’ufàge eft de faire un fo-i
rage de côté ab De, de vingt-cinq piés de face, fur
une largeur D« de vingt ou vingt-deux piés : le forage
de derrière Dede, qu’on fait enfuite, forme avec le
premier une culée abcd, pareille à celle A B C D. Les
maffes a b A ôc c D C qu’on réfèrve, ôc derrière lefii
quelles on vient enfuite travailler par d’autres galeries
fe nomment piliers. Celui qui dirige le travail doit veiller
à ce qu’on n’affame pas trop ces piliers : on leur
donne communément vingt piés d’épai fleur. La fig. z.'
de la PI. I. & la fig. 1. de la PI. III. font voir que les
faces de devant ôc de derrière des piliers ne font point
verticales, ces piliers étant à-peu-près perpendiculaires
fur le ciel.de la carrière.
Les dimenfions que je viens d’indiquer pour les forages
pour les culées ôc pour les piliers, font celles qu’on
rj v # A R D O I S E R I E
donne le plus ordinairement, car l’ignorance ou la capacité
de ceux qui font chargés de diriger le travail,
1 avidité des ouvriers, & la qualité plus ou moins
bonne de la pierre dans telle ou telle partie qu’on avoit
d abord deftinée pour y foncer une culée, ou pour y ré-
ferver un pilier, font autant de caufes qui font varier
la fituàtion ôc les dimenfions de ces culées ou de ces piliers.
Au-lieu, par exemple, de faire toujours un forage
entier, on ne fait fouvent qu’un demi-forage. C’eft ainfi
qa’on appelle celui qui n’a que dix à onze piés de largeur,
au-lieu de vingt ou vingt-deux, caria dénomination
de demi-forage fe prend toujours par rapport à fil
largeur de l’eft à l’oueft, Ôc fans avoir égard au plus ou
moins de longueur du nord au fud. Un forage entrefporriasg
efu dre Abo Bu to;u fur a b, Ôc fur D Cour fc, s’appelle un mais celui fur AB ou ab, vu la partie fu-
pdeevriaenutr,e du banc, prend le nom particulier de forage de comme celui fur DCouzfc vers fa partie inférieure
s’appelle forage de derrière. Quant aux forages entrepris
fur DA ôc da, ou fur C B ôc cb, on les nomme
toujours ôc fans aucune difti.néHon forages de côté.
Un forage foit debout foit de côté, fe commence
toujours vers le ciel de la carrière. Ce commencement
de travail qui fe fait immédiatement fous-le ciel, fe nomme
crabotage, & comme prefque toute la pierre qu’on
tire d un crabotage tombe en pure perte, on le fait le
plus petit, c’eft-à-dire le moins haut qu’il eft poifible;
cette hauteur eft ordinairement de deux piés ôc demi :
ainfi le crabotage i F m Ifig. 1. PI. III. n’a que deux pouces
& demi de i en F, de forte que quand il eft fini il
forme une efpece de boite de vingt-cinq piés de long,
vingt-deux piés de largeur, & deux piés Ôc demi feu-
côté z F ml.
Avant que d’entrer dans aucun détail fur la maniéré
dont fe fait le crabotage, & fur toutes-les autres manoeuvres
de hauteur, dans laquelle on entre par le feul
relatives à l’exploitation de cette ardoifiere,
il eft bon de prévenir qu’on trouvera fur la PI. II. les
deflèins de tous-les différens outils qui fèrvent à cette
exploitation. Je me contenterai, pour ne pas alonger
inutilement le difeours, de renvoyer à cette Planche
la première fois que j aurai occafion de parler de ces
outils. •
1 Outre les outils repréfèntés fur la Planche IL on fè
fert encore pour fbulever ôc manoeuvrer les gros blocs
d’ardoifes, de grands leviers de bois ôc de piés-dc-
chevre ôc de: ringards de fer, trop connus pour qu’il foit
néceffaire d’en donner la figure'-, il en eft de même des
écopes pour jetter l’eau, des petites échelles Ôc des
grandes; ces dernieresdoivent être fort folides, c’eft.
pour cela qu’on donne .à leurs jumelles quatre & cinq
pouces d’équarriffage, ôc aux bourfons deux pouces de
diamètre au milieu.
Le crabotage commençant toujours au ciel de la
carrière, les ouvriers ne peuvent y travailler fans s c - :■
chafauder ; les- échafauds dont ils fè fèrvent n’ont rien
de particulier que leur extrême légèreté: ceux pour
lgeess ,forages debout, que les ouvriers nomment hourda- font foutenus par deux pièces de bois qu’ils nom-'
ment béculs, ôc qui font placées en gouflèts dans les
deux angles de ht culée; on pofefur ces deux béculs
deux traverfès qu’on recouvre avec des perches ôc des
claies, auxquelles on donne un peu de devers du côté
de l’ouvrage. Les échafauds pour les crabotages de côté'
fe nomment houres, ôc comme ils font beaucoup plus
longs que les autres, au-lieu de faire porter les traver-
fes fur deux béculs, on les foutient avec des perches
qui montent de fond. C’eft fur c-es échafauds que les
ouvriers fè placent pour commencer le- crabotage en
piochant avec un pic A PL IL Les décombres font enlevés
enfuite dans des hottes G même Planche, par de
petits garçons appellés faifeleux, qui les portent dans
d’anciennes culées; on les y jette fouvent fans autre
deff.-inque de s’en débarraffer; quelquefois cependant
on les arrange par affifes pour contre-buter les piliers,
&fneme pour foutenir le ciel lorfqu’on s’apperçoit
qu’il y a du danger.
Outre qu’il faut fà voir prendre le fèns'de la pierre
pour la piocher avec avantage, il y a encore des attend
D E L A M E U S E . j
tions à avoir pour que tout ce qui fort du crabotage,
ne^ tombe pas en pure perte. Les ouvriers eh tirent ce
qu ils appellent des pains de noeuds 3 ce font des morceaux
d’environ un pié de long, un pié de large, ôc dix-
‘ huit pouces de hauteur, avec jefquels on peut par con-
fèquent faire de 1 ardoife. Voici comme on fè procure
ces pains.de noeuds.
Soft De ab fig. 2. PI. [II. Je plan d’une maftè d’ar-
doife a craboter, ôc ipml la face verticale de cette
même maftè, on commence par creufer avec le pic vers
m/un trou no ml de deux piés ôc demi de hauteur, qui
eft celle du crabotage, environ deux piés de largeur &
un pié de profondeur; oii réferve enfuite un pain de
noeuds S d’un pié de large & un pouce & demi de hauteur
qu’on détache du deflbuspn/& du côté q p , par
une tranchée d’un pié de largeur feulement, & d’un
pié de profondeur, comme le trou noml : le pain
ifolé pour-lors par quatre de fès faces, ne tient plus
que par le haut ôt par fà queue, qu’on a même eu attention
de démaigrir, çomme on le peut voir parle
plan r de ce pain. C’eft alors qu’on le détache en le
frappant de côté à grands coups de hache d’ouvrage lî
PI. II. On forme &enleve ainfi fucceffivemçnt tous les
pains de noeuds ponéhiés, tant au plan que fur l’éléva-
tionfig. z. Pl. III, après quoi le crabotage Ce trouve fait
fur un pié de profondeur. On ènleve enfuite de la même
maniéré une féconde file de pains de noeu,ds, puis une
troifieme, ôc ainfi fucceffivement jufqu’à ce que le crabotage
foit tout-à-fait achevé, c’eft-à-dire jufqu’à ce
qu’on foit arrivé à «la ligne ea.
Les ouvriers font certainement bien peu à leur aife
dans le fond des crabotages, pas aufli mal cependant
qu’on pourroit fè l’imaginer, d’après ce qui a.été dit,
qu’on ne donnoit à ces crabotages que deux piés ôc
demi de hauteur. Les fig. 3. ôc 4 de la PL III. font voie
quelle facilité les ouvriers tirent dans cette occafion
de la grande inclinaifon du banc, qui fait qu’ils ne font
réellement qu'un peu couchés fur le côté, au-lieu d’être
courbés comme on le croiroit d abord.
Le crabotage une fois achevé, on divife la ma ffe ea fië‘ L Pb III..en trois longueffes H, I , L, par le
moyen d’uns taille de devant le long de a b, marquée
d fur l’élévation d’une de derrière le long de e D , marquée
J- fur la même élévation, d’une de côté le long de
«æ, & de deux antres marquées C,tant au plan qu’à
1 élévation. Les tailles font , comme on le peut voir par
ce plan ôc cétte élévation des tranchées, de fix à neuf
pouces de largeur, &de douze à 1 f pouces de profondeur,
elles fervent à ifoler les quatre côtés des longueftès
qui le font déjà par-deflus, de forte qu’il n’y a plus que
leur deffous qui tienne au refte du banc, dont on les
fépare pour-lors avec des coins comme nous le ver-,
rons un peu plus bas.
Outre la taille de devant qui fepare la première lon-
gueffe d’avec le devant a b de la culée, on fait encore à
cette longueffe des trous S de pareille profondeur de
douze à quinze pouces fur autant de largeur, Ôc dix-
huit ou vingt-un pouces de longueur; ces1 trous fe
. nomment manottes, ils donnent la facilité de placer ôc
de frapper enfuite avec la hache d’ouvrage les coins G
Planche II. qui doivent faire lever la longueffe. Il eft
elïèntiel d’obferver qu’à quelque endroit qu’on place
un coin, foit dans le fond d’une manotte ou ailleurs,
. On lui prépare toujours l’entrée avec le pic, ôcce petic
trou fait pour recevoir le coin s’appelle une tenure^
La_/z£. 6. repréfènte le planée la coupe d’une manotte
. avec les coins a placés dans leurs tenures, & prêts à
, etre frappés. On met ordinairement dans chaque ma-,
notte deux coins, fur lefquels des ouvriers placés, utv
vis-a-vis de chaque manotte, frappent alternativement,
ôc de maniéré cependant que tous les ouvriers frappent
toujours enfemble. Quand les coins fe trouvent
une fois enfoncés julqu’à la tête, ôc que la longueffe
n’eft pas encore détachée, on en infinue de plus épais,
. Ôc toujours ainfi fiicceffivement jufqu’à ce qu’elle ne
tienne plus; une longueffe ainfi féparée du refte du
banc prend le nom depiece d!en-bas. ■ Une piece d’en-bas qui a environ quinze pouces d’é-
paiflèur, fe divife avec des refendrets D PL II. c’eft - à