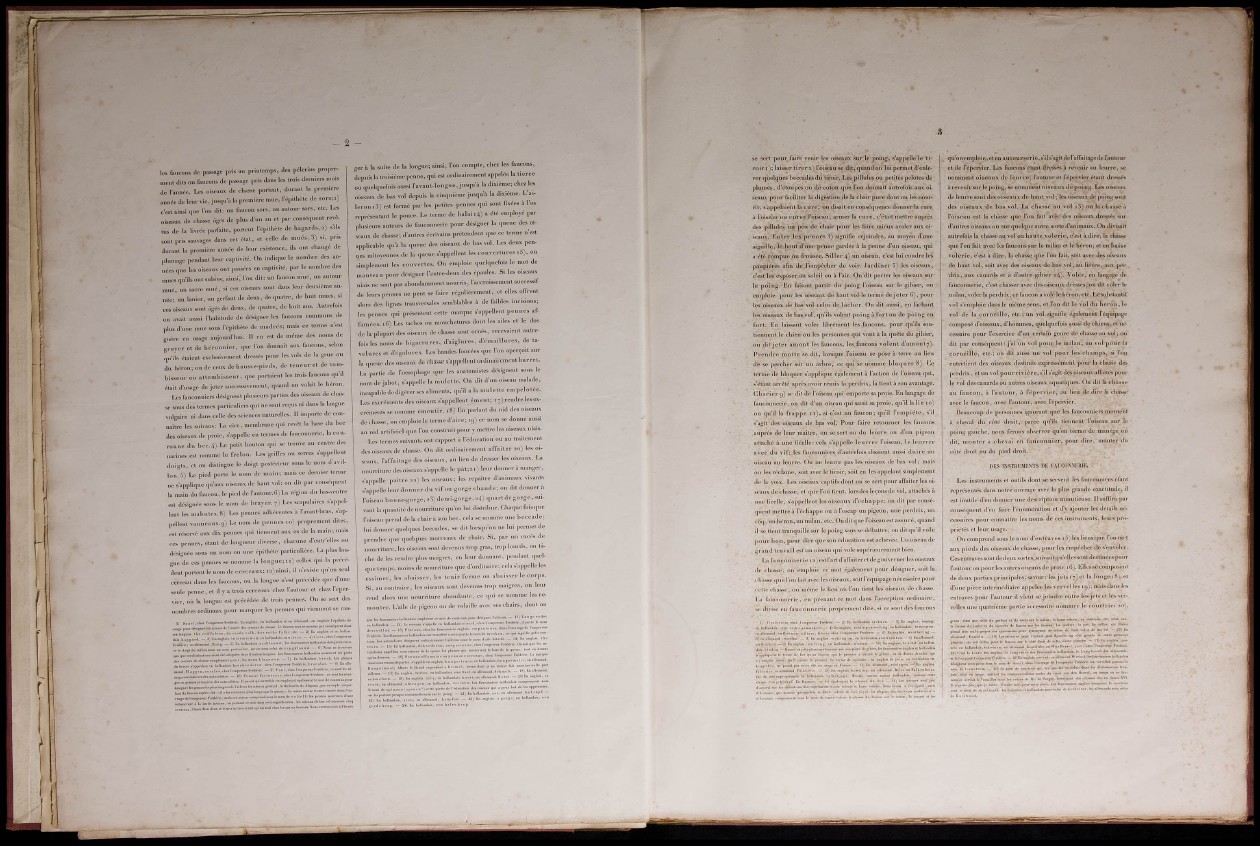
les laucoi.5 de |>assagc pris au priiilcmps, <1es pèlerins propvcrocnl
ciils ou fiiucons de passogc pris dans les irois deniici-s mois
de Tannée. Les oiseaux de eUassc ,.or,on,, d.u-aul la p«miè.-e
c'est ainsi que lou dit: m. Hmeoi. sois, un autour sors, ele. ix-s
oiscmix de cliasse agis de plus d'un on cl par eouséqueut reyctus
de la livrée parfaite, portent réi>itliéie de iKigards.a) s'ils
..... sauvanes d.nis eet état, ct cclle de mues,3) si, pris
:e, ils ont changé de
le le noiîiln'C des flnté,
par le nombinî des
Jiiraot la prein
plu mage peiuia captivité. On indiq
es quo les oiseaux oui passées en eaplivi
les qu'ils ont subies; aiusi. Ion dit: lU, faueon mué, un autour
lé un sacre iiuié, si ces oiseaiis sont dans leur deuxième aue;'
uu lanicr, uu gcrl'aut de deux, de qunli-c, de huit mues, si
s oiseaux sont âgés de deux, de quatre, de liiiil aus. Antrefois
, avait aussi riiabiii.de de désigner les faueons communs de
mue sous Tepitbete do madrés; mais ce terme n'est
usage aiijoiira'bui. Il en est de même des noms de
de liéionnier, que l'on donnait au\ faucons, selon
eut exelusivcmenl ditssés pour les vols de la grue ou
; ou de eeim de hausse-pieds, de
,u attombisseur, que portaient le
,ge de jeter successivement, «luaiul
plus d'il
du héro.
bisseur
s fauconniers désignent plusieurs parlies
us des termes parlicu
m volait le béi
• sont rociis ni daus la langue
ni dans celle des sciences naturelles. Il importe tie coii-
, snivaiis: l.a eire, .uembrane <ii.i revêt la base du bec
QN de proie, s'appelle en termes île faucoiuiei-ie, la couu
bec.4) U petit bouton qui se trouve au ecutre des
!5t nommé le frelon. Les griffes ou serres s'api>ellcnl
et on distingue le doigt postérieur sous le nom il avil-
,e pied porte le
, s'i4)pli<li.c qiñ
le pieil d
,t vul: on dit par eon.ïéqueii
ür.6)l.a région du bas-venir
est désigné, ? sous le nom do bi •ayer. 7 ) U'S seapulaire: Í s'ai>i>ellent
les ma hntes.8) Us peni» ;s adhéi •entes à I'avanl-b ras, s'appellent
\ au ueaux.9)Le nom d e penn es .0) proprem, ;nt dites.
est ré.scrvé aux dix pennes «pii liennen t aux os de la 111ai n ; mais
ces pennes , étant de longueur diverse , cbacunc d'enl r'elles est
désignée se ms un nom ou une épilhéte particulière. > plus Ionde
res - ' lon^rii e;iiieelleK qni ia pré.'.-
te de la longue; ainsi, l'on compte, chez les faueons,
Disièine penne, qui est orilinaiif ment appelée la tierce
depuis la ti-oisièi
00 quelquefois ^
.si j'avant-longue, jusqu'à la dixième; chez les
depuis la cinquième jusqu'à la dixième. L'aileron
i3) est formé par les petites pennes qui sont fixées à l'os
représentant le pouce. Le tenue de balai ,4) a été employé pa.^
plusieurs auteurs de fauconnerie pour désigner la queue des oiseaux
de cbasse; d'autres écrivains p.xHendent cpie ce terme n'est
api-licable qu'à la queue des oiseaux de bas vol. Les deu. pennés
mitoyennes de la queue s'appellent les couvertures 15), ou
. On emploie quelquefois le mot de
uti-e-deiix des épaules. Si les oiseaux
.impleinenl les couverte
iiantcau pour désigner 1
liais ne sont pas ¡ibouclam
de leurs pennes ne peut :
des lignes transvei^
les pennes qui pivscut
famées. i6) Les taehes
de la plupart des oiseau
noms debigarrur
•es et d'cgalures. 1a'
eue des oiseaux de el
La partie de l'oesopliage
n de jabot, s'appelle la
ipable de digérer ses ali
:cessif
t, et elles offrent
miblabics à de faibles i
u mouchetures doni
•le cbasse sont ornés
ves, d'aiglures, d'é
A's bañiles foncées qii
• s'appellent ord
de cbasse, on emploie!
id artiliciol (pie l'c
nix s'appellent émeu
îutir. i8) r.n parlant
terme d'aire;i9) ce
eonstriiil pour y met
m rapport à l'édiicati
Mon aperçoit-
:.e empeloti
nid des oisea
s'appelle
s'appelle 1
l'oiseau b.
che de les
iiagedes
liseaux, au lien de di-c.>aer les oi
•appelle le piil;a i ) leur donner .
i t r e » , ) l
vdnnnerdnvifoi
iue.^orge,s3)dem
.lilédenourritureq
Kl de la chair à soni
cpielniics beeca<lcs,
i-enilie plus maigrci
.•epaiti^e d'auiina.
i-gorge,24) quartdcgorgissiii
ii'on lui distribue-Chaque foisqiii
I, peiubnt qiielse
sert pour fBire venir les oiseaux sur le poing, s'appelle le liroir
t); laisser tirer a) l'oiseau se dit, quandon lui permet d'cdever
quelques beccadesdu tiroir, l,es pillules ou petites pelotes de
plumes, d'étou]>cs ou de coton que l'un donnait autrefois aux oiseaux
pour faciliter la <ligestion de la ebair pure dont on les nourrit,
s'appelaienl la cure; on disait en conséquence donner la cure
à l'oiseau ou curer l'oiseau; armer la cure, c'était mettre auprès
des pillules uu peu de chair pour les faire mieux avaler aux oiseaux.
Enter les pennes 3) signifie i-ejoindre, au moyen d'une
aiguille, le.bout d'une penne guindée à la penne d'un oiseau, qui
a été rompue ou froissée. Siller 4) un oiseau, c'est lui coudre les
paupières afin de l'enipéclier de voir. Jardiner 5) les oiseaux,
c'est les e\po-ser au soleil ou à l'air. On dit j>orter les oiseaux sur
le poing. En faisant partir du poing l'oiseau sur le gibier, on
emploie pour les oiseaux de liant vol le terme de jeter 6), pour
les oiseaux de bas vol celui de lâcher. On dit aussi, en lâchant
les oiseaux de bas vol, qu'ils volent poing à fort ou de poing en
fort. En laissant voler librement les faucons, pour qu'ils soutiennent
le chien ou les personnes qui vont à la quête du gibier,
on dil jeter amont les faucons, les faueons volent d'amontj).
Prendre motte se dit, lorsque l'oiseau se pose à terre an lieu
de se pei^cher sur uu arbre, ce qui se nomme blo.|ner 8). Ce
ternie de bloquer s'applique également à l'action de l'oiseau qui,
s'étant arrêté après avoir remis la peiilrix, la tient à,son avantage.
Charier g) se dit de l'oiseau qui emporte sa proie, lin langage de
lauconnerie, on dit d'un oiseau qui saisit .sa proie, qu'il la lie lo)
ou qu'il la frappe n ) , si c'est un faueon; qu'il l'empiète, s'il
s'agit des oiseaiLx de bas vol. Pour faire retourner les faneoiis
auprès de leur maître, on se sert on du leurre ou d'un pigeon
attaché à une licelle: cela s'appelle leurrer l'oisean, le leurrer
avec du vif; les l'aiiconniei-s d'autrefois disaient aussi duire im
e- On I e pas I is vol;
on les réclamc, soit avec le tiroir, soit on les appelant simplement
de l:i voix- Les oiseaux eaptils doni on se sert ponr affailer les oj.
seaux de chasse, et que l'on lient, loi-sdes leçonsde vol, iiltacliés à
une ficelle, s'appellent lesoiseaux d'échappé; on dil par eonséquenl
meltreà l'éebappe ou à l'eseap un pigeon, une perdrix, un
eo<i. un béron, un milan, clc. Ou dil i|ue l'oisean est assuré, quand
il Sf tient tranquille sur le poing:
qn'oneinploie,etenanioui
et de l'épervier. Les faucon
nomment oiseaux de leur
, s'il s'agitdcl'uiraitagc de l'aule
r et l'épervier étant dre-W'»
evenirsurleponig, se nomment oiseaux de poing- Les oiseaux
leurresontdesoisean>.de haut vol; les oiseaux de poing sont
s oiseaux de bas vol. Ls chasse au vol i3) ou la cba.ssc à
iseaii est la chas.'ie que l'on fait avÈe des oiseaux di'cssés sur
lutres oiseaux ou sur quelque antre sorle d'animaux. On divisait
trefois la cha-sseau vol en haute voleric, c'est ii dire, la oiiasse
•e l'on fait avec les faucons sur le milan et le béron; cl en basse
ilerie, c'est à dire, la cliassc que l'on fait, soit avec des oiseaux
! baut vol, soit avec des oiseaux de bas ^ol, au lièvre, aux per
•ix, aux canaals el il d'autre gibier i4). Voler, en lang.-ige de
ilan, voler la ]>er<lrix. ce faucon a volé le héi-on, elc. Le subslanlif
il s'emploie dans le même sens, et l'on dil le vol du béron,le
vol signifie également l'équipage
cessai i-e pour l'e
c, d'hoi
e d'un .11 vol; ,
dit par conséqi .en.:j'ai un vol pour le milan, un vol pour la
corneille, etc-; on dit aus-si un Tol pour les champs, si l'on
enlrelienl des <> iseauN destines .i xpi-essénienl pour la cbas.sc des
perdrix, el un v olpourrivière. s'il s'agitdcs oiseaux affai lés pour
le vol descanar dsou antres oisea ,ux aqiialiqiies. On dit la cbasse
au faucon, à : l'autour, à l'èpe rvier, au lieu de dire la chasse '
avec le faucon, avec l'autour, av •ce l'épervier.
Beaucoup île pei-sonncs ignor int que les fauconniers montent !
il cheval du c. qu'ils tiennent l'oiseau sur le '
poing gauche, 1n ous ferons'obsc,r ver ([n'en ternie de mauége.on
dit, monter à chevai en fane onnier, pour dire, monter du
c,',lé droit ond u i>ied droit.
li;S INSTllUMliM'S DE FAUCO^'^EÍllE.
Les inslrumcM HS et outils donii se servent les fauconniers é.ani
••eprésentés <lan ,s notre aiivmge i, ivec la plus grande exactitude, il
est inutile d'en donner une dese riplion minutieuse. 11 suilira par
conséquent d'e n faire l'énuméra lion el d'y ajouter les détails né- 1
cessaires [loiir 1;o nnailre les non is de ces instrnmenls, leuis pro- J
priélés el leur <is age.
•
aux pieds desi :
r
de deux parties
d'une pièce in»
1
1
\