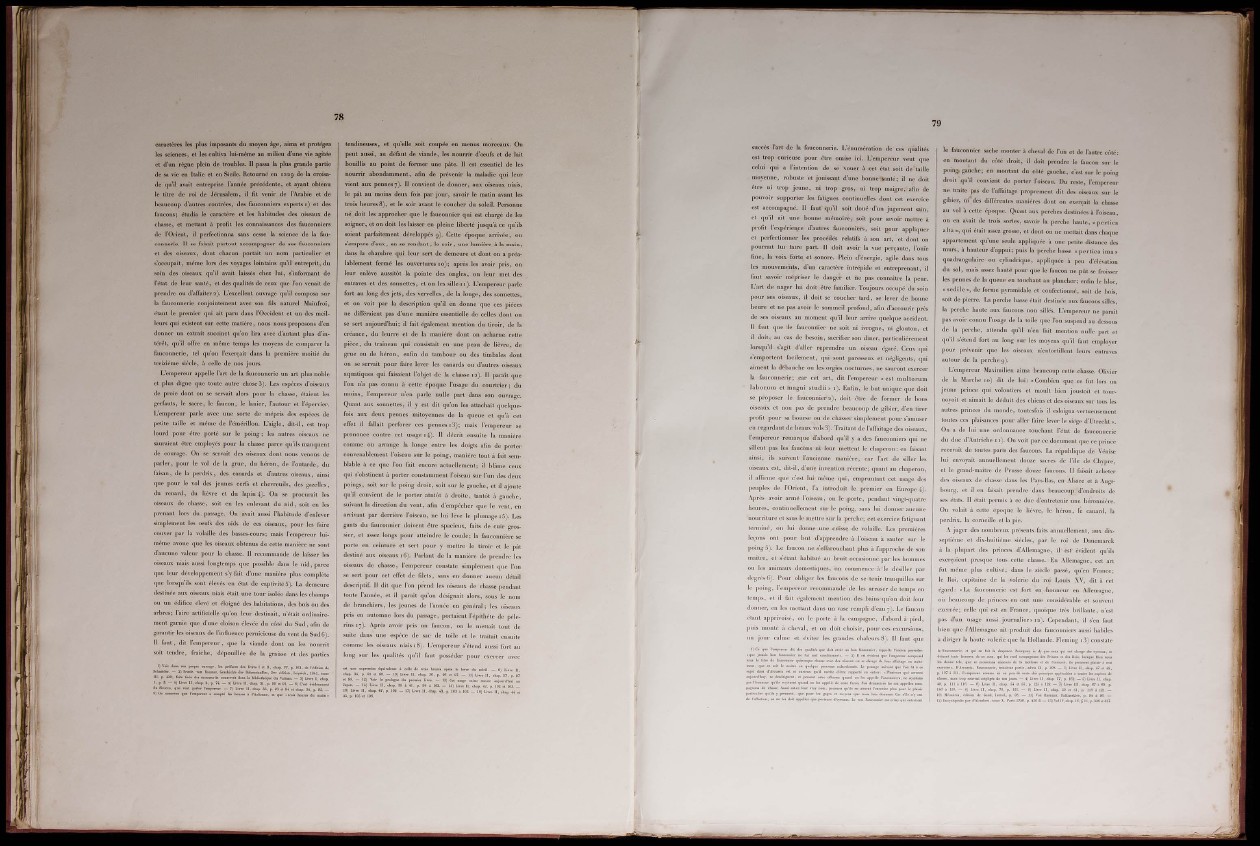
cnniclèrcs íes plus impo&aiils du moyen âge, aima el protégea
les sciences, et les cultiva lui-mâme au milieu d'une vie agitée
pl (l'un rógne plein <le Iroiihles. Il passa la plus grande partie
de M vie en Italie et en Sicile- Relourné en laag de la croisade
(lu'il avait entreprise l'année précédente, et ajant oble
>i de Jerusalem, il f
lieancoiip d'autres contrées, dos fa
Taiicons; étudia le caractère et les
chasse, et mettant à profit l<
de l'Orient, il pci-reclionna :
ÎI rauco
t venir de l'Arab
conniers experts i) et des
.1 liaUilndes des oiseaux de
i connaissances des fauconniers
ins cesse la science de la fauiccompagner
de ses fauconniers
aux, dont chacun portait un nom particulier et
même loiii des voyages lointains qu'U enti'eprit, du
seaux qu'il avait laissés chez lui, s'informant de
ir santé, el des qualités de ceii* tjuc l'on venait de
d'affaiterï). L'cxeellenl ouvrage qu'il composa sur
rie conjointement avec son fils naturel Mainfroi,
it paru dans TOcciden et un des meili
proposons d'en
iitant plus d'inle
(éi-ét, qu'il oITr« en
temps les moyens de comparer la
fauconnerie, tel qii
exerçait dans la (ireniiri'e moitié du
treizième siècle, à celle de nos jours.
L'empereur appelle l'ari de la fauconnerie un ail plus noble
et plus digne que toute autre clioseS), Les espèces d'oiseaux
de proie dont on se servait alors pour la oliasse, étaient les
gerfauts, le sacre, le faucon, le lanier, l'autour et l'épervicr.
l/empei'cur parle avec ime sorte de mépris des espèces de
petite Uille el même de l'émérillon. L'aigle, dit-il, est trop
lourd pour être porlé sur le poinR ; les autres oiseaux ne
saïuaien mplovi'S pour e parc,
arler, pour le vol de la grue, du héron, •
a peni
que pour le vol des je ;rfs et clievreuils
du lievre et du lapin 4). Ou se
chasse, soil en les eiilcvant du n
s du passage. On avail anssi I'hahl
les oeufs dcs nids de ces oiseanx,
la volaillc des basses-cc
e que Ic IS de
l'empereur luid'aucime
valeiu- pour la chasse. II recoinniande de laissei' les
oiseaux niais aussi longtemps que possiiile dans le nid, pai-ce
que leur développement s'y fait d'une manière plus complète
que lars<puls sont élevés en étal de captivités). U demeiue
dcsli.iée aux oiseaux niais était une tour isolée dans les champs
ou uu édilice élevé el éloigné des babilalion.s, dos bois ou des
arbres; l'aire arliliciolle qu'on leur destinait, n'était ordinairemeiU
garnie que d'une cloison élevée du côté du Sud, afin de
garantir les oiseaux de rinHuence pernicieuse du venl du Sud 6).
Il faut, dit l'empereur , que la viande dont on les nourrit
soit Iciidre, fraicbe, dépouillée de la graisse et des panics
tendineuses, et qu'elle soit coupée en menus morceaux. On
peut aussi, au défaut de viande, les noilirir d'oeufs et de lait
bouillis au point de former une piite- Il est essentiel de les
nourrir abondamment, afin de piévenir la maladie qui leur
vient aux pennes 7). Il convient de donner, aux oiseaux niais,
le pat au moins deux fois par jour, savoir le malin avant les
trois heures 8), et le soir avant le coucher du soleil. Pei'sonne
ne doit les approcher que le fanconniei' qui est chargé de les
soigner, et on doit les laisser en pleine liberté jusqu'à ce qu'ils
soient parfaitement développés 9). Celte époque arrivée, on
s'empare d'eux, en se rendant, le soir, une lumière à la main,
dans la cKanilu^e qui leur sert de demeure et dont on a pi^éalahlement
fermé les ouvertures 10); après les avoir pris, on
leur enlève aussitôt la pointe des ongles, on leur met des
entraves el des soni>etles, et on lessillen). L'empereur parle
fort au long des jets, des vervelles, de la longe, des sonnettes,
et ou voit par la dcscriptiot» qu'il en donne que ces pièces
ne différaient pas d'iuie manière essentielle de celles dont ou
se sert aujourd'hui; il fait également mention du tiroir, de hi
créance, du leurre et de la manière dont on acharne cette
pièce, du traineau qui consistait en une peau de lièvre, de
grue ou de liéron, enfin du tambour ou des timbales dont
on se servait pour faii-e levei- les canards ou d'autres oiseaux
aquatiques qui faisaient l'objet de la chasse 12). Il parait <|ue
l'on n'a pas connu à celle époque l'usage du coui'lrier; du
moins, l'empereur n'en parle nulle ¡wirt dans son ouvrage.
Quant aux sonnettes, il y est dit qu'on les attachait quelquefois
aux deux pennes mitoyennes de la queue el qu'à cet
elïet il fallait perforer ces pennesiS); mais l'empereur se
prononce contre cet usage 14). 11 décrit ensuite la manière
comme on aiTango la longe entre les doigts afin de po.lei'
convenablemenl l'oiseau sur le poing, manière tout à fait semblable
e que I cluellement; il blâme ceu
s'obslin.
'.ui des deu
poings, soit sur le poing droit, soit sur le ganchc, et il ajoute
(pi'il convient de le porler ninli'it à droite, tantôt à gauche,
suivant la direction du vent, afm d'empêcher que le vent, en
arrivant par derrière l'oiseau, ne lui lève le plumageiS). Les
gants du fauconnier doivent èti-e 6|iacieux, faits dp cuir gro.4-
sier, et assez longs pour alleindre le ronde: la fanconnière se
porte en ceinliue el sert pour y mettre le tii'oir el le pàt
destiné aux oiseaux 16). Parlant de h. manière de preuiirc les
oiseaux de chasse, l'empereur constate simplement que l'on
se sen pour cet elTel de filels, sans en donner aucun détail
descriptif. Il dil que l'on prend les 0 chasse pendant
branchiers, les jeunes de l'année en général; les o
i en automne lors du pass.-ige, portaient l'épithètc de
117). Après avoir pris un (àucon, on le mctlail tn
e dans une espèce de sac de toile et le imitait c
nme les oisc.iux niais 18)- L'empereur Vélend ans,si f
g sur les qualités qu'il faut posséder pou, exercer
succès l'art de la fai
est troi> curieuse po
celui qui a l'intonti
être ni trop jeune,
pouvoir supporter li
trop gros, ni trop maigre, afin de
com|)agné. il faut qu'il soit dorn
et perfecti
pourrait
line, la
heure
ipérience d'autres fauconniers
es procédés relatifs
pan. Il doit avoir
d'un jugement s
pour savoir metti
soit pour appîic
le pas i
Il faut que le faucoui
il doit, au cas de bcst
lorsqu'il s'agit d'à
s'em|>orteut facitei
aiment la débanclu
la fauconnerie; ca
. Plein d'énergie, agile dans
itère intrépide et entreprenant, il
•ger et ne pas connaiti-e la peur,
familier. ïoujoius occupé du soin
coucher lard, se lever de bonne
meil profond, afin d'accourir pivs
]u'il leur arrive quelque accident,
le soil ni ivrogne, ni glouton, et
;ci ificr son diner, particulièrement
égaré. Ceux
" "égligeiils,
•ie;car cet art, dit l'empereur .est multon
magni studii . 1). liiifin, le but unique que é
le l'auconnier 2), doit élre de former de bc
•m pas de prendre beaucoup de gibier, d'en ti
ia bour.io ou de chasseï' simplement pour s'amu
lit de beaux vols3). Trail
t de l'afl'atl
remarque d'aboni qu'i
les faucons ni leur inei
peuples de l'Orieut, l'a im
\près avoir armé l'oiseau,
t usage des
Europe 4).
•ingt-qualj'e
ir le poing, sans lui donnei
sur la perche; cet exercice
.e cuisse de volallle. Les p
•ons ont |>our but il'apprcndre à l'ois.
•iiigS), U faucon ne s'eirarouchaut plus
degi><ns6). Pour obliger
I.' Idling, l'empereur rp,
innps. 01 il l'ail cgalcm.
à le désiller par
:ir irampulles sur
oser de temps eu
iC rempli d'eau 7). l-e (
caiu,.agi.o. d'abord
andes chaleurs 8). Il faul
le fauconnier sache monter à cheval de l'un el de l'autre côté:
en moiilani du eñlc droit, il doit prendre le faucon sur le
poing. gau,;he; en montant du cAlé gauche, c'esl sur le poing
droit qu'il convienl de porter l'oi.seaii. Du i-este, l'empereur
ne traite pas de )'an"ailage proprement dit des oiseaux sur le
gibier, ni'des din-érenles manicivs dont 01, exerçait la chasse
an vol à celte époque. Quant aux perches destinées à l'oiseau,
on en avait de trois sortes, savoir la perclic haute, «perllea
alla », qui était assez grosse, et dont on ne mettait daus chaque
appartement qu'une seule appliquée à une petite distance des
murs, à hauteur d'appui; puis la perche basse « pertica ima .
quadrangulaire ou cylindrique, appliquée à peu d'éléialioo
du sol, mais assez haute pour que le liiucon ne pût se froisser
les pennes de la queue en touchant au plancher; enfin le bloc,
• sedile., de forme pyramidale el confectionné, soit de bois,
soit de pierre. La pcvche basse était destinée aux faucons sillés,
la perche haule aux faucons non sillé.s. L'empereur ne pai-ail
pas avoir connu l'usage de la toile que l'on suspend au dessous
de la perche, allendu qu'il n'en fail mention nulle part el
qu'il s'étend fort au long sur les mo_\ens qu'il faut employer
pour prévenir que le» oiseaux n'ciilorlilleul leurs enlnue»
auluur de la perche 9).
L'empereur Maximilien aima licaucoup celle chasse. Oli\icr
de la iMarchc 10) dit de lui; .Combien que ce fut Ioiîî un
jeune prince qui volouliers et monit bien joustoil el tournovoil
el aimait le déduit des chiens et des oiseaux sur loiis les
autres princes du monde, toutesfois il esloigna venueuscmeut
tontes ces plaisancos pour aller fai.-e lever le siège d'ülreclit..
On a de lui une ordonnance louchant l'élut de fauconnerie
du duc d'.Vulriehe 11). On voil par ce documenl que ce prince
recevail de toutes paris des faucons. Li républiciue de Véiiise
:uellemc sacres <le l'ile de Chypi,-,
et le grand-mailic de Prusse douze fSucons. Il faisait acheter
des oi.icaux de chasse dans les l'uys-IJas, en ¡^sate el à Augsboni
g, et il en faisait prendre dans beaucoup d'endroils de
ses élals. Il étail penuis ii ce duc d'enlretenir uiie héruniiière.
Ou volail il celle épnrpie le lièvre, le héi-on, lé caiiard, lu
perdrix, la corneille el la pic-
A juger des nonibieu\ préscnls faits aiinuellcmenl, aux dixscpliéme
et dix-hnitièine siècles, par le i-oi de Dancmarek
à la plupart lies princes d'Allem.igiie, il est (ivident qu'ils
pxerçaienl pre.s(|ue tous celle chasse, lîn Allemagne, cet art
fut même plus cuhivé, dans le siècle passé, .|u'en Franee:
le Roi, capilaine de lu volcrie du i-oi Louis XV, dil à eel
égard; .La fauconnerie est fori eu honneur eu Allcm;.gr..-,
oil beaucoup de piiures en ont une considérable et souveiil
cxercée; celle qui c-st ,-n France, quoique très brlllanle. n'e.sl
pas d'un usage aussi journalier. : 2). Cependant, il s'en iiuil
bien que l'Alle.nag, il produil des (luicoiiniei-s aussi hahile.s
à diriger la liaule volerie que la Hollande. Fleming i3) constate