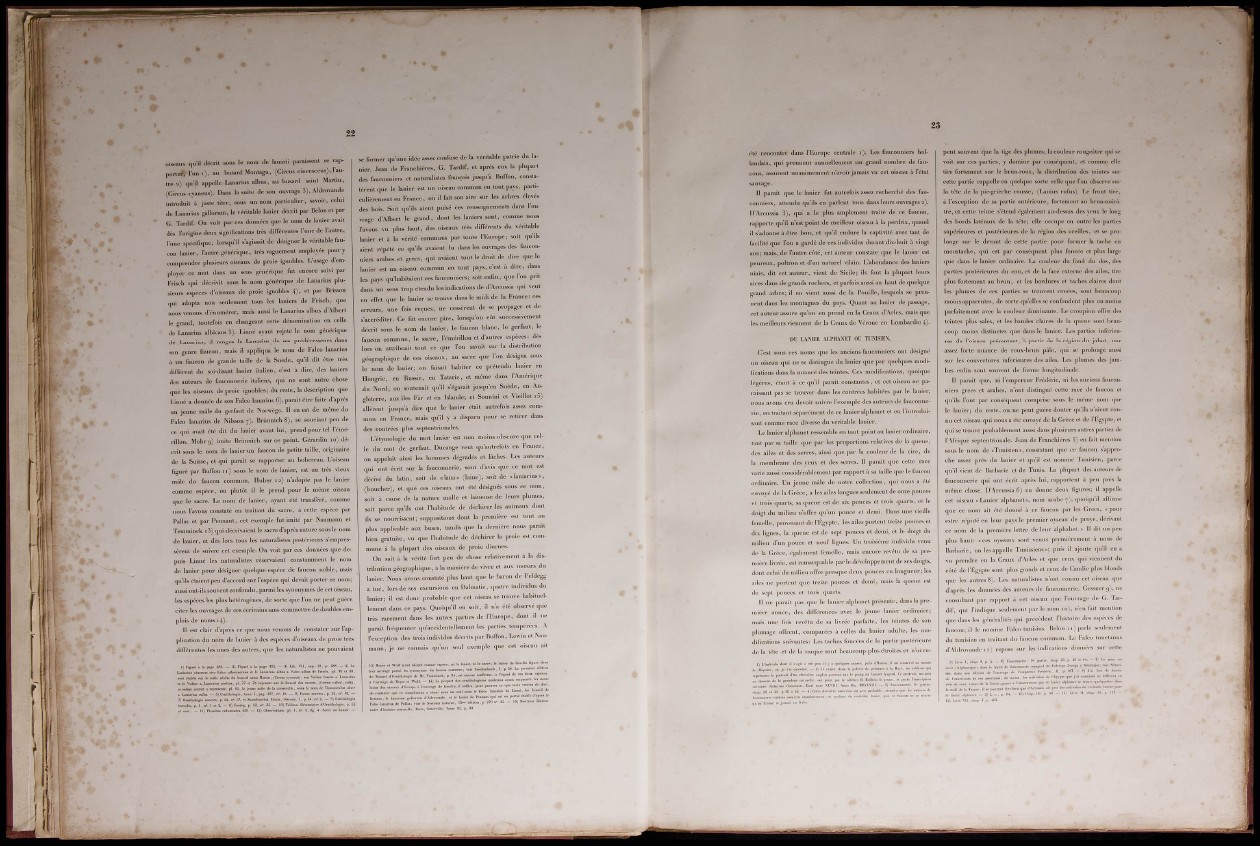
(lOl'lCfi I'll
») V'-
il düci'it SOI« le nom de laiiaiii parûissc.il se mp-
, i), au busard Monlügu, (Ciixius ciiieraceus), l'auappclle
(Cireiis cy
lllll'oduil <
de Uiiam
Liiiaiiii$ alb.is, au 1>
„eus). Dans l» .uiti
1 Marliii,
uvrage3),Aldiovande
liculie., savoir, celui
1, le véritable laiiier décril par «clou cl par
G. Tardil'- Ou voit ¡wi- ces données <jue le uoiii de lanier avait
des l'oi-igine deux sign il ¡cations très différentes l'une de l'autre,
l'une spécifique, lorsqu'il s'agis&ail de désigner !e véritable faucon
Imiier, l'aulre générique, très vaguement employée poiirj
coniin'endre pltisieiirs oiseaux de proie ignobles. L'usage d'eméiiéi'ique
fui encore suivi par
n générique de Una.^ius pluie
ignobles 4)1 cl par Brisson
is les laniers de Friseb, que
lussi le Unarius albus d'Albert
,t celle dénomiiialiun eu celle
ployer ce mol dans un
h~riscli qui dêcrivil sous
sieurs espèces d'oiseau s
.(ui adopta .
i dënur
I.. g,^iid, ic
de Unarius
de Lanarius
libici s 5). I-iniié
rejelé
,s de !
s prédccesseurs dans
,01, geine laucoii, mais il applii). >ni de Falco lanarius
un (àucon de grande lallle de la Suède, ciu'il dit être très
diiïéreni du soi-disant lanier italien, c'est i dire, des laniei«
des auleiirs de fauconnerie ilalieiis, qui ne sont autre chose
que les oiseaiit de proie ignobles; du reste, la description que
l.inné a donnée de son Falco lanarius 6), parait être faite d'après
un jeune mùle du gerfaul de Nonvégc. Il en est .le morne du
Falco lanarius de Nilsson 7)- UrunuicWS), se souciant peu de
ce qui avail été dit du buier avant lui, prend pour tel l'émérillon
Mohrg) iiuile liriinnicli sur ce point. Gérardiii 10) décril
sous le nom de lanier un faucon de petite taille, originaire
de la Suisse, el <|ni parait se rapporter au liobercau. 1,'oiscau
iguré ]>ar liuffoD 1
nàie du faucon •
:omuic espèce, 01
0
omninn. Huber 12) n'adopte pas le lanit
plutôt il le prend pour
nous l'avons couslalé en Irailant du sacre, à cette espèce par
l'allas el par Peni.anl, cûl e«mplc fui imité pur ^anlual
Temminck i3) qui dccrivaienl le sacre d'après i.alure sous le
de lanier, et dès lors tous les naluralisles postérieurs s'empressèrent
de suivre cel exemple. On voil par ces données que
puis 1-liuic les iiBliiralistes i^éservaient coiislammenl le 1
de lanier pour désigner qucliiuc espèce de faucon noble, 1
<iu'lls élaiem peu d'accord sur l'espèce qui devait porter ce n
aussi onl-ils souvent confondu, parmi les synonymes de cel ois
les espèces les plus bélérogènes, de sorte que l'on ne peul guère
cilcr les ouM-ages de ces ccri\ains sans commeltrc de doubi
ploisde noms 14).
11 psI clair d'apria ce que nous venons de co.isialer sur l'applicaliou
du nom de lanier ¡1 des c»])èces d'oiseaux de proi
dilïère K des ai ,e pouv!
former qu'une idée asseï confuse de la véritable |>alrie du laer.
Jean de Franchières, G. Tardif, cl après eux la plupart
des fauconnics el naluralisles français jusqu'à Buffon, consla-
:„t ciue le lanier esl un oiseau commun en tout pays, partièi
emeut en Fi-ance, oii il fait son aire sur les arbi'cs élevés
bois- Soil qu'ils aient i>uisc ces renseigncmeiils dans l'ouvrage
d'Albert le grand, dont les laniers sont, comme nous
DUS vu plus baiit, des oiseaux irès diffèreuls dn véritable
ler el à la vérité communs [lar toute riinroije; soil qu'ils
U répélé ce qu'ils avaient lu dans les ouvrages des faucon-
I-S ai-abes et gi-ecs, qui avaiem tout le droit de dire que le
ier est nn oiseau commun en toui |>avs, c'est à dire, dans
pays qu'babilaicnt ces fauconniers; soit enfin, qne l'on prit
,s un sens trop élendu les indicalions de d'Aronssia qui veut
effet «lue le lanier se trouve dans le midi de lii l'i-ance: ces
eurs, une fois reçues, ne cc.ssèreiil de se propager ei de
l'acci^édiler. Ce lïit encoi-e pire, biiqu'ou eut «iicccssi vein eut
décrit sous le nom de lanier, le faucon blanc, le gerfaul, le
faucon commun, le s.icre, l'émérilloii el d'anires espèces; dès
géogniphiquc de CCS oiseaux, au sacre que Ton désigna sous
nom de lanier; on faisait babitcr ce prétendu huiicr eu
igrie, eu Russie, en Tatarie, el même dans l'\mérlque
du Kord; on soutenait qu'il s'égarait jusqu'en Suède, en An-
•re, auxiles Fur cl en Islande; et Sonnini el Vieillot i5)
ni jusqu'à dire que le lanier était autrefois assci; comen
France, mais qu'il y a disparu pour se i-elircr dans
:onlrées plus seplenlrionides.
ityniologie du mot lanier est non moins obscuix- que celle
du mol de gerfaut. Ducaiige veut qu'autrefois en Fiance,
appelai! ainsi les bommes dégradés et làclies. I.es auleui^s
i ont écrit sur la fauconnerie, sont d'avis que ce mot esl
dérivé du latin, soit de .laua. (laine), soit de .Uniarius.,
(i,o.icher), cl que ccs oiseau-; ont éié design.
le la molle se de 1
riiiibitude de déchirer les aiiimaiix dont
ils se nourrissenl; suppositions dont la première est toiil an
plus applicable aux buses, tandis <inc la dernière nous pa.^il
bien gi-aluile, vu que l'babitude de déchirer la pi-oie esl commune
à la plupart des oiseaux de proie diuine.s.
On sail à la vérité f.ul peu de chose i-elaliveme.u a la distributioi,
géograpbi.iue, à la manière de vivre cl aux man,, dn
lanier. Nous avons conslalé plus haut que le bari.n de Feldegg
a tué, lors de ses excursions en Dalmalie, ([ualre in.lividus du
lanier; il «1 donc probable qne cel oiseau se Irouve hidulnellemenl
dans ce pays. Quoiiiu'il en soit, il n'a clé observé ,|ue
très rarement dans le-s autres parties de IT.urope, doni il ne
parait fréqucnicr qu'ace i de nielle ment les ]>iirlies Icnipérée,- \
l'exception des trois individus décrils par HnlToii, l.rvvin el Naun,
ann, je ne connais qu'un seni exemple que eel oiseau ait
is l'Europe cenlrale 1). Ia'S fuiiconniei-s bol
lient annucllcmeut un grand nombre de l'an
mimemeni n'avoir jamais vu cet oiseau à l'éla
sauvage.
Il parait qne le lanier l'ut autrefois assez recherché des faucoiuiieis,
attendu ([u'ils en parlent tous dans leurs ouvrages 2).
n'Areiissia 3), qui a le plus amplement traité de ce faucon,
rapporte <[u'il n'est point de meilleur oiseau à la perdrix, quand
il s'adonne à être bon, cl qu'il endure la captivité avec tant de
liicililé que l'ou a gardé de ccs individus dui-anl dix-huil à vingt
ans; mais, de l'aulre coté, cel aulcur constate que le lanier est
I>eurcux, poltron el d'nu naturel vilain. L'abondance des laniers
niais, dit cet auteur, vient de Sicile; ils font la plupart leurs
aires dans de grands rochei-s, et parfois aussi au haut de quelque
grand arbre; il en vient aussi de la Fouille, le.squels se prennent
dans les moulagues du pays. Quant au lanier de passage,
cel auteur assure qu'on en pi^nd en la Graux d'.Vrles, mais que
les meilleur viennent de la Craux de Vérone en Umbardie 4).
1)1' LANIER ,U.I'H.\NF.T OU TUNISIEN.
C'est sous ccs noms que les anciens fanconnieiï ont désigné
légères, étaiii à ce qu'il pai-ait cousianies, el c.
lai.ssanl ¡)ns se trouver dans les contix'cs liabiléc
nnpic des ai
Il de ce lanier aiphaiiet cl en riniroduisunt
comme race divei-se du vcrilable
Ix lanier alphancl ressemble en lonl point au lanier ordii
tant par .sa taille que par les proporlioiis relatives de la qi
(les ailes el des sw res, ainsi que ixir la couleur de la cin
e des y. •t des s. i. 11 p
varie aussi considérablcmcnl )>ar ra]>]>on à sa laille rjue le fauc(
ordinaire. Un jeune mâle de notre collcclion, qui nous a é
envoyé de la Grèce, a les ailes longues seulement de onze pouc
pent souvent que la lige des plumes; la couleur i-ongràtiv i|ui mvoil
sur ces parties, y domine |>ar consé<]uenl, cl coinine ellelire
forlenienl sur le brun-roux, la distribution des leinle-s sur
celle partie rappelle en quelque sorte celle qne l'on observe snr
la tèle de la pie-griècbe rousse, (Unins rnfus). Ue from lire,
à l'exceplion de sa parlic antérieure, fortemcnl an brun-noin-
Irc, el cette leinle s'étend ég.ilenieiit au-dessus <les yeux le ioiig
des bords latéraux de la Icte; elle occupe en outre les prties
supérieures el postérieures de la région des oreilles, el se pi-olonge
sur le devant de celle partie pour former ta lacbc en
moiislacbc, qui est par conséi]uenl plus foncée cl plus lai'ge
que dans le lanier ordinaire. Li couleur du fond du dos, des
panip.s postérieures du cou, cl de la facc exleine des ailes, lii-c
plus forlenienl au brun, cl les bordures cl taches claii-es donI
les plumes de ces parlies se irouvcnl oriH-es, soul beaucoup
moins apparentes, de sorte qu'elles se confondent plus on moin»
parfaitemenl avec la couleur dominante. Le croupion ofl'rc des
leinles ))lus sales, cl les bandes claircs de la cpieiic sent beaucoup
moins disliiictcs que dans le lanier. I.es parties inférieures
de l'oiseau présenlenl, à parlir de la ivgion du jabot, une
assez forle nuance de roux-brun pâle, qui se prolonge aussi
sur les couvertures inférieures des ailes, l.es plumes des jambes
e Il de fornu
Il parail que, iii rempereur Frédéric,
niei-s gi-ccs el arabes, n'ont distingué ce
ipüis l'ont par conséquent comprise sou
le lanier; du resie, on ne peul guère doi
le .<
• qu'ils n'aient connu
cel oiseau qui nous a été envoyé de la (Jrèce el de l'Égyple, ei
([ni se trouve probablement aus.<i dans pbisieui-s anires parlies il.-
l'Afrique seplenlrioiiiile- Jean de Francbièr« 5) en fait inenlioi.
sous le nom de «Tunisien», constatanl que ce faucon .s'approcbe
assez près du lanier el qu'il est nommé Tunisien, piirc
(pi'il vient de Barbai ie el lie Tunis. U plupart des auteurs <hfauconnerie
([ui ont écrit api-t's lui, ia|,porU-nl à peu près la
mcme cbose- n'Arcussia G) en donne deux ligures; il appell<-
cel oiseau «Umier alphaneU, nom arabe 7), quoiqu'il alTirm.-
que ce nom ail clé donné à ce làucon parles Grecs, c pour
esirc réputé en leur pays le ¡«cm ier oyseau de proye, dériva ni
ce nom de la prcniièix; lelire de leur alpbabd." Il dit un peu
pins haul: «ces oyscaiix .sont veni
Barbarie, on les appelle Tunissicm
pi-endre eu hi Grau. d'Arles e
s pre-n IIS de
1 ajoute qu'il eu a
e ceux qui viennent du
IS de Cnn.lip pins blomls