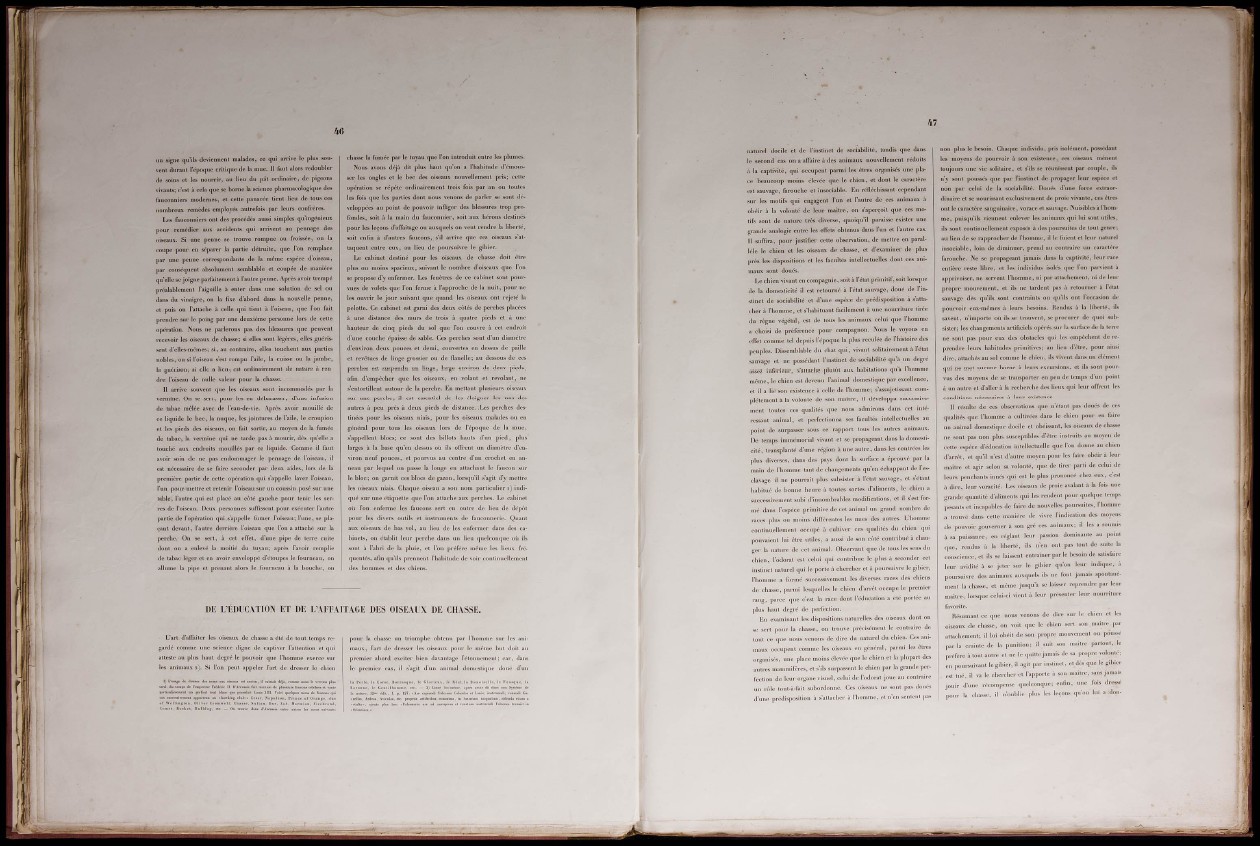
III! signe <iuils dovicnnciil iiialad«, ce qui arrive le plus so.ivei.
i durant l'éi)0<iue eriliqiie de !a .iiue. 11 f«iii oloi? redoubler
de soins el les nourrir, au lieu du p:il ordinAire, de pigeons
vivants; c'eil à cela que se borne la science phnrniacologiqiie des
laiiconnicis modci'ncs, «t celle paiiaeiie ticnl lieu de tous ces
iioiubiius i-enièd« employés autrefois par leui^s confrères.
Les fauconniers ont des procédés aussi simples qu'ingénieux
pour renn'<lier aux .icfidenls qui arrivent au pennage des
i. Si i i; penn.
coupe pour en scparei- la ¡»itie détruite, que l'on
par une penne corrcsponilanle de la même espèce
par conséquent absolument semblable et coupée d(
ière
qu'elle se joigne parfaitement à l'aiilre penne, Après avoir trempé
pi'éalablcment l'aiguille à enter dans une solution de sel ou
dans du \inaigi'C, on la fixe d'abord dans la nouvelle penne,
et puis on l'allaclie à celle qui lient à l'oiseau, que l'on fail
prcûdre sur le poing par une deuxième personne lore de celle
opération. ^Olls ne parlerons pas des blessures que peuvent
leecvoir les oiseai;\ de cliasse; si elles sont légères, elles guérissent
d'elles-mêmes; si, au conn^aii«, elles toucbent aux parties
nobles, ou si l'oiseau s'est rumpu l'aile, la cuisse ou la jambe,
la gnérison, si elle a lieu, est ordinairemeul de nature à rendi'e
l'oiseau de nulle valeui- pour la ebasse.
Il arrive souveni que les oiseaux soin incommodés par la
\ermine. On se scrl, pour les en débarasser, d'une infusion
.le tabac mêlée avec de l'cau-de-vie. Après avoir mouillé de
ce liquide le bec, la nuque, les jointures de l'aile, le croupion
et les pieds des oiseaux, on fail sortir, au moyen de la fumée
<lc tabac, la vennine qui ne tarde pas à mourir, dès qu'elle a
toucbé aux endroils mouillés par ce liquide. Comme il fani
avoir soin de ne pas endommager le pennage de l'oiseau, il
est néce.s.saire de se faire seconder par deux aides, lors de la
première parlie de cette opér.ilion qui s'appelle laver l'oiseau,
fini pour mettre et retenii- l'oiseau sur un coussin posé sur une
table, l'anlre qui est placé au côlé gauche pour tenir les set^
i-es de l'oiseau. Deux peisonues suffissent pour exécuter l'autre
partie de l'opération <|ui s'appelle finner l'oiseau; l'une, se plaçant
devant, l'autre derrière l'oiseau qne l'on a attacbé sur la
peiNibe. On se sert, à oel effet, d'une pipe de terre cuite
ibnt on a enlevé la moitié du tuyau; après l'avoir remplie
de tabac léger el en avoir enveloppe d'éIou]>es le foui'iieaii, on
allume ia piiic el piviiaul alors le foiu'neau .-i la boucbe, on
cbasse la fumée par le tuyau que l'on nitroduil entre les plume.s.
Nous avons déjà dit plus haul qu'on a fbabitude d'émousser
les ongles et le bec des oiseaux nouvellement pris; celle
opération se répète ordinairement trois fois par au ou toutes
les fois que les parties dont nous venons de prier se soul d.-
veloppées au poinl de pouvoir inlligei- des blessures Ii-op piv>-
fondes, soit à la main du fauconnier, soil aux bcrons destines
poin- les leçons d'alTailage oi
enfin s fau. , s'il a
Le cj
pl.
u lieu de r
e qne c s'alipacieux,
se propose d'y enfermer,
vues de volets (|ue l'on I
e gibier,
de cbas.se doit c
•c cabii!
rmc à l'approcbe de la nuil, pour ne
que quand les oiseaux oui rejelé la
rni des deux ci'ilés de perches placée.*
pelotte. Ce cabinet est g
à une distance .les murs de U'ois à quali'
hauteur de cinq pieds du sol que l'on coi
d'une couche é])ai5se de sable. Ces perches s
d'eQvii'on deux pouces et demi, couvertes c
et revêtues de linge grossier ou de llanelle;
pei-ches est suspendu un linge, large envirc
afin d'empt^cher que les oiseaux, en volai
s'enlortillent autour de la percbe. En incllaii
ml d'un diamètre
dessus de ]>aillc
I de deux pieds,
et revolani, ne
plusieurs oiseaux
d de les éloigne
•ds de distance, l.es perches
poui' les oiseaux malades o
X Ion de l'époque de la t
s billots banis d'un pied,
tinées pour les oiseai
général poui' tous h
s'aijpellent blocs; ce
larges à la base tgu'en dessus oii ils offrent ui
viron neuf pouces, cl pourvus au ccnlic d'un
neau par lequel on passe la louge en attachai
le bloc; on garnit ces blocs de gazon, lorsqu'il
it d'y n
que s,
pour
iix niais. Chaque oise
une étiquette que l'oi
enferme les íáucons
le aux pci'chcs. Le cabinet
:n onire de lien de dépôt
Ils de fauconnerie. Quant
les enfermer dans dos ca-
aux oiseaux de bas vol, au lieu de
binéis, on clablil leur perche dans
sont à l'abri de la pluie, et l'on préfère même
•luenlés, afin qu'ils prenncnl l'habitude de voir co
des hommes el des cbiens.
K frc^
DE UÉDl'CVTION IÌT DE I/AFF VITAOE DES OISEAI \ DE CHASSE.
1,'art d'aOáiler les oiseaux d a été de U nplic obtenu par fliomii
gardé connue une science digne de captiver Tallen
fan de dr,.:
atteste au plus liant degix- le pouvoir que l'homme
•r abord exci
les animaux a). Si l'on peut appeler l'urt de dresse
le p.x-, s'agit d-.in
naturel docile cl <le l'instinct de sociabilité, laudis que dans
le second cas on a affaire à des animaux nouvellement réduits
il la captivité, qui occupent parmi les êtres organisés une place
beaucoup moins élevée que le cbien, et doni le caractère
est sainage, farouche el insociable. E.i réilécbissant cependant
sur les motifs qui engagent l'un et l'autre de ces aniiuanx à
obéir à la volonté de leur maitre, on s'apcrçoil que ces mollis
sont de nature très diverse, quoiqu'il paraisse exister une
grande analogie eiilre les cfl'ets obtenus dans l'un cl l'auti-e cas,
Il suffii-a, pour jiisliiler cette observation, de mettre en parallèle
le chien et les oiseaux de cbasse, el d'examiner de plus
près les <li5po5ilions et les facultés inlellectuelles dont ces ani-
Le cbien vivant en compagnie, soit à l'état primitif, soit loi-sque
<le la donu-sticité il est retotirné h l'élai sauvage, doué de l'iiislinct
de sociabilité cl d'une espèce do prédisposition à s'alla-
,:ber à l'homme, cl shabituant tàciletneni à une noinrilnre tirée
du règne végétal, est de tous les animaux celui que l'homme
a cboisi de pi-éfereiice pour compagnon. ¡Nous le voyons en
..ITel comme lei depuis l'époque la i>lus reculée de l'histoire des
peni-h-s. I)is.semblal>le du cbat qui, vivant solilairemeul à l'éLil
sauvage et ne possédant l'instinct de sociabilité qu'à un degré
assez inférieur, s'allacbe plul'.v aux hal.ilalions qu'à l'homme
môme, le cbien est devenu l'.inimal domestique par excellence,
à celle de fhomme;
voloni, développa successiveinem
toutes ces qualités que nous nrons dans cet inléressaut
animal, cl perfectionna ses (acuités inlellectuelles au
poinl de surpasser sous ce rapport tous les autres animaux,
ne lenips immémorial vivant et se pi-opagcani dans la domcslicilé,
transplanté d'une région à une auire, dans les contrées les
plus divei-ses, dans des (lays dont la surface a éprouvé par la
main de l'homme tant de cliangcmeuls qu'eu écbappani de l'esclavage
il ne fiourrail plus subsister à félat sauvage, et «'étant
baliilué de hoiiiic lieure à toutes sortes d'aliments, le cbien a
successivemeiil subi d'innombrables modifications, el il s'est formé
dans l'espcec primitive de cet animal un grand nombre de
races plus ou moins dilTercnlcs les unes lies autres- l.'honiine
ronlinuelU-mciii occupé à cultiver ces qualités du chien qui
pouvaient lui être utiles, a aussi de son côté contribue à changer
hi nature de cet animal. Observant que de tous les .«-ns du
chien, l'odorai est celui qui coulril.uc le plus à seconder cet
instinct naturel qui le porle à chercher cl à poureuivre le gibier,
fhoninie a formé successivement les divci-ses races des chiens
de cbasse, ¡vn-mi les.piellcs le chien d'arrêt occupe le premier
i-aiig, paree .lue c'csl la race dont l'é.lncalioii a été porléf an
plus haul degré de perfection.
Kn examinant les dispositions naturelles des oiseaux dont on
e sert p.,ur la
IS .le .lire du naturel .l.i chien. Ces :
ien e. b pbq.aH de.
11 par la grande per
fectioii de leur o.-gane v isuel, celui de l'o.lorat joue au contrai
un rôle loul-à-l'ait subor.lonné- Ces oiseaux ne sont pas il.ui
.rinic prédispi.sition à s'altacber il l'b.inune, el n'en senleni p
non |>lus le besoin. Chaque indivi<lii. pris isolément, possédi
les moyens de poui'voir à son exislence, ces oiseaux mèn.
toujoui-5 une vie solitaire, et s'ils se réunissent par couple,
n'y sont poussés que par l'instinct de propager leur espèce
non par celui de la sociabilité- Doués d'une force extra
dinaire et se nourissant exclusivement d.; proie vivante, ces et
sanguin; vage. KNn isiblesà fh<
li lui SI
ils sont cou ti nudi cm cnl exposés à des poursui
an lieu de se rapprocher de l'Iiomine, il I.. fui.
insociable, loin de diminuer, prend an coni,
farouche. Ne se ¡>i-opug.-ant jamais dans la captivité, leui
apprivoiser,
jiropre moi
:l les individus isolés .|ne l'on parvienl à
Il fbomnie, ni par allachcnieni, ni de leur
«t ils ne laixleiil pas à rcl.mrner il l'état
)nl conlraiiiLs ou q.i'ils ont l'occasion d.'
ù leure besoins, lieiid.is à la iiberlé, ils
, n'importe oil ils se trouvent, se procurer de quoi subies
cliangenienis arliliciels opérés sur l.i surface de hi teriv
it pas i>our eux des obstacles qui les empêchent <lc rehabilmles
primitives I il'êl
.ittacbés au sol connu., le cbien, ils vivent dans un élémeni
qui ne met aucune borne à leure excursions, el ils son! pourvus
des moyens de se li-anspo. ter en peu .le temps d'un ¡iniiil
à un autre et d'aller à la i-ecbcrebe .les lieux .¡ui leur olfreiit Iw
conditions nécessaires à leur existence.
Il résulte de ces obscnatioiis que n'émut pas doués de ces
qualités que l'bomme a cultivées dans le .•hi,.u pour en faire
un animal domestique docile et obéis-sant, les oiseaux de cluLvse
ne sont pas non plus susceptibles d'être inslri.its an moyen de
celle e.spèce d'éducation inlellecluelle que l'on donne au chier.
d'arrêt, et qu'il n'est d'aiiire moyen pour les faire obéir à leur
maille et agir selon sa volonté, que de tirer parli de celui de
leni'S pciichanLs innés qui est le plus prononcé chez eux, c'est
à dire, leur voracité, (-.'s oiseaux de proie avalant à la fois une
grande qn.inlilé .l'alimenis qui les rendent pour q.ielque t.^nips
ca|>al
é d.ins
ibles de faire de i
e de ivre l'indici 1 des n
n gré c.
i. pui nice, eu réglant leur passic
rendus à lu liberté, ils n'en o
se lais-seiil cnirainer l
jeter sur le gibier
I poinl
,1 de SI
; besoin de silislàin-
:quels ils ne foni jamais s]>onlauémenl
la cbasse, el même jus<iu'ù se lais^.r reprendre par leur
maille, lorsque celui-ci vient à leur presenter leur nourriinre
s de din
X de c e par
utt.ieliemenl
par hi crair
il de s. u pon.s.>
; de la punii
propre luo
¡1 suil -son uiailre parloul, Ic
,loul autre el ne 1.^ quille jamais de sa prop.e voloule:
nivant le gibier git par instinct, cl d. s que le gibier
il va le chei-cber ct fapporle a sou mallre. suns jamais
me i-iconipeiis.i qnelconq.ie; cnii
• basse, il n'oubl.c plus l.'S I.Tor
à