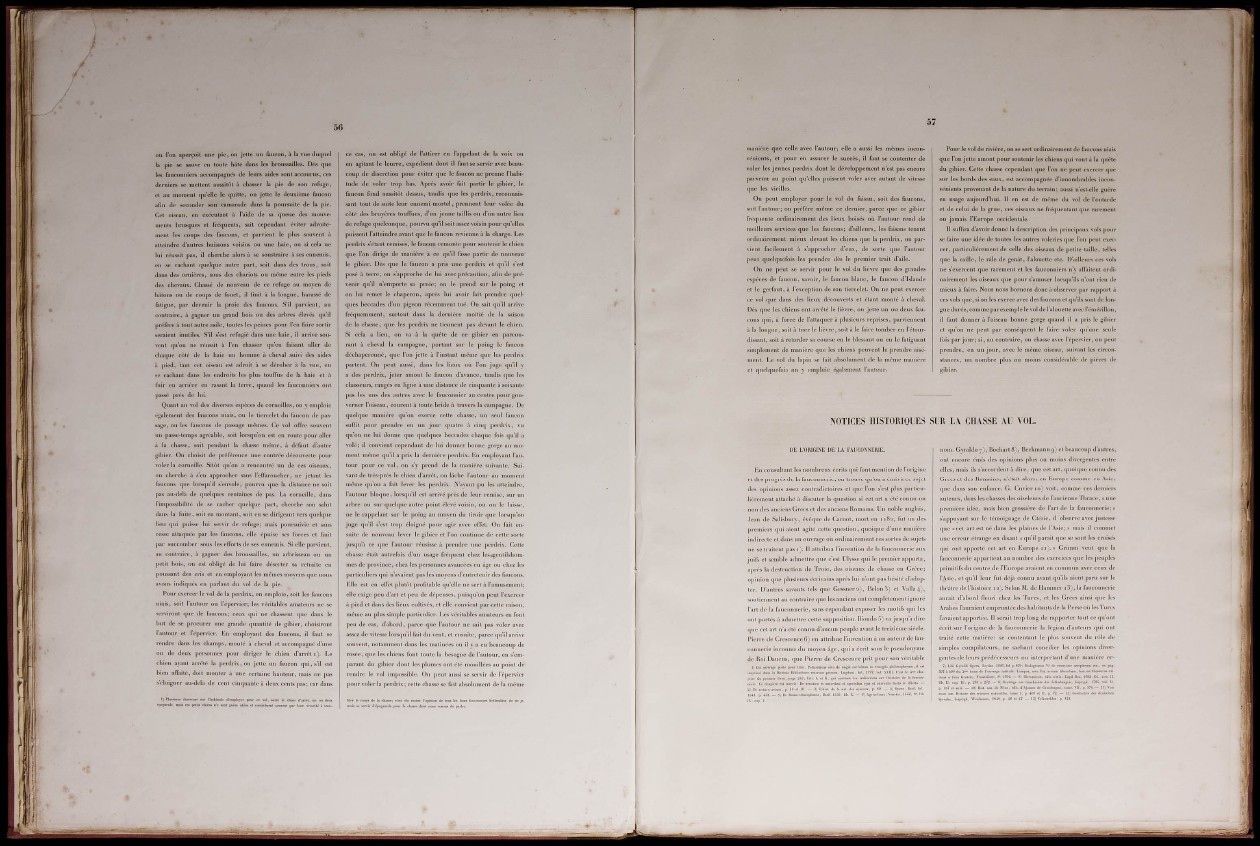
oil l'on aperçoit une pie, on jelte un faucon, à ia vue duquel
I.T |>ip se sauvp en louli- liàle clans les hi'oussailles. Di''S que
les laucoixniei's nccompagnis du leurs aides sont accourus, ces
derniers se inoMeui aussitôt à cliasser la pic de son refuge,
et au mnnipnl qu'elle le (piitte, on jette le deuxième faucon
a(in de seconder son camninde dans la poursuite de la pie.
Cet oiseau, en exdciitaiU à l'aide de sa queue dos mouvenieiils
brusques et fi-équcnls, snit cependant éviter adi-oitei.
uiut les coui>s des faucons, et parvient le plus souvent à
uticindi-e d'auti'cs Iniissoiis voisins ou une liaie, ou si cela uc
lui réussit pas, il elievche alors à se soustraire h ses ennemis,
eu se cacliaut quelijue autre pari, soit dans des trous, soit
dans des oiilit^ros, sous des chariots ou mime cuire les pieds
des chevaux. Cliassc de notneau de ce refuge au moyen de
limitons ou de coups de fouet, il (iiiit à la Imigue, hnrassù de
fatigue, devenir la proie des faucons. S'il parvient, au
contrsiii'e, à gagner lui grand liois ou des arhres élevés qu'il
préféré à tout autre asile, toutes les peines pour l'en faire sortir
sei'aient inutiles, S'il s'est ivfugié dans uiie haie, il arrive souvent
qu'on ue réu.<sil U l'eu cliasseï- c|u'ei> Husani aliei' de
chaque côté de li< haie lui homme à cheval suivi des ai<lc.s
il pied, tant cet oiseau est adroit à se dérober ii la vue, en
se tachaul dans li-s endroils les plus loufTus de la haie et ii
fuir eu arriùi'e eu nisiuit la lerie, quand les faucouniei-s ont
passe près de lui.
Quant an roi des diverses cspcces de corneilles, on y emploie
également des faucons niais, ou le liei-celet du faucon de passage,
ou les faucons de passage mêmes. Ce >'oI offre souvent
lui passe-temps agi'éalile, .soit loi'squ'oii est eu route ])our aller
il la chasse, soit peiuhiiit la chasse mèine, à dél'aul d'autre
gibier. On choisit de piéfoi-cnce une contrée découvei'te ])oiiv
voler la .. Sitôt
ou clierchc à s'en approcher sans l'enarouclier, ne jelant le.'i
faucons que loi-sc|u"il s'envole, pourvu ([ue la dislancc ne soit
pas au-delà de quelques centaines de pas. U corneille, dans
fimposilhililé de se cacher quelque pari, cherche son salut
ihuK la fiiitc, soit cil moulant, soit en se dirigeant veiï quelque
lieu qui piii.ssc lui servir de refuge; mais poursuivie et sans
cesse attaquée par les faucons, elle épuise ses fo.'ces et finit
par succomber sous les cITorts de ses ennemis. Si elle i>arvienl,
iiu contniiiv, à gagner des broussailles, un arbrisseau ou un
petit bois, ou est obligé do lui iàire déserter sa retraite eu
piuissant des cris et en employanl les mêmes moyens que nous
avons indiqués on parlant du vol de la pic.
l'our exercer h- vol de hi perdris, on emploie, soit les faucons
niais, soit l'aulour ou l'épervier; les véritables amateurs ne se
srnirout que de faucons; ceiiN qui ne chasscnt que dans le
but lie se proeiiivr une grande quantité de gibier, choisiront
fautour et l'épervier. lin employant des faucons, il faiii se
reiiiire dans les champs, monté à cheval et accom]>agné d'une
nu <1« deux personnes i>our diriger le chien d'arrct i). I.e
chien ayaut arn-té hi perdrix, on jelte un làuton qui, s'il est
bien alTaité, doit monter il une certaine hauteur, mais ue pas
s'éloigner au-delà de cent ciiuinanlc à deux cents i>as; car dans
ce cas, on est obligé de l'attirer en l'appelant de la voix ou
en agitant le leurre, expédient dont il faut se servir avec beaiicou]>
de discrétion pour éviter que le faucon ne prenne l'habitude
de voler tj'op bas. Api-cs avoir fait partir le giliior, le
faucon fond aussitôt dessus, tandis que les perdrix, reconnaissant
tout de suite leur cnnenii mortel, preuneiH leur volée du
coté des bruyères I
de refuge queIcon<|i
iffiics, d'un jeune taillis ou d'un autre lieu
, |)Ourvu qu'il soit assex voisin (lour qu'elles
^nt que le faucon revienne à la charge. I.es
i, le faucon remonte pour soutenir le chien
lanière à ce qu'il fasse partir de nouveau
; faucon a pris une perdrix et qu'il s'est
que l'on dirige de manière à c
le gibier. Dès que le faucon a
posé à terre, ou sapproclie de I
venir qu'il n'emporle sa proie;
on lui remet le chaperon, apn
ijiies beecades d'un pigeon réce
de ta chasse, que les perdrix m
avcc precauti(ui, alin de prc-
1 le preiid sur le poing et
hii avoir fail prendre quelranl
à cheval 1
pas devant le chien,
e gibier en iiai-coule
campagne, portant su
.e l'on jaio i ri„.l.„l ,
l aussi, dans les lieux
ter amonl le faucon d'i
en ligne à une dislance de ci
déchaperonne, qn
chasseurs, rangés c
|>as uns des a
le fauconnier a<
poing le Ihiicoii
icme c,«e les peltri,
où l'on juge qu'il y
vcrner l'oiseau, courent à tonte bride à travei« la campagne
quelque m.nilèro (pi'on e\erce cette chasse, un seul fai
suffit pour prendre en un jour quatre à cinq pei-drix.
qu'on ne lui donne que ((iiehpies becrades chaque fois (p
volé; il convient cependant de lui donner bonne gorge au
meut même qu'il a pris la dernière perdrix. Kn oniplovaiit
tour pour ce vol, on s'y prend de la nianière suivante,
vani de Ircs-près le chicli d'arrct, on lâche l'autour au nioi
mòni. e qu'on a fait lever les perd rix. IS'ayi un pu les attclmlro,
l'ante lur bloque, loi'squ'II est arriv c près de leur remise, sur un
arbre ou sur quehiue aul re point élevé voi! «n, oii on le laiss...
ne le i^ppelant sur le po Ing au rrlo yen du tiroir que loi'sqii'on
juge qu'il s'est Irop élol;: ;né pour agir ave c effet. On fait ciisuite
de nouveau Icvor h. gibier c• t I on COiiIl lnue de celle sorlijnsqi.
l'à ce c,ne l'aulour 1 prendre unc peixlrix. Celle
cbassc était autrefois d'ui, 1 usage 1F réipieut chez, les^uutilsliomge
ou cho.. Us
Klle est en elfct pliitôl prolilahic (prelle ne sei
elle exige peu d'art et |>eu de dépensis, piil.sqiH
à pied et daius dc.^ lieux cnlllvés, et elle convient
même au plus slm|>le priiculler. I.es véritables
peu de cas, d'abord, parce que l'autour ne sai
assc< de vitesse lorsqu'il fait du veut, et ensuite,
souvent, notamment dans les malinécs où il y a
rosée, que les chiens font loiile ia besogne de I
parant du gililcr dont les plumes ont été moul
rcmlre le vol impossible. On peut aussi .se sei
pour voler la pmlrix; cette chasse se (ait aWlui
maidère que celle avec l'aulour; elle a aussi les mêmes il
vénienU, et pour en assurer le succès, il faut se contenl
voler les jeunes perdrix dont le développement n'est pas ei
u point qu'elles puissent voler avec aulanl de v
e les V 'illes.
On peut employer pour le vol du faisan, soit des faucons,
soit l'autour; on préfère même ce dernier, parce que co gibier
fréquente oi-<lliiairement des lieux boisés où raïUonr rend de
meilleui's services que les faucons; d'aillcui-s, les faisans tenant
nrdi uni renient mieux devant les chien.« que la perdrix, ou parvient
facilement à s'approcher d'eux, de sorte que l'autour
peut quelquefois les prendi« dès le premier trait d'aile.
On ne peul se servir pour le vol du lièvre que des grandes
espèces de faucon, savoir, ie faucon blanc, le faucon d'Islande
et le gerfaut, à l'cxcepllon de son llci-celel- Ou ue peut exercer
ce vol que dans des lieux découverts et étant monté à cheval.
Dès que les chiens ont arrêté le lièvre, on jette un ou deux faucons
qnl, à force de l'attaquer à plusieui-s reprises, parviennent
à hi longue, soit à tuer le lièvre, .soit à le faire tomber en l'élourdissant,
soit à reUn-der sa course en le blessant ou en le fatiguant
simplement de manière que les chiens peuvent le prendre alsémenl.
Le vol du l.-ipin se fait absolument de la même manière
cl quelquefois on y emploie égalemciil l'aulour.
Pour le vol de rivière, on sescrl ordinairemenide faiicoiis niais
:iuc l'on jette amont pour soutenir les chiens qui vont â la quête
Ju gibier. Celle chasse cependam que l'on ne peul eieiter que
«ir les bords des eaux, csl accompagnée d'iiinombnibles inconténicnls
provenant de la nature du leri'aiii; aussi n'esl-clle guère
m usage aujourd'hui. Il en est de même du vol de l'ouiardc
st de celui de la grue, ces oiseaux ne fréquenlani que rarement
au jamais l'Europe occidenlalc.
Il suffira d'avoir donné la description des principaux vols pour
se faire une idée de toutes les autres volerles que l'on pciii exercer,
parllcullèromcnt de celle des oiseaux de petite (aille, telles
que la caille, le ràle de genàl, l'alouette etc. D'aillcu.'b ces vols
ne s'exercent que l'aremcnl et les fauconniers n'y affalleul ordinaircnienl
les oiseaux que pour s'amuser lorsqu'ils n'onl rien de
mieux .à faire. Nous nous bornons donc à observer par raiiporl à
ces vols que, si on les exerce avec des faucons et <[u'lls .«ont de longue
durée, comme parexemple le vol de l'alouette avec l'émérillon.
Il faut donner à l'oiseau bonne gorge quand II a pris le gibier
et qu'on ne peul par conséquent le faire voler qn'une seule
avec l'éperv
isidérahie d
NOTiOTS lUSTOlUQlES SliR TA Cil VSSE AU \ OL.
DE L'OQIGIM; UE LA FAI.C0N1SERÌE.
m les m
et des pi'Ogivs de In fauconnerie, on ti-oiivc qu'on a émis .'i c
dos opinions assez conInid icioires cl i[iic l'on s'est plus p;
llèrenient attaché à dlsculci- la qncsilon si cct ari a été cou
non des anciens Grecs et des anciens liomains. Un noble ai
.Iran de Salisbury, cvêque de Girnot, mort en ii8q, ftil i
Ole et dans un ouvrage o
irailcnt pas i). Il al,rib.
1 semble admcllre que <
la destriicllou de Troie
•n quo phisleui-s cci lval.
uentL sortes de sujets
n de la fauconncric aux
qui le premier apporta,
n'onl pas hisltéd'adop-
, UelonS) Cl Vallai),
ntcoinpiélcmeni Ignoré
poser les mollfsqnl les
supposition. Biondo 5) va jusqu'il di
aucun peuple iivant le ècle.
nom. Gyr.ihlo 7), RocliariS), licckinanng) et beaucoup d'aulres,
ont encore émis des opinions plus ou moins divei'genles entre
elles, mais Ils s'accordent ¡1 dire, qiie cel arl, iinoli|ue connu des
Grecs et des Komiiiiis, n'était alors, en Knrojir comme en Asie,
que dans son enlànce. G. Cuvier 10) volt, conimr ccs derniei-s
aulein-s, dans les chasses des oiseleurs de l'ancienne Thracc, .une
première idée, mais l>:en gi-osslère do l'art de la fauconnerie;
s'appiiyanl sur le témoignage de Ctésic, il observe avcc jtisle.ssr
>é dans les plaines de l
erreur étrange en dl.sanl . qu'il pa.ai
ont apporté cet ail en Knrope 11).
i des e:
snni h-s d'Oise'«
m veut ,p,e la
fa uc (ni lie rie appartient an nom! que les pciipk^s
primitifs du centre de riûii-ope avalent en commun avec eeui
l'Asie, et qu'il lonr fut déjii connu avani qu'ils aii-nl paru su
Ihéiiirede l'hisloire 12). .Selon M. de Hamuicr |3), la faiiconn
ani-alt d'abord IleorI chez les Turcs, cl les Grecs ainsi que
Arabes l'auiaicnl cmprunlée des habilanls de la l'erse oii losTi
l'avalent apporléc- Il sci-ait troj. long de nipporler tout ce qu
écrit sur l'origine de la fauconnerie la légion d'.nuleni-s qui