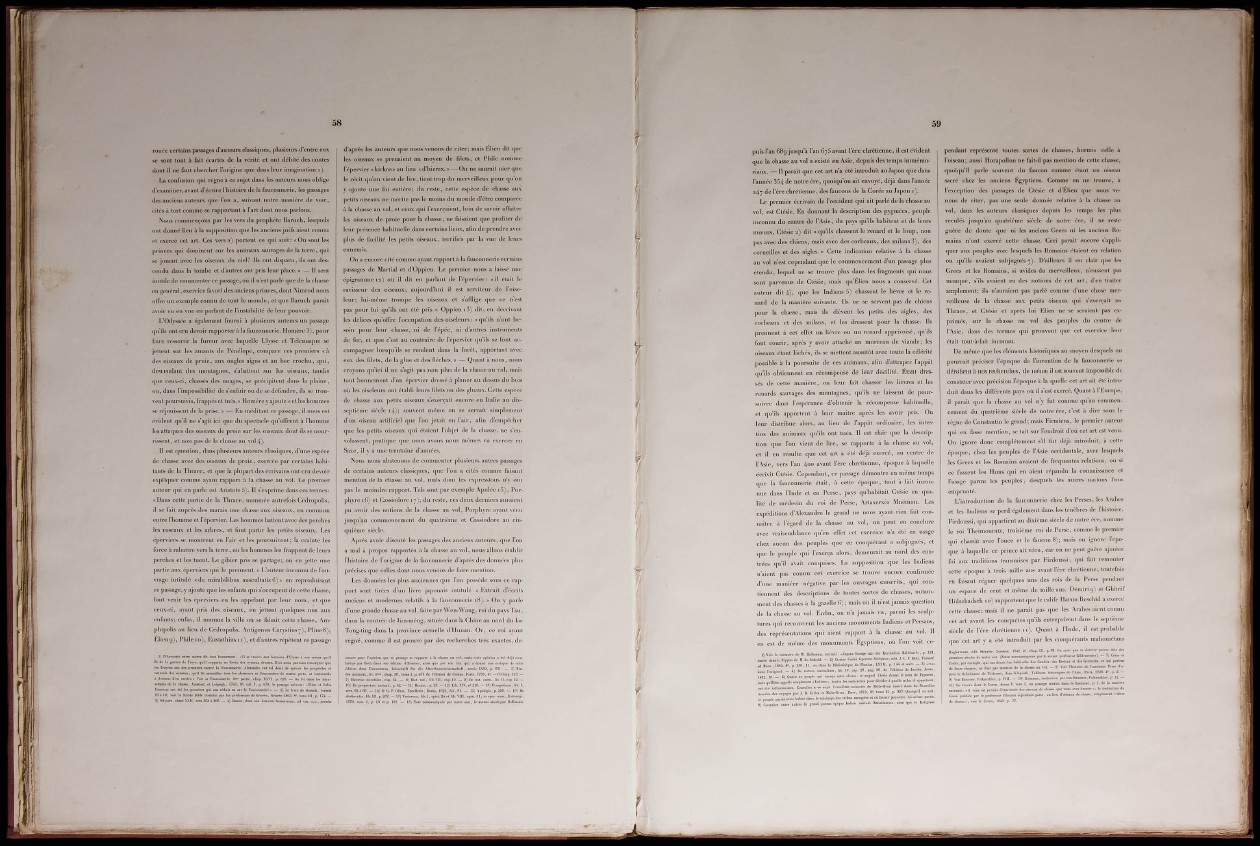
roiit'C corlains pns&ûgcs il'autuurs classi(|n«s, plusiciii's cIViili'c eux
soi.l loiil à fail ¿Ci.vl«s do la Tcrilé cl oui .l.îl.ilc .les coii.es
iloiil il ne faiil cheitlier rovigiiie que dans leur imngiiialion i).
Iji coni'iision qui règne à ce siijcl dans les aiilciifs nous olilige
d'examiner, avaiil d'écrlie l'iiisloii'e de lu laiicoiinei'ie. l » pas-siigos
c:ilés à lorl ooninic se i'iq>|>oi'laiil à l'ai l donl nous pai luiis.
^ous commençons par les veiï d.i prophète «anirl., lesquels
oui (loiinr lieu ù la supposilion que les anciens juifs aieni cuiiiui
fl cxei-co cet arl. Ces versa) poileul ce qni suil: «Oii sonl les
prinres qui dominenl sur les animaux sauvages de la (erre, qni
se joiient avec les oiseaux du ciel? Ils ont disparu, ils onl desccudu
dans la loml>e et d'auli cs ont pris lenr plaee.. - il sera
inulilc decommeulcrce passage, oii il n'esl parlé que de la cliasse
en i^éitéi-al, exercice lavoi i des aucicns princes, donl iViiiiroi! nous
oilif uu exemple connu de tout le monde, et que Uai ncli parail
avoii- eu en vue en parlant de rioslal>iliu:> de leur pouvoir.
L'Odyssée a cgaleincnt fourni ù plusiciuï nuteui's un passage
cju'ils ont cru devoir i-apjjorler il la fauconnerie. Homère 3), pour
l'aire ressortir la fureui' arec laquelle Ul.v&se cl l'éléma(|uc se
jellciit sur les iimauls de Pénélope, compare ces premieii »à
des oiseaux de proie, aux ongles aigus cl au bec ei-oelui, qui,
.lescendaul des moutagues, s'aballcul sur les oiseaux, tandis
que eeiix-ci, cliassés des nuages, se précipiieut dans ta plaine,
où, dons l'impossiliililé de s'enfuir ou de se défendre, ils se trouvent
pnuriiuivis, fiuppéscl tués.i Homère y.ijoutc < et le.s hommes
se .•éjoniisenl de la prise-. — Kn n.édilanl ee p:is.s,ge, il nous est
évident qu'il ne s'agit ici que du spectacle cproffi-ent à l'homme
les attaques des oi.seaux de proie sur les oiseaux dont ils se niiui^-
ri.«senl, el uou pas .le la cUas.«c au vol 4)-
Il est question, dans jihisieurs auleurs classiques, d'une espèce
<le cliasse avec des oiseaux ilc proie, exercec par cei'Iains lialiilaiils
de la Thrace, et que la plupart des écrivains ont cru devoir
e\pli(pier connue ayant ra]>])ort à la chasse au vol. l.e premier
auteur qui en parle est ArisloteS). Il s'exprime dans ces ternies:
" Dans celte partie de la Tlirace. nommée autrefois Cédrapolis,
il se l'ail auprès des marais une cliasse aux oiseaux, en commun
entre l'homme et l'épervier. IA-S liomm(!S lia il eut avec des |)erehes
les roseaux et les arbre-s, el fout partir les petils oiseaux, l.es
éperviers se montrent en l'air et les poursuivent; la crainte les
force à rabattre vers la terre, oil les hommes les Imppent de Iciir.s
peithes et les tuent, gibier pris se partage; on en jcltc une
partie aux éperviers (¡ui le (uennent- r L'aulcnr inconnu de l'ouvrage
intitule «de mirabilibus auscultatis 6)•> en reprnduiMint
ee l>assage, y ajoute que les enfants qui s'occupent de cette eliasse,
font venir les éperviers en les appelant pur leur nom, el <iue
ceux-ci, ayant pris des oiseaux, en jettent quelques uns aux
enlhnls; enfin, il nomn.e la ville oi. se faisait celle chasse, .Vmphipolis
au lieu de Cédropolis. Aniigouus Carvslius;), PlineS),
L n ) P e r. p
d'après les auteur (|ue nous venons de citer; mais Élien dit qi
les oiseaux se pi-enaicnt au moyen de tilels, el Miile noinn
l'épervier »kirkos» au lieu «d'hierax.» — On ne saumii nierqi
le rècit qu'on vient de lire, lient trop du merveilleux pour qin
y «joi, e foi e
le pas le m
les oiseaux de proie pour la clias
leur présence habituelle dans cori
plus de facilité les petils oiscau>
onde d'èli'e comparé.
aliii de prendre
On a encore cité comme ayant rapport à la fauconnerie certains
passades de Martial et d'Oi)pien. i.e premier nous a laissé une
épigrammeia) oii il dit en parlant de l'épervier: .il était le
i-avisseur des oiseaux; aujourd'hui il est sei\ileur de l'oiseleur;
lui-même trompe les oiseaux el ¡¿'afflige que ce n'esl
pas pour lui qu'ils onl été pris.» Oppien i3) dit, eu décrivanl
les délices qu'offre l'occupation des oiseleurs: «qu'ils n'ont besoin
pour lenr cliasse, ni de l'épéc, ni d'auti-es inslrunienU
de fer, et que c'est au contraire de répervicr qu'ils se font accompagner
lomprils se rendent dans la foret, apporlani avec
eux des rdets, de la gliie cl des llèches. . - Quant à nous, nous
croyons qu'ici il ne s'agit pas non plus de la chasse au vol, mais
toiil honnement d'un épersier dress<'' à planer au dessus du bois
oii les oiseleurs ont établi leurs fdcts on des ghiaux. Celte espèce
de ehas.sc aux i>elits oiseaux s'exerçait eucoi-e en Italie au disseptième
liièele |4); souvent même on se servait sinqilenient
d'un oiseau artilicie! que l'an jelail en l'air, alln d'empcelier
•aiLX qui étaient l'objet de l:i chasse, ne s'eiivolasscnl,
pratique
pas le moindre rajiport- Tel
phvre iG) el Oissiodore 17); du
lemple Apulée
cliasse au vol, Porphyre a
:t Cassiodor
Après avoir iliscuté les passages des anciens ailleurs, ((lie l'on
a mal à propos rapportés .i l:i eliasse an vol, nous allons éhiblir
l'histoire de l'origine de la fauconnerie d'après des données plus
précises que celles donl lions venons de ikire mention.
l.es données les pins ancienues ipie l'on poss.'-de si
port SI e japon
:lalifs :
ituié . Kxlri
. 1 8 ) . . (
d'une grande chasse au vol, faite par \Ven-Wang, roi du piiv
dans la contrée de Jiin-méng, située dans la Chine au nord .
Tong-ling dans la province aeluelle .l'ilinian. Or, ce mi
puis l'an 689 jusqu'à l'an 676 avant l'ère chrétienne, il est évident
qiie la chasse au vol a existe en Asie, depuis des temps immémoriaux.—
Il parait que cet art n'a été introduit au Japon que dans
l'année 334 de notre ère, quoiqu'on ait envoyé, déjà dans l'année
347 de l'ère clirétienne, des faucons de la Corée au Japon i).
premier écrivain de l'occident qui ait parlé de la chasse au
vol, est Ciesie. En donnant la description des pygmées, peuple
inconnu du centre de l'Asie, du jiays qu'ils liabitent el de lems
moeurs, Ctésie 2) dit « qu'ils chassent le renard et le loup, non
pasa >c des chie s, mais ¡ :c des c.
corneilles et des aigles. » Cette indi
des milans3), des
>lative à la cliasse
clend.1, lequel ne se trouve plus dans les fragmei
sont parvenus de Ctésie, mais qn'Élien nous a c
auteur dit 4), que les Indiens 5) chassent le lié-
Iiard de la manière suivante, ils ne se sei-vent p;
pour la chasse, mais ils élèvent les pelils des
corbeaux et des milans, et les dressent pour h
ge plus
font cou
I cet effet un lièvre ou 1
-, après y avoir allaché
It lâchés,
possible à la poiuïni'
oblici
•s de c
1 renard appri\'oisé, tjn'ils
ssitol avec toute la célérité
lUX, afin d'allrapcr l'appât
leur docilité. Éianl dreschasser
les lièvres et les
renards sauvages des montagnes,
suivre dans l'espcranee d'obteni
el qu'ils apporlent à
leur distribue alors,
ailre après les
de l'a|)pSl ordina
lins des animaux qu'ils o> ,t tués. Il est cl: lir que U desciiplion
que l'on vient de lir e, se rapporte Í 1 la chasse au vol.
et il en résulte que cet a rl a élé déjà ex.sreé, au cenire de
l'Asie, vers l'an 400 avant l'ère chréllenne. époque à laquelle
écrivit Ctésie. Cependant, c :e passage démon tre en même temps
que la fauconnerie était, à celle
nue dans l'Inde el en Perse, pays
qu'habitait Ctésie en
lité de médecin du roi de l'erse
Aruixerxès Mnémone
expéditions d'Alexandre le grand n
iiaiti-e à l'égard de la chasse au
qu. elïct
chez niicun des peuples que ee coiiqucranl a subj
: pcu|)le ((iii I'exerca alors, demeurail au iiord
qu'il avait coiiquises. La siipposition que le.
d'unc maniere nigative par les
liennent des dcscriplions de ton
nieiit des cliasses a la gazelle 6); ni
de la chassc an vol. EnCiu, on n';
ivi-ages sanscrits, qui
i sones de chasses, n
Il les ai
pendant represenlé toutes sortes de chasses, liormis telle à
l'oiseau; aussi ilorapollon ne fait-il pas mention de cette ciias.se,
quoiqu'il parle souvent du faucon comme étant un oiseau
sacre chez les anciens Égyptiens. Comme on ne trouve, à
rexception des passages de Ctésie et d'Élien que nous venons
de citer, pas une seule domice relative à la chasse an
vol, dans les auteurs classiques depuis les temps les plus
reculés jusqu'au quatrième siècle de notre ère, il ne reste
guère de doute que ni les anciens Grecs ni les anciens Itoniains
n'onl exercé celle cliasse. Ceci parait encore s'appliquer
aux peuples avec lesquels les Romains étaient eo relation
ou qu'ils avaient subjugués 7). D'ailleurs il est clair que les
Grecs cl les Romains, si avides du meneillcux. n'ensscnl pas
manque, s'ils avaient 1
amplement; ils n'auiTii
veilleuse de la chasse
Thrace, el Clésie el
U des notions
,nt pas parlé e,
aiix petils oiseaux qui sex,
ipres lui IClien ne se seraiem
:primes, sur la an vol des peuples dii c
l'Asie, dans des termes qui pronvcnl
était loul-à-fait inconnu.
De même (pie les éléments liistorique
pourrait préciser l'époque de l'invenli.
dérobent à nos reclici-cbes, de même il (
constater avec précision l'époque à
dait dans les dilTérenls pays où il
il parait que la chasse au vol n'
cemeni <lu «piatrièmc siècle de i
règne de Constantin le grand; mai:
qui en fasse mention, se lait sur l'endroit d'<
On ignore donc complètement .s'il fut déjà
époque, ebci les peuples de l'Asie occidentali
les Grecs et les Romains avaient de fréquentes
ce fussent les Huns qui en aient répandu la
l'usage parmi les peuples, desquels les autr.
IJintrodnctic
exercé. Quanl à l'Europe,
Il connue qu'au commene
ère, c'est à dii« sous le
licns, le premier auteur
itroduit, à celle-
:l les Indici le per
Fiixlonssi, rpii appartii
¡ue à laquelle
foi aux li-adilio
:ellc épo<iue à
i fauconnerie chei les Perses, les Arabe^
également dans les ténèbres de l'histoire,
ni au dixième siècle de notre ère, nomme
i-oisième roi de Perse, comme le premlei
e el le faucon 8); mais i'époprinee
ail vieu, car on
Iransmises par Kirdoiu
ois mille ans avani fer
quelque
,c peulgii.:
i, qui fail
; ajoii
•égner quelques uns des rois de la l'ei-so penda
un espace de cent et même de mille ans. Démirig) el Gliil
HIdsthadsch lo) rai>porlcnt que le calife ilarun Resciiid a exer
celte cliasse; mais il ne parail pas que les Arabes aient coni
cet arl avanI les conquêtes qu'ils entreprirent dans le .seplièn
siècle de l'ère elmnieune 11). Q..anl à l'Inde, il est prolial
que cet arl y a été inli-oduit par les conquérants m.ihoméla