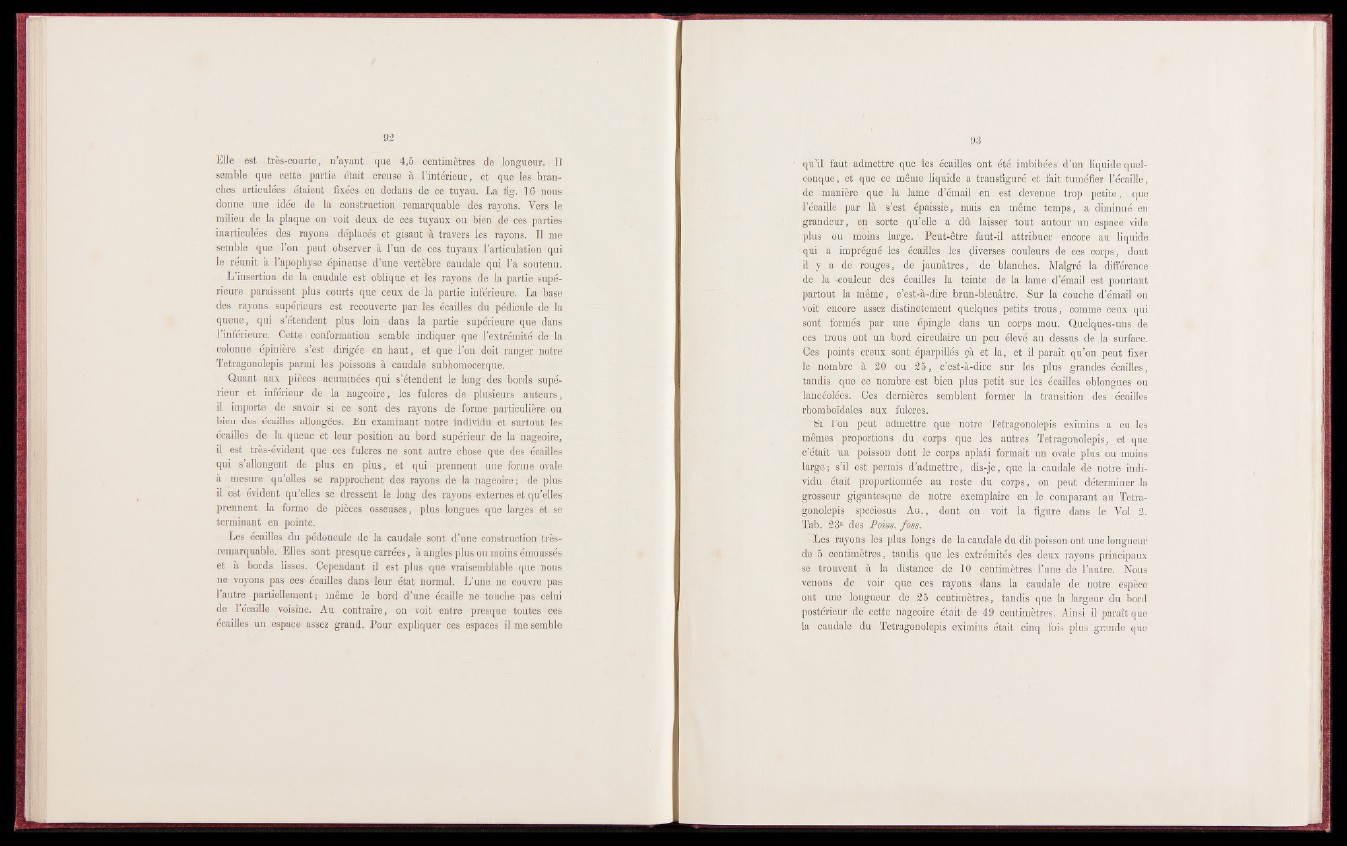
Elle est très-courte, n’ayant que 4,5 centimètres de longueur. II
semble que eette partie était creuse à l’intérieur, et que les branches
articulées étaient fixées en dedans de ce tuyau. La fig. 16 nous
donne une idée de la construction remarquable des rayons. Vers le
milieu de la plaque on voit deux de ces tuyaux ou bien de' ces parties
inarticulées des rayons déplacés et gisant à travers les rayons. Il me
semble que l’on peut observer à l’un de ces tuyaux l’articulation qui
le réunit à l’apophyse épineuse d’une vertèbre caudale qui l’a soutenu.
L’insertion de la caudale est oblique et les rayons de la partie supérieure
paraissent plus courts que ceux de la partie inférieure. La base
des rayons supérieurs est recouverte par les écailles du pédicule de la
queue, qui s’étendent plus loin dans la partie supérieure que dans
l’inférieure. Cette conformation semble indiquer que l’extrémité de la
colonne épinière s’est dirigée en haut, et que l’on doit ranger notre
ïetragonolepis parmi les poissons à caudale subhomocerque.
Quant aux pièces acuminées qui s’étendent le long des bords supérieur
et inférieur de la nageoire, les fulcres de- plusieurs auteurs,
il importé de savoir si ce sont des rayons de forme particulière ou
bien des écailles allongées. En examinant notre individu et surtout les
écailles de la queue et leur position au bord supérieur de la nageoire,
il est très-évident que ces fulcres ne sont autre chose que des écailles
qui s’allongent de plus en plus, et qui prennent une forme ovale
à mesure qu’elles se rapprochent des rayons de la nageoire; de plus
il est évident qu’elles se dressent le long des rayons extemes'et qu’elles
prennent la forme de pièces osseuses, plus longues que larges et se
terminant en pointe.
Les écailles du pédoncule de la caudale sont d’une construction très-
remarquable. Elles sont presque carrées, à angles plus ou moins émoussés
et a bords lisses. Cependant il est plus que vraisemblable que nous
ne voyons pas ces écailles dans leur état normal. L’une ne couvre pas
l’autre partiellement; même le bord d’une écaille ne touche pas celui
de l’écaille voisine. Au contraire, on voit entre presque toutes ces
écailles un espace assez grand. Pour expliquer ces espaces il me semble
qu’il faut admettre que les écailles ont été imbibées d’un liquide quelconque,
et que ce même liquide a transfiguré et fait tuméfier l’écaille,
de manière que la lame d’émail en est devenue trop petite, que
l’écaille par là s’est épaissie, mais en même temps, a diminué en
grandeur, en sorte qu’elle a dû laisser tout autour un espace vide
plus ou moins large. Peut-être -faut-il attribuer encore au liquide
qui a imprégné les écailles les diverses couleurs de ces corps, dont
il y a de rouges, de jaunâtres, de blanchesi Malgré la différence
de la ^couleur des écailles ; la teinte, de la lame d’émail est pourtant
partout la même, c’est-à-dire brun-bleuâtre. Sur la couche d’émail on
voit encore assez distinctement quelques petits trous, comme ceux qui
sont formés par une épingle dans un corps mou. Quelques-uns de
ces trous ont un bord circulaire un peu élevé au dessus de la surface.
Ces points creux sont éparpillés çà et la, et il paraît qu’on peut fixer
le nombre à 20 ou 25, c’est-à-dire sur les plus grandes écailles,
tandis que ce nombre est bien plus petit sur les écailles oblongues ou
lancéolées. Ces dernières semblent former la transition des écailles
rhomboïdales aux fulcres.
Si l’on peut admettre que notre Tetragonolepis eximius a eu les
mêmes proportions du corps que les autres ïetragonolepis, et que
c’était un poisson dont le corps aplati formait un ovale plus ou moins
large; s’il est permis d’admettre, dis-je, que la caudale de notre individu
était proportionnée au reste du corps, on peut déterminer la
grosseur gigantesque de notre exemplaire en le comparant au Tetragonolepis
speciosus Aa., dont on voit la. figure dans le Vol 2.
Tab. 33“ des Poiss. foss.
Les rayons les plus longs de la caudale du dit poisson ont une longueur
de 5 centimètres, tandis que les extrémités des deux rayons principaux
se trouvent à la distance de 10 centimètres l’une de l’autre. Nous
venons de voir que ces rayons dans la caudale de notre espèce
ont une longueur de 25 centimètres, tandis que la largeur du bord
postérieur de cette nageoire était de 49 centimètres. Ainsi il paraît que
la caudale du Tetragonolepis eximius était cinq fois plus grande que