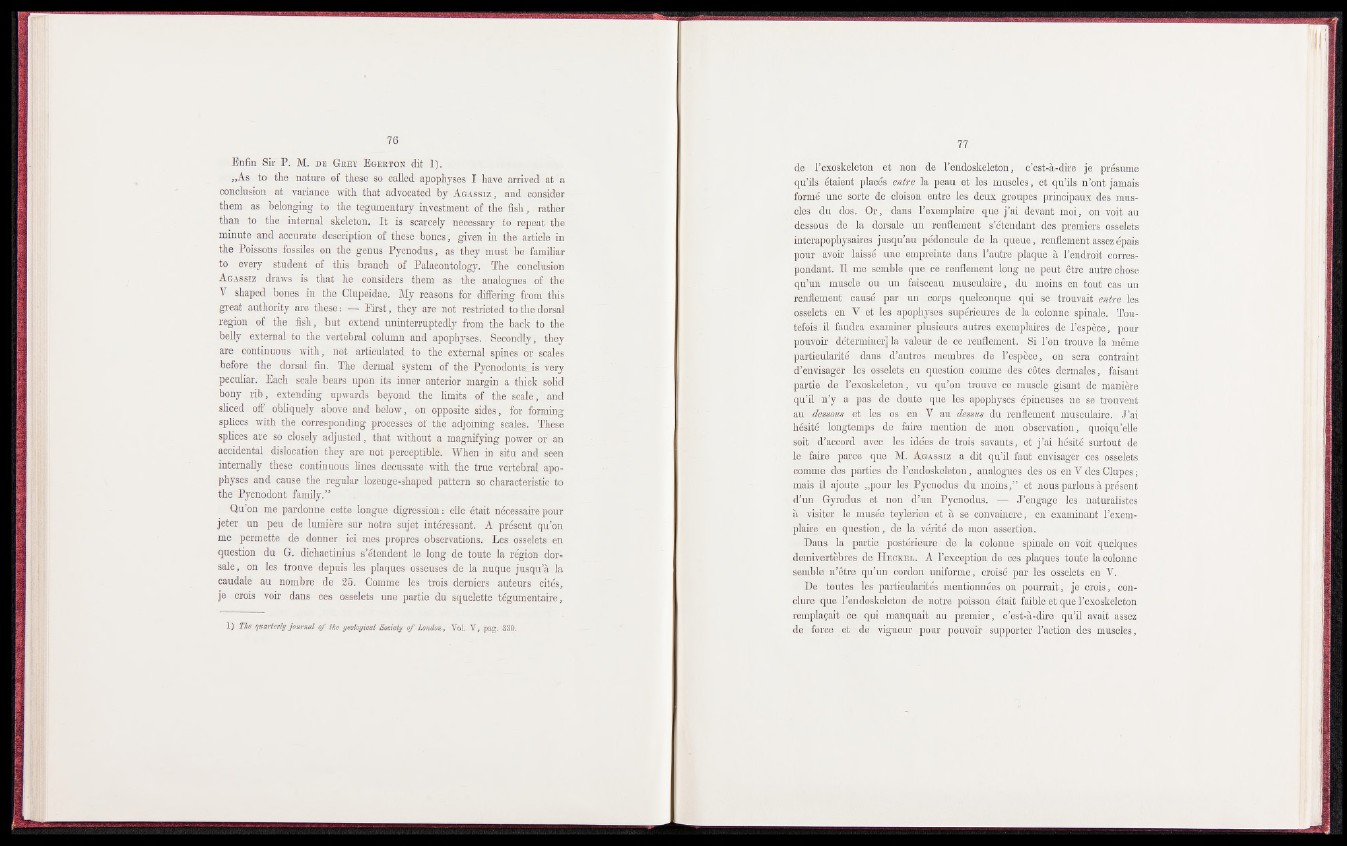
Enfin Sir P. M. de Greï Egerton dit 1).
„As to the nature of these so called apophyses I have arrived at a
conclusion at variance with that advocated by A gassiz , and consider
them as belonging to the tegumentary investment of the fish, rather
than to the internal skeleton. It is scarcely necessary to repeat the
minute and accurate description of these bones, given in the article in
the Poissons fossiles on the genus Pycnodus, as they must be familiar
to every student of this branch of Palaeontology. The conclusion
A gassiz draws is that he considers them as the analogues of thé
V shaped bones in the Clupeidae. My reasons for differing from this
great authority are these : --— First, they are not restricted to the dorsal
region of the fish, but extend uninterruptedly from the back to the
belly external to the vertebral column and apophyses. - Secondly , they
are continuous with, not articulated to the external spines or scales
before the dorsal fin. The dermal system of the PycnodontsÀs very
peculiar. Each scale bears upon its inner anterior margin a thick solid
bony rib, extending upwards beyond the limits., of the scale, and
sliced off obliquely above and below, on opposite sides, for forming
splices with the corresponding processes of the adjoining scales. These
splices are so closely adjusted, that without a magnifying- power or an
accidental dislocation they are not perceptible. When in situ and seen
internally these continuous lines decussate with the true vertebral apophyses
and cause the regular lozenge-shaped pattern so characteristic to
the Pycnodont family.”
Qu’on me pardonne cette longue digression : elle était nécessaire pour
jeter un peu de lumière sur notre sujet intéressant. A présent qu’on
me permette de donner ici mes propres observations. Les osselets en
question du G. dichactinius s’étendent le long de toute la région dorsale,
on les trouve depuis les plaques osseuses de la nuque jusqu’à la
caudale au nombre de 25. Comme les trois derniers auteurs cités,
je crois voir dans ces osselets une partie du squelette tégumentaire, 1
1) The quarterly journal of the geological Society of London, Vol. V, pag. 330.
de l’exoskeleton et non de l’endoskeletOh, c’esLà-dire je présume
qu’ils étaient placés entre la peau et les muscles, et qu’ils n’ont jamais
formé une sorte de cloison entre les deux groupes principaux des muscles
du dos. Or, dans l’exemplaire que j ’ai devant moi, on voit au
dessous de la dorsale un renflement s’étendant des premiers osselets
interapophysaires jusqu’au pédoncule de la queue, renflement assez épais
pour avoir laissé une empreinte dans, l’autre plaque à l’endroit correspondant.
II me semble que .ee renflement long ne peut être autre chose
qu’un muscle ou un faisceau musculaire, du;-,moins en tout cas un
renflement causé par un corps quelconque qui se trouvait entre les
osselets en V et les apophyses supérieures de la colonne spinale. Toutefois.
il faudra examiner plusieurs autres exemplaires de l’espèce, pour
pouvoir déterminerj la valeur de ce renflement. Si l’on trouve la même
particularité dans d’autres membres de l’espèce, on sera contraint
d’envisager les osselets en question comme des côtes dermales, faisant
partie de Texoskèleton, vu qu’on trouve ce musclé gisant de manière
qu’il n’y ,.a pas de doute que les apophyses épineuses ne se trouvent
au dessous et les os en V au dessus du renflement musculaire. J ’ai
hésité longtemps de faire mention de mon observationÿ quoiqu’elle
soit d’accord avec les idées de trois savants, et j ’ai hésité surtout de
le faire parce que M. A gassiz a dit qu’il faut envisager ces osselets
comme des parties deifflendoskeleton, analogues des os en Y des Clupes ;
mais il ajoute „pour les Pycnodus du moins,” et nous parlons à présent
d’un Gyrodus et non d’un Pycnodus. — J ’engage les naturalistes
à visiter le musée teylerien et à se convaincre, en examinant l’exemplaire
en question, de la . vérité de mon assertion.
Dans la partie postérieure de la colonne spinale on voit quelques
demivertèbres de Heckel. A l’exception de ces plaques toute la colonne
semble n’être qu’un cordon uniforme, croisé par les osselets en V.
De toutes les particularités mentionnées, on pourrait, je crois, ■ conclure
que l’endoskeleton de notre poisson était faible et que l’exoskeleton
remplaçait ce qui manquait au premier, c’est-à-dire qu’il avait assez
de force et de vigueur pour pouvoir supporter Faction des muscles,