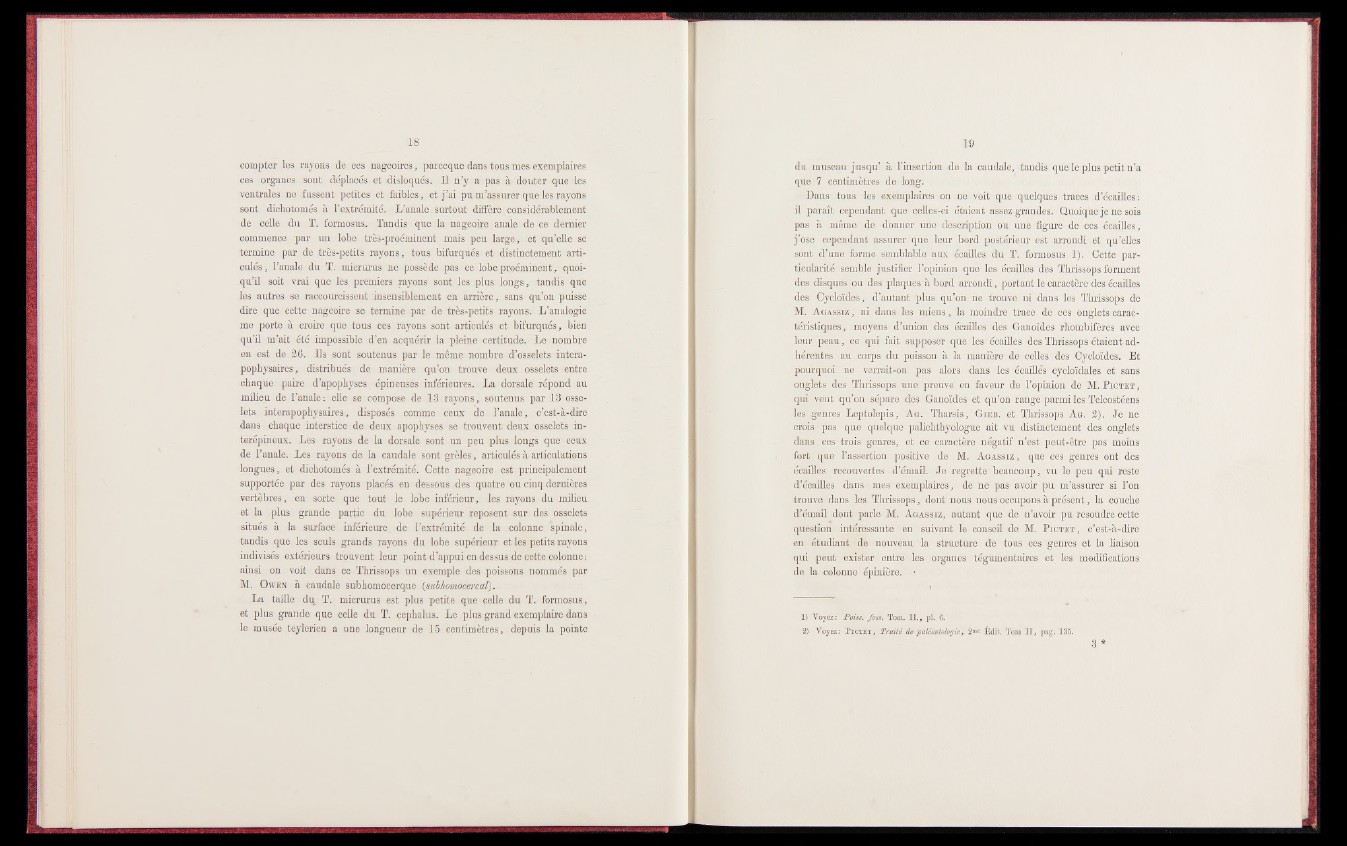
compter les rayons de ces nageoires, paroeque dans tous mes exemplaires
ces organes sont déplacés et disloqués. Il n’y a pas à- douter que les
ventrales ne fussent petites et faibles, et j ’ai pu m’assurer que les rayons
sont dichotomés à l’extrémité. L’anale surtout diffère considérablement
de celle du T. formosus. Tandis que la nageoire anale de ce dernier
commence par un lobe très-proéminent mais peu large, et qu’elle se
termine par de très-petits rayons, tous bifurqués et distinctement articulés,
l’anale du T. micrurus ne possède pas ce lobe proéminent , quoiqu’il
soit vrai que les premiers rayons sont les plus longs, tandis que
les autres se raccourcissent insensiblement en arrière, sans qu’on puisse
dire que cette nageoire se termine par de très-petits rayons. L’analogie
me porte à croire que tous ces rayons sont articulés et bifurqués, bien
qu’il m’ait été impossible d’en acquérir la pleine certitude. Le nombre
en est de 26. Ils sont soutenus par le même nombre d’osselets intera-
pophysaires, distribués de manière qu’on trouve deux osselets entre
chaque paire d’apophyses épineuses inférieures. La dorsale répond au
milieu de l’anale: elle se compose de 13 rayons, soutenus par 13 osselets
interapophysaires, disposés comme ceux de l’anale, c’est-à-dire
dans chaque interstice de deux apophyses se trouvent deux osselets; interépineux.
Les rayons de la dorsale sont un peu plus longs que ceux
de l’anale. Les rayons de la caudale sont grêles, articulés à articulations
longues, et dichotomés à l’extrémité. Cette nageoire est principalement
supportée par des rayons placés en dessous des quatre ou cinq dernières
vertèbres, en sorte que tout le lobe inférieur, les rayons du milieu
et la plus grande partie du lobe supérieur reposent sur des osselets
situés à la surface inférieure, de l’extrémité de la colonne spinale,
tandis que les seuls grands rayons du lobe supérieur et les petits, rayons
indivisés extérieurs trouvent leur point d’appui endessus.de cette colonne;
ainsi on voit dans ce Thrissops un exemple des poissons nommés par
M. Owen à caudale subhomocerque (subhomocercal).
La taille du T. micrurus est plus petite que celle du T. formosus,
et plus grande que celle du T. cephalus. Le plus grand exemplaire dans
le musée teylerien a une longueur de 15 centimètres, depuis la pointe
du museau jusqu’ à l’insertion de la caudale, tandis que le plus petit n’a
que. 7 centimètres de ;feng.
Dans tous les exemplaires on né voit que quelques traces d’écailles :
il paraît cependant que celles-ci étaient assez grandes. Quoique je ne sois
pas à même de donner une description ou une figure de ces écailles,
j ’ose, cependant assurer que leur bord postérieur est arrondi et qu’elles
sont d’une forme semblable aux écailles du T. formosus 1).. Cette particularité
semble justifier l’opinion que les écailles des Thrissops forment
des disques ou des plaques à bord arrondi, portant le caractère des écailles
des Cycloïdes, d’autant plus qu’on ne trouve ni dans les Thrissops de
M. A gassiz , ni dans les miens, la moindre trace de ces onglets caractéristiques,
moyens d’union des écailles des Ganoïdes rhombifères avec
leur peau, ce qui fait supposer que les écailles des Thrissops étaient adhérentes
au corps du poisson à la manière de celles des Cycloïdes. Et
pourquoi'ne verrait-on pas alors dans les écaillés cycloïdales et sans
onglets des Thrissops une preuve en faveur de l’opinion de M. P ic t e t ,
qui veut qu’on sépare des Ganoïdes et qu’on range parmi les Teleostéens
les genres Leptolepis, As. Tharsis, G ie b . et Thrissops à g . 2 ). Je ne
crois pas que quelque palichthyologue ait vu distinctement des onglets
dans ces trois genres, et ce caractère négatif n’est peut-être pas moins
fort que l’assertion positive de M. A g a s s iz , que ces genres ont des
écailles recouvertes d’émail. Je regrette beaucoup, vu le peu qui reste
d’écailles dans ■ mes exemplaires, de ne pas avoir pu m’assurer si l’on
trouve dans les Thrissops, dont nous nous occupons à présent, la couche
d’émail dont parle M. A gassiz, autant que de n’avoir pu résoudre cette
question intéressante en suivant le conseil de M. P ictet , c’est-à-dire
en étudiant de nouveau la structure de tous ces genres et la liaison
qui peut exister entre les organes tégumentaires et les modifications
de la colonne épinière. ;
1) Voyez: Poiss. foss. Tom. IL , pl. 6.
2) Voyez: P ictet, Traité de paléontologie, 2me Édit. Tom I I , pag. 135.