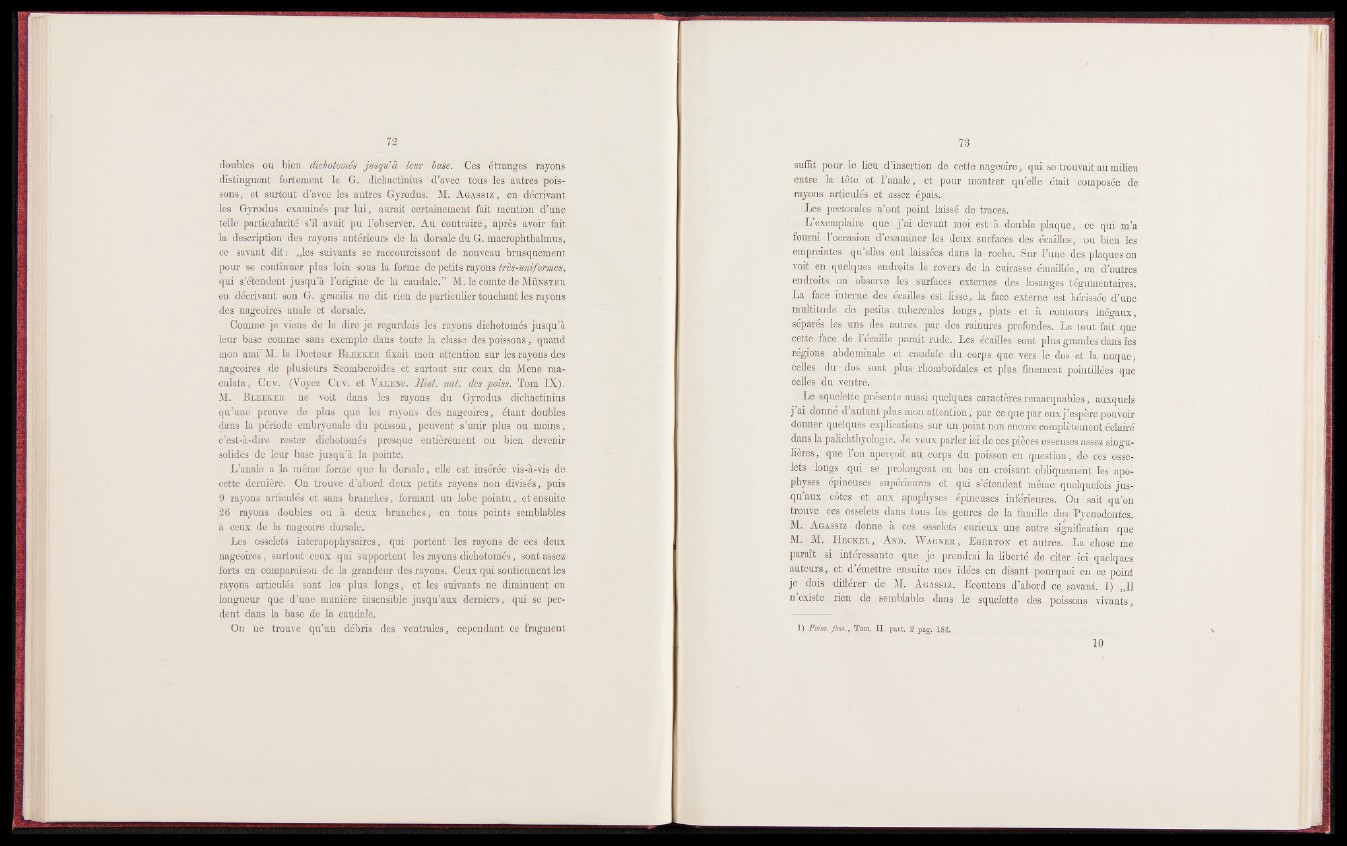
doubles ou bien dic/iotomés jusqu’à leur base. Ces étranges rayons
distinguent fortement le G. dichactinius d’avec tous les autres poissons,
et surtout d’avec les autres Gyrodus. M. A g a s s iz , en décrivant
les Gyrodus examinés par lui, aurait certainement fait mention d’une
telle particularité s’il avait pu l’observer. Au contraire, après avoir fait
la description des rayons antérieurs de la dorsale du G. macrophthalmus,
ce savant dit: „les suivants se raccourcissent de nouveau brusquement
pour se continuer plus loin sous la forme de petits rayons très-uniformes,
qui s’étendent jusqu’à l’origine de la caudale.” M. le comte de M ünster
en décrivant son G. gracilis ne dit rien de particulier touchant les rayons
des nageoires anale et dorsale.
Comme je viens de le dire je regardais les rayons dichotomés jusqu’à
leur base comme sans exemple dans toute la classe des poissons, quand
mon ami'.M. le Docteur B l e ek e r fixait mon attention sur les rayons des
nageoires de plusieurs Scomberoïdes et surtout sur ceux du Mene ma-
culata, Cuv. (Voyez Cuv. et Valenc. Hist. nat. des poiss. Tom. IX).
M. B l e ek e r ne voit dans les rayons du Gyrodus dichactinius
qu’une preuve de plus que les rayons des nageoires, étant doubles
dans la période embryonale du poisson, peuvent s’unir plus ou moins,
c’est-à-dire rester dichotomés presque entièrement ou bien devenir
solides de leur base jusqu’à la pointe.
L’anale a ïa même forme que la dorsale, elle est insérée vis-à-vis de
cette dernière. On trouve d’abord deux petits rayons non divisés, puis
9 rayons articulés et sans branches, formant un lobe pointu, et ensuite
26 rayons doubles, ou à deux branches, -en tous points semblables
à ceux de la nageoire dorsale.
Les osselets interapophysaires, qui portent les rayons de ces deux
nageoires, surtout ceux qui supportent les rayons dichotomés, sont assez
forts en comparaison de la grandeur des rayons. Ceux qui soutiennent les
rayons articulés sont les plus longs, et les suivants ne diminuent en
longueur que d’une manière insensible jusqu’aux derniers, qui se perdent
dans la base de la caudale;
On ne trouve qu’un débris des ventrales, cependant ce fragment
suffit pour le lieu d’insertion de-cette nageoire, qui se trouvait au milieu
entre la tê te . et l’anale., et pour montrer qu’elle était composée de
rayons articulés et assez épais.
Les pectorales n’ont point laissé de traces.
L’exemplaire que j ’ai devant moi est à double plaque, : ce qui m’a
fourni l’occasion d’examiner les deux surfaces des écailles ,, ou bien les
empreintes qu’elles ont .laissées dans la roche. Sur l’une des .plaques on
voit en quelques endroits le revers de la cuirasse émaillée, en d’autres
endroits on observe les ■ surfaces externes des . losanges tégumentaires.
La face interne des écailles est lisse, la face externe est hérissée d’une
multitude, de petits tubercules longs, plats : et à contours inégaux,
séparés les uns des autres par des rainures profondes; Le tout fait que
cette face de 1 écaillé parait rude. Les écailles, sont plus grandes dans les
régions abdominale et caudale du corps que vers le dos et la nuque;
.celles du dos sont plus rhomboïdales et plus finement pointillées que
celles du ventre., .a
Le squelette présente aussi quelques caractères remarquables., auxquels
j ai donne d autant plus mon attention, par ce que par eux j ’espère pouvoir
donner quelques explications sur un point non encore complètement éclairé
dans la palichthyologie. Je veux parler ici de ces pièces osseuses assez singulières,
que l’on aperçoit au corps du poisson en question,. de ces osselets
longs qui se prolongent en bas en croisant obliquement les apophyses
épineuses supérieures et qui s’étendent même quelquefois jusqu’aux
côtes et aux apophyses épineuses inférieures. On sait qu’on
trouve ces osselets dans tous les genres de la famille des - Bycnodontes.
M. A gassiz donne a ces osselets curieux une autre'signification que
M. M. H e c k e l , A nd. W a g n e r , E g e r io n et, autres.. La chose me
parait si intéressante que je prendrai la liberté de citer ici quelques
auteurs, et d’émettre ensuite mes idées en disant pourquoi en ce point
je dois différer de M. A gassiz. Ecoutons d’abord ce savant. 1) „11
n’existe rien de semblable dans le squelette des poissons vivants,
1) jPoiss./oss., Tom. II. part. 2 pag. 184.