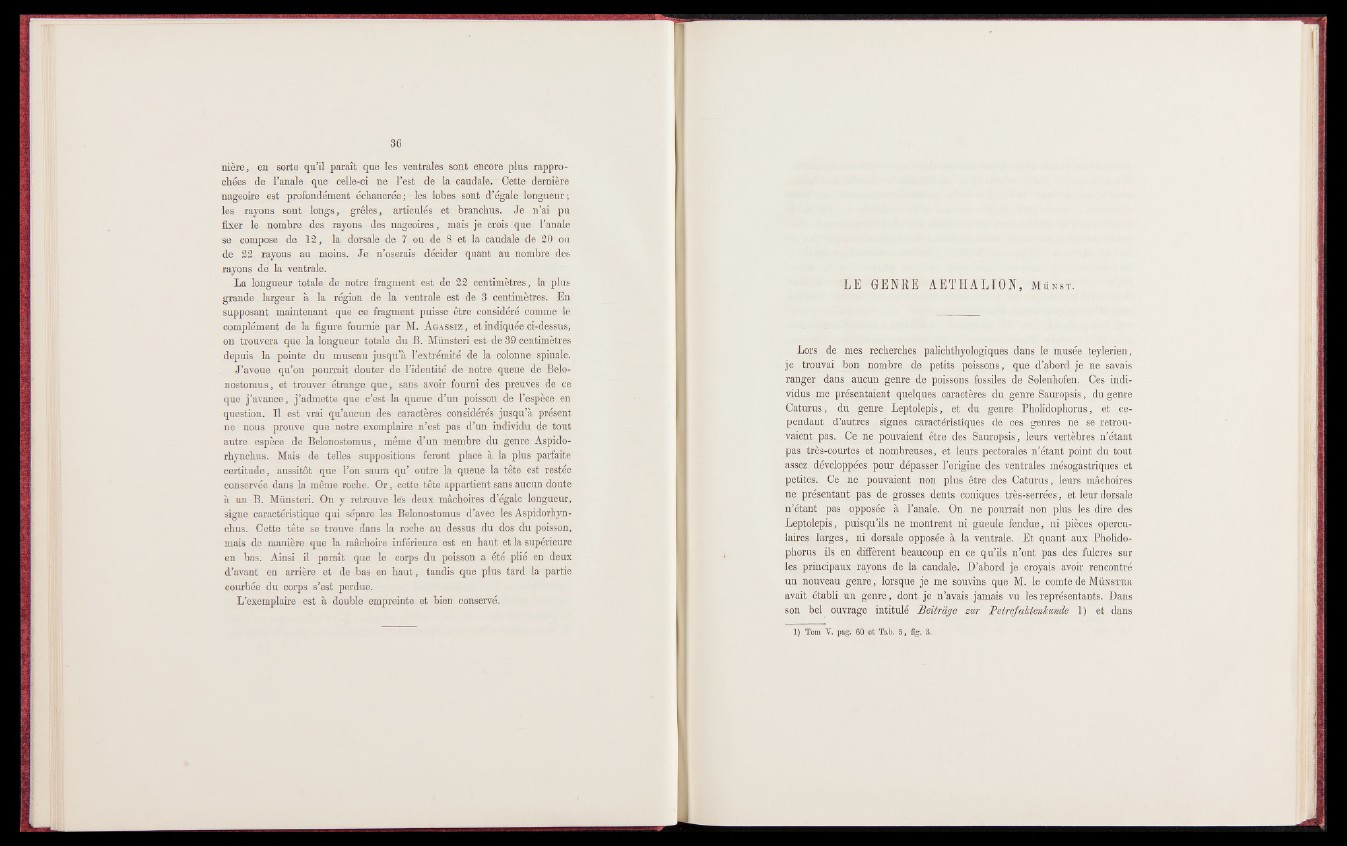
nière, en sorte qu’il paraît que les ventrales sont encore plus rapprochées
de l’anale que celle-ci ne l’est de la caudale. Cette dernière
nageoire est profondément échancrée ; les lobes sont d’égale longueur ;
les rayons sont longs, grêles, articulés et branchus. Je n’ai pu
fixer le nombre des rayons des nageoires, mais je crois que l’anale
se compose de 12, la dorsale de 7 ou de 8 et la caudale de 20 ou
de 22 rayons au moins. Je n’oserais décider quant au nombre des
rayons de la ventrale.
La longueur totale de notre fragment est de 22 centimètres, la plus
grande largeur à la région de la ventrale est de 3 centimètres. En
supposant maintenant que ce fragment puisse être considéré comme le
complément de la figure fournie par M. A gassiz , et indiquée ci-dessus,
on trouvera que la longueur totale du B. Münsteri est de 39 centimètres
depuis la pointe du museau jusqu’à l’extrémité de la colonne spinale.
J ’avoue qu’on pourrait douter de l’identité de notre queue -de Belo-
nostomus, et trouver étrange que, sans avoir fourni des preuves de ce
que j’avance, j’admette que c’est la queue d’un poisson de l’espèce en
question. H est vrai qu’aucun des caractères considérés jusqu’à présent
ne nous prouve que notre exemplaire n’est pas d’un individu de tout
autre espèce de Belonostomus, même d’un membre du genre Aspido-
rhynchus. Mais de telles suppositions feront place a la plus parfaite
certitude, aussitôt que l’on saura qu’ outre la queue la tête est restée
conservée dans la même rocbe. Or, cette tête appartient sans aucun doute
à un B. Münsteri. On y retrouve le's deux mâchoires d’égale longueur,
signe caractéristique qui sépare les Belonostomus d’avec les Aspidorhyn-
chus. Cette tête se trouve dans la roche au dessus du dos du poisson,
mais de manière que la mâchoire inférieure est en haut et la supérieure
en bas. Ainsi il paraît que le corps du poisson a été plié en deux
d’avant en arrière et de bas en haut, tandis que plus tard la partie
courbée du corps s’est perdue.
L’exemplaire est à double empreinte et bien conservé. 1
LE GENRE AETHALION, M ü n s t .
Lors de mes recherches palichthyologiques dans le musée teylerien,
je trouvai bon nombre de petits poissons, que d’abord je ne savais
ranger dans aucun genre de poissons fossiles de Solenhofen. Ces individus
me présentaient quelques caractères du genre Sauropsis, du genre
Caturus, du genre Leptolepis, et du genre Pholidophorus, et cependant
d’autres signes caractéristiques de ces genres ne se retrouvaient
pas. Ce ne pouvaient être des Sauropsis, leurs vertèbres n’étant
pas très-courtes et nombreuses, et leurs pectorales n’étant point du tout
assez développées pour dépasser l’origine des ventrales mésogastriques et
petites. Ce ne pouvaient non plus être des Caturus, leurs mâchoires
ne présentant pas de grosses dents coniques très-serrées, et leur dorsale
n’étant pas opposée à l’anale. On ne pourrait non plus les dire des
Leptolepis, puisqu’ils ne montrent ni gueule fendue, ni pièces opercu-
laires larges, ni dorsale opposée à la ventrale. Et quant aux Pholidophorus
ils en diffèrent beaucoup en ce qu’ils n’ont pas des fulcres sur
les principaux rayons de la caudale. D’abord je croyais avoir rencontré
un nouveau genre, lorsque je me souvins que M. le comte de M ünstek
avait établi un genre, dont je n’avais jamais vu les représentants. Dans
son bel ouvrage intitulé Beiträge zwr Betrefaktenbmde 1) et dans
1) Tom Y. pag. 60 et Tab. 5, fig. 3.