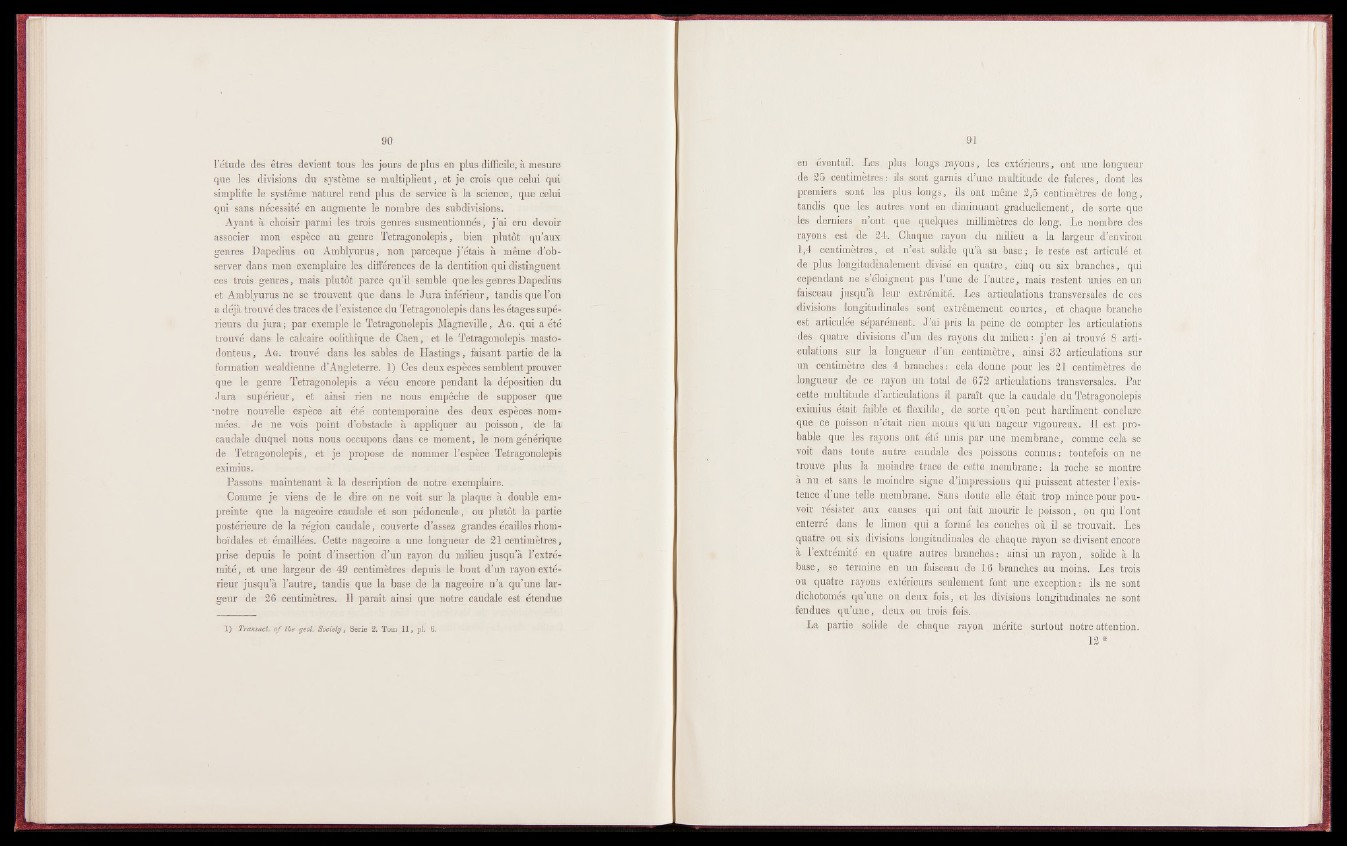
l’étude des êtres devient tous les jours de plus en plus difficile, à mesure
que les divisions du système se multiplient, et je crois que' celui qui
simplifie le système naturel rend plus de service à la science, que celui
qui sans nécessité en augmente le nombre des subdivisions.
Ayant à choisir parmi les trois genres susmentionnés , j ’ai cru devoir
associer mon espèce au genre Tetragonolepis, bien plutôt qu’aux
genres Dapedius ou Amblyurus, non parceque j ’étais à même d’observer
dans mon exemplaire les différences de la dentition qui distinguent
ces trois genres, mais plutôt parce qu’il semble que les genres Dapedius
et Amblyurus ne se trouvent que dans le Jura inférieur, tandis que l’on
a déjà trouvé des traces de l’existence du Tetragonolepis dans les étages supérieurs
du jura ; par exemple le Tetragonolepis Magneville, Ag. qui a été
trouvé dans le calcaire oolithique de Caen, et le Tetragonolepis masto-
donteus, Ag. trouvé dans les sables de Hastings, faisant partie de la
formation wealdienne d’Angleterre. 1) Ces deux espèces semblent prouver
que le genre Tetragonolepis a vécu encore pendant la déposition du
Jura supérieur, et ainsi rien ne nous empêche de supposer que
•notre nouvelle espèce ait été contemporaine des deux espèces nom-
mées. Je ne vois point d’obstacle à appliquer au poisson, de la-
caudale duquel nous nous occupons dans ce moment, le nom générique
de Tetragonolepis, et je propose de nommer l’espèce Tetragonolepis
eximius.
Passons maintenant à la description de notre exemplaire.
Comme je viens de: le dire on ne voit sur la plaqué à double empreinte
que la nageoire caudale et son pédoncule, ou plutôt la partie
postérieure de la région caudale, couverte d’assez grandes écailles rhom-
boïdales et émaillées. Cette nageoire a une .longueur de 21 centimètres ,
prise depuis le point d’insertion d’un rayon du milieu jusqu’à l’estrér
mité, et une largeur de 49 centimètres depuis le bout d’un rayon extérieur
jusqu’à l’autre, tandis que la base de la nageoire n’a qu’une largeur
de 26 centimètres. Il paraît ainsi que notre caudale est étendue 1
1) Transact. of the geol. Society, Sérié 2, Tom I I , pl. 6.
en éventail. Les plus longs rayons, les extérieurs, ont une longueur
de 25 centimètres : ils sont garnis d’une multitude de fulcres, dont les
premiers sont les plus longs, ils ont même 2,5 centimètres de long,
tandis que les autres vont en diminuant graduellement , de sorte que
les derniers n’ont que quelques millimètres de long. Le nombre des
rayons est de 24. Chaque rayon du milieu a la largeur d’environ
1,4 centimètres, et n’est solide qu’à sa base; le reste est articulé et
de plus longitudinalement divisé en quatre, cinq ou six branches., qui
cependant ne s’éloignent pas l’une de l’autre, mais restent unies en un
faisceau jusqu’à leur extrémité. Les articulations transversales de ces
divisions longitudinales sont extrêmement courtes , et chaque branche
est articulée séparément. J ’ai pris la peine de compter les articulations
des quatre divisions d’un des rayons du milieu: j ’en ai trouvé 8 articulations
sur la longueur d’un centimètre, ainsi 32 articulations sur
un centimètre des 4 branches; cela donne pour les 21 .centimètres de
longueur de ce rayon un total de 672 articulations transversales. Par
cette multitude d’articulations il paraît que la caudale du Tetragonolepis
eximius était faible et flexible, de sorte qu’on peut hardiment conclure
que ce poisson n’était rien moins qu’un nageur vigoureux. Il est probable
que les rayons ont été unis par une membrane, comme cela se
voit dans toute autre caudale des poissons connus: toutefois on ne
trouve plus la moindre trace de cette membrane : la roche se montre
à nu et sans le moindre signe d’impressions qui puissent attester l’existence
d’une telle membrane. Sans doute elle était trop mince pour pouvoir
résister aux causes qui ont -fait mourir le poisson, ou qui l’ont
enterré dans le limon qui a formé les couches où il se trouvait. Les
quatre ou six divisions longitudinales de chaque rayon se divisent encore
à l’extrémité en quatre autres branches: ainsi un rayon., solide à la
base, se termine en un faisceau de 16 branches au moins. Les trois
ou quatre rayons extérieurs seulement font une exception: ils ne sont
dichotomés qu’une ou deux fois, et les divisions longitudinales ne sont
fendues qu’une, deux ou trois fois.
La partie solide de chaque rayon mérite surtout notre attention.
12 *