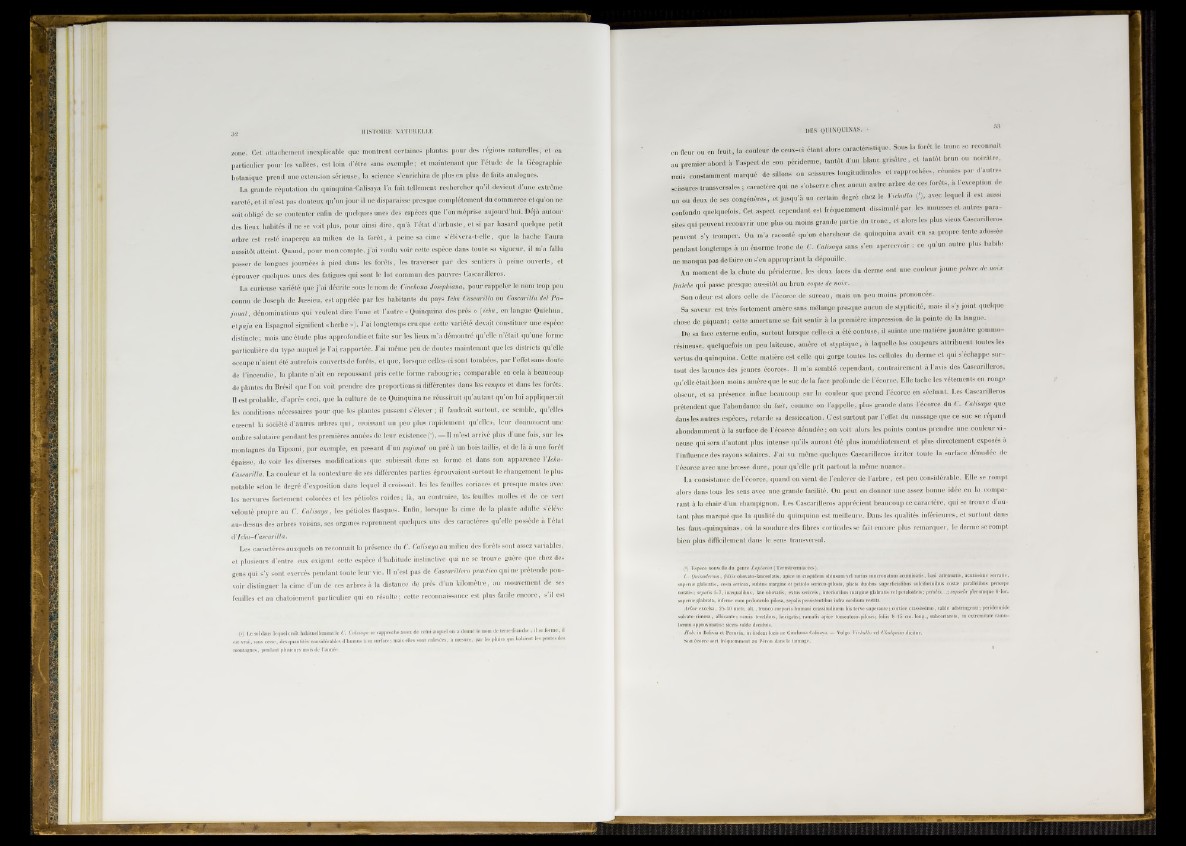
zone. Cet attachement inexplicable que montrent certaines plantes pour des régions naturelles, et en
particulier pour les vallées, est loin d’èlre sans exemple; et maintenant que l’étude de la Géographie
botanique prend une extension sérieuse, la science s’enrichira de plus en plus de faits analogues.
La grande réputation du quinquina-Calisaya l’a fait tellement rechercher qu’il devient d’une extrême
rareté, et il n’est pas douteux qu’un jour il ne disparaisse presque complètement du commerce et qu’on ne
soit obligé de se contenter enfin de quelques unes des espèces que l’on méprise aujourd’hui. Déjà autour:
des lieux habités il ne se voit plus, pour ainsi dire, qu’à l’état d’arbuste, et si par hasard quelque petit
arbre est resté inaperçu au milieu de la forêt, à peine sa cime s’élevera-t-elle, que la hache 1 aura
aussitôt atteint. Quand, pour mon compte, j ’ai voulu voir cette espèce dans toute sa vigueur, il m’a fallu
passer de longues journées à pied dans les forêts, les traverser par des sentiers a peine ouvei ts, et
éprouver quelques unes des fatigues qui sont le lot commun des pauvres Cascarilleros.
La curieuse variété que j ’ai décrite sous le nom de Cinchona Josephiana, pour rappeler le nom trop peu
connu de Joseph de Jussieu, est appelée par les habitants du pays Ichu Cascarilla ou Cascarilla del Pa-
jonal, dénominations qui veulent dire l’une et l’autre «Quinquina des prés » (ichu, en langue Quichua,
et paja en Espagnol signifient «herbe »). J’ai longtemps cru que cette variété devait constituer une espèce
distincte; mais une étude plus approfondie et faite sur les lieux m’a démontré qu’elle n’était qu’une forme
particulière du type auquel je l’ai rapportée. J’ai même peu de doutes maintenant que les districts qu’elle
occupe n’aient été autrefois couverts de forêts, et que, lorsque celles-ci sont tombées, par l’effet sans douté
de l’incendie, la plante n’ait en repoussant pris cette forme rabougrie; comparable en cela à beaucoup
déplantés du Brésil que l’on voit prendre des proportions si différentes dans lescampos et dans les forêts.
Il est probable, d’après ceci, que la culture de ce Quinquina ne réussirait qu’autant qu’on lui appliquerait
lés conditions nécessaires pour que les plantes pussent s’élever ; il faudrait surtout, ce semble, qu’elles
eussent la société d’autres arbres q u i, croissant un peu plus rapidement qu’elles, leur donnassent une
ombre salutaire pendant les premières années de leur existence(').Hll m’est arrivé plus d’une fois, sur les
montagnes du Tipoani, par exemple, en passant d’un pajonal ou pré à un bois taillis, et de là à une forêt
épaisse, de voir les diverses modifications que subissait dans sa forme et dans son apparence Ylchu-
Cascanlla. La couleur et la contexlure de ses différentes parties éprouvaient surtout le changement lè plus
notable selon le degré d’exposition dans lequel il croissait. Ici les feuilles coriaces et presque mates avec
les nervures fortement colorées et les pétioles roides; là, au contraire, les feuilles molles et de ce vert
velouté propre au C. Calisaya, les pétioles fiasques. Enfin, lorsque la cime de la plante adulte s’élève
au-dessus des arbres voisins, ses organes reprennent quelques uns des caractères qu’elle possède à l’état
(V Ichu-Cascarilla.
Les caractères auxquels on reconnaît la présence du C. Calisaya au milieu des forêts sont assez variables,
et plusieurs d’entre eux exigent cette espèce d’habitude instinctive qui ne se trouve guère que chez des
gens qui s’y sont exercés pendant toute leur vie. Il n’est pas de Cascarillero practico qui ne prétende pouvoir
distinguer la cime d’un de ces arbres à la distance de près d’un kilomètre, au mouvement de ses
feuilles et au chatoiement particulier qui en résulte ; celte reconnaissance est plus facile encore, s il est
(i) Le sol dans lequel croit habituellement le C. Caliseyü se rapproche assez de celui auquel on a donné le nom do terre-tranche, ¡1 se forme, il
est v rai, sans cesse, des quantités' considérables d’humus a sa surface ; mais elles sont enlevées, a mesure, par les pluies qui balaient les pentes des
montagnes, pendant plusieurs mois de l’année.
en fleur ou en fruit, la couleur’ de ceux-ci étant alors caractéristique. Sous la forêt le tronc se reconnaît
au premier abord à l’aspect de son périderme, tantôt d’un blanc grisâtre, et tantôt brun ou noirâtre,
mais constamment marqué de sillons ou scissures longitudinales et rapprochées, réunies par d’aulres
scissures transversales ; caractère qui ne s'observe chez, aucun autre arbre de ces forêts, à l'exception de
un ou deux de ses congénères.et jusqu’à un certain degré chez le Vichullv ( ), avec lequel il est aussi
confondu quelquefois. Cet aspect cependant est fréquemment dissimulé par les mousses et autres parasites
qui peuvent recouvrir une plus ou moins grande partie du tronc ,, et alors les plus vieux Cascarilleros
peuvent s’y tromper. On m’a raconté qu’un chercheur de quinquina avait eu sa propre tente adossée
pendant longtemps à un énorme troie de C. Calisaya sans s’en apercevoir : ce qu’un autre plus habile
ne manqua pas de faire en s’en appropriant la dépouille.
Au moment de la chute du périderme, les deux faces du derme ont une couleur jaune pelure de noix
fraîche qui passe presque aussitôt au brun coque de noix s
Son odeur est alors celle de l’écorce de sureau, mais un peu moins prononcée.
Sa saveur est très fortement amère sans mélange presque aucun de stypticilé, mais il s’y joint quelque
chose de piquant; cette amertume se fait sentir à la première impression de la pointe de la langue.
De sa face externe enfin, surtout lorsque celle-ci a été contuse, il suinte une matière jaunâtre gommo-
résineuse, quelquefois un peu laiteuse, amère et styptique , à laquelle les coupeurs attribuent toutes les
vertus du quinquina. Cette matière est celle qui gorge toutes les cellules du derme et qui s échappe surtout
des lacunes des jeunes écorces. Il m’a semblé cependant* contrairement à l’avis des Cascarilleros,
qu’elle était bien moins amère que le suc de la face profonde de l’écorce. Elle tache les vêtements en rouge
obscur, et sa présence influe beaucoup sur la couleur que prend l’écorce en séchant. Les Cascarilleros
prétendent que l’abondance du lait, comme on l’appelle, plus grande dans 1 écorce du C. Calisaya que
dans les autres espèces, retarde sa dessiccation. C’est surtout par l’effet du massage que ce suc se répand
abondamment à la surface de l’écorce dénudée ; on voit alors les points contus prendre une couleur vi -
neuse qui sera d’autant plus intense qu’ils auront été plus immédiatement et plus directement exposés à
l’influence des rayons solaires. J’ai vu même quelques Cascarilleros irriter toute la surface dénudée de
l’écorce avec une brosse dure, pour qu’elle prît partout la même nuance.
La consistance de l’écorce, quand on vient de l’enlever de l’arbre, est peu considérable. Elle se rompt
alore dans tous les sens avec une grande facilité. On peut en donner une assez bonne idée en la comparant
à la chair d’un champignon. Les Cascarilleros apprécient beaucoup ce caractère, qui se trouve d’autant
plus marqué que la qualité du quinquina est meilleure. Dans les qualités inférieures, et surtout dans
les faux-quinquinas, où la soudure des fibres corticales se fait encore plus remarquer, le derme se rompt
bien plus difficilement dans le sens transversal.
; (>) 'Espèce nouvelle du genre Laplucea ( Ternsiroeiniacécs).
L . Quinodcrma, fo liis obnvaln-lanceola) is , apice in cuspideni oblu.su ni vel rari us mucronaluni acuminaiis, basi allenualis, acutissime serratis,
superne glabratis, cosla sericea, subtus margine et petiolo sericeo-pilosis, plicis duobus superficialibus sulciformibus costæ parallclibus prrsæpu
notatis; scpalis 5-7, inæqualibus, laie obovatis, exlus sericeis, inierioribus margine glabratis vel petaloideis; peta lis...; capsula plorumque 6-loc.
superne glabrata, inferne cum pedúnculo pilosa, scpalis pcrsisientibus infra medium vestita.
Arbor excelsa, 25-30 metr. a it., trunco corporis humani crassiludincm bis lerve superante ; corticc crassissimo, vàlde adsti ingemi ; periderniide
unitalo-rimosa, albicante; ramis terelibus, lævigatis; raniulis apice lomentoso-pilosis; foliis 8-15 cm. long., subcoriaceis, in exlremiiate ramu-
lornm approximatis: siccis valde dcciduis.
f i ab. in Bolivia cl l’cr u via, in iisdein locis ac Cincliona Calisaya. — Vulgo Vichullo vel Clndi/uisa dicitur.