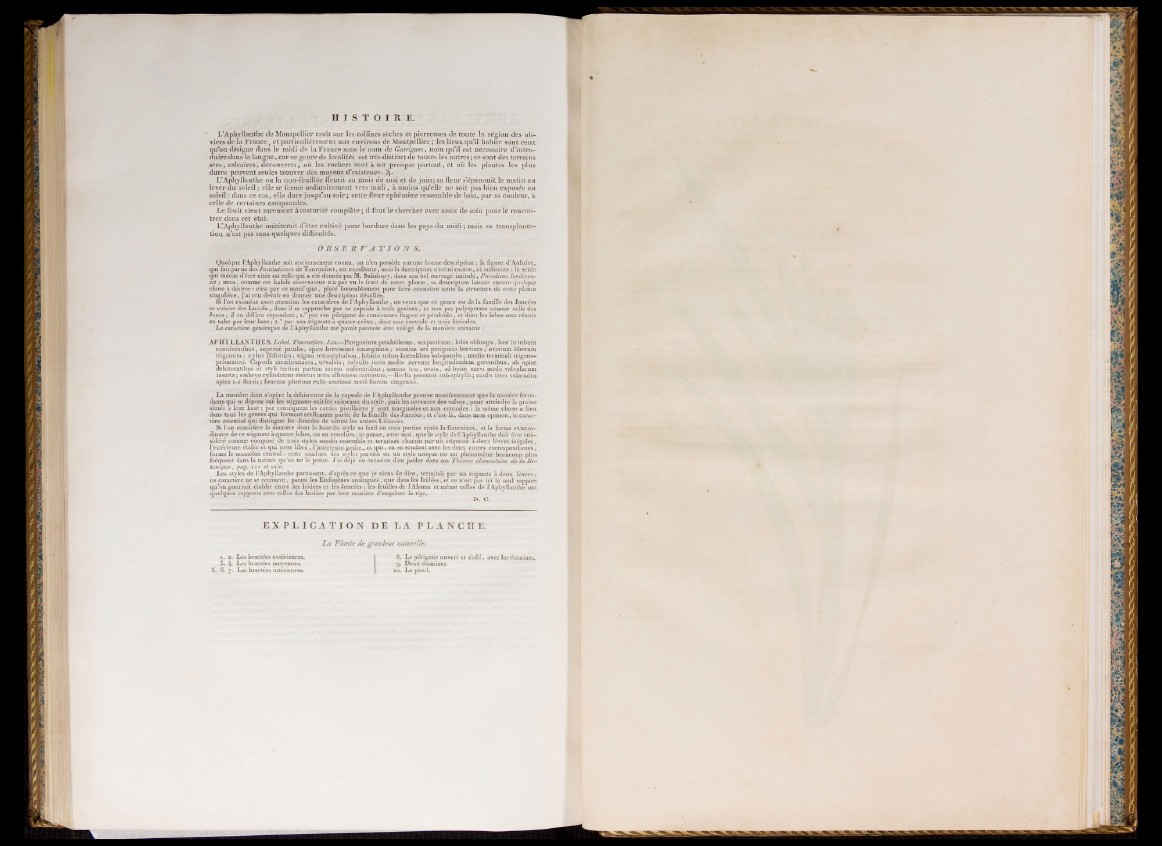
H I S T O I R E .
L’A phyllanthe de Montpellier c ro ît su r les collines sèches et pierreuses de toute la rég ion des oliviers
de la France e t p articulièrement aux environs de Montpellier ; les lieu x qu’il hab ite sont ceux
qu’on désigne dans le midi de la France sous le nom de Garrigues, nom qu’il est nécessaire d ’introdu
ire dans la lan g u e , ca r ce genre de localités est très-distinct de toutes les au tre s; ce sont des terrains
s e c s , ca lca ire s, d é cou ve r ts , où les rochers sont à nu presque p a rtou t, e t où les plantes les plus
dures peuvent seules trou ver des moyens d ’existence. 2J.*
L’A phyllanthe ou la non-feuillée fleu rit au mois de mai e t de ju in ; sa fleu r s'épanouit le matin au
le v e r a u soleil ; elle se ferme ordinairement vers m id i, à moins qu’e lle ne so it pas bien exposée au
soleil : dans ce ca s, elle dure jusqu’au so ir ; cette fleu r éphémère ressemble de lo in , par sa couleur, à
celle de certaines campanules.
Le fru it vient rarement à maturité complète ; il fau t le chercher avec assez de soin pou r le rencontre
r dans cet état.
L’A phyllanthe mériterait d’être cu ltivé pou r bordure dans les pays du midi ; mais sa transplantation
n ’est pas sans quelques difficultés.
O B S E R V A T I O S S.
Quoique l’Aphyllanthe soit anciennement connu, on n’en possède aucune bonne description ; la figure d’Aubriet,
qui fait partie aes Institutiones de Tournefort, est excellente, mais la description n’est ni exacte, ni suffisante : la seule
qui mérite d’être citée est celle qui a été donnée par M. Salisbury, dans son bel ouvrage intitulé, Paradisus londinen-
sisj mais, comme cet habile observateur n’a pas vu le fruit de notre plante , sa description laissait encore quelque
chose à désirer : c’est par ce motif q u e , placé favorablement pour faire connaître toute la structure de cette plante
singulière, j’ai cru devoir en donner une description détaillée.
Si l’on examine avec attention les caractères de l’Aphyllanthe, on verra que ce genre est de la famille des Joncées
et voisine des Luzula, dont il se rapproche par sa capsule à trois graines, et non pas polysperme comme celle des
Joncs ; il en diffère cependant, i.° par son périgone ae consistance fugace et pétaloïde, et dont les lobes sont réunis
en tube par leur base ; 2.° par son stigmate a quatre crêtes, dont une centrale et trois latérales.
Le caractère générique de l’Aphyllanlhe me paraît pouvoir être rédigé de la manière suivante :
APH YLLAN TH ES. Lobel. Tournefort. Lin.—Perigonium petaloideum, sexpartitum, lobis oblongis, basi in tubum
conniventibus , superne patulis, apice brevissimè emarginatis ; stamina sex perigonio breviora ; ovarium liberum
trigonum ; Stylus Bliformis ; stigma tetracephalum , lobulis tribus lateralibus sub-patulis, medio terminali trigono-
prismatico. Capsula membranacea, trivalvis ; valvulis intùs medio nervum longitudinalem gerentibus, ab apice
dehiscentibus et styli terliam partent sccum auferemibus ; semina tria, ovata, ad basin nervi medii valvularum
inserta ; embryo cyfindricus erectus intra albumetn carnosum.—Herba perennis sub-aphylla ; caulis teres subnudus
apice 1-2 florus ; bracteæ plurimæ rufæ scariosæ arctè florem cingentes.
La manière dont s’opère la déhiscence de la capsule de l’Aphyllanthe prouve manifestement que la matière fécondante
qui se dépose sur les stigmates suit les vaisseaux du style, puis les nervures des valves, pour atteindre la graine
située a leur base ; par conséquent les cordes pistillaires y sont marginales et non centrales : la même chose a lieu
dans tous les genres qui forment réellement partie de la famille des Joncées, et c’est-là, dans mon opinion, le caractère
essentiel qui distingue les Joncées de toutes les autres Liliacées.
Si l’on considère la manière dont la base du style se fend en trois parties après la fleuraison, et la forme extraordinaire
de ce stigmate à quatre lobes, on en conclura, je pense, avec moi, que le style de l’Aphyllanthe doit être considéré
comme composé de trois styles soudés ensemble et terminés chacun par un stigmate à deux lèvres inégales,
l’extérieure étalée et qui reste libre, l ’intérieure petite, et q u i, en se soudant avec les deux autres correspondantes ,
forme le mamelon central : celte soudure des styles paruels en un style unique est un phénomène beaucoup plus
fréquent dans la nature qu’on ne le pense. J’ai déjà eu occasion d’en parler dans ma Théorie élémentaire de la Botanique
, pag. u t et suiv.
Les styles de l’Aphyllanthe paraissent, d’après ce que je viens de dire, terminés par un stigmate à deux lèvres ;
ce caractère ne se retrouve , parmi les Endogènes analogues , que dans les Iridées, et ce n’est pas ici le seul rapport
qu’on pourrait établir entre les Iridées et les Joncées ; les feuilles de l’Abama et même celles de l’Aphyllanthe ont
quelques rapports avec celles des Iridées par leur manière d’engaîner la tige.
E X P L I C A T I O N D E L A P L A N C H E .
La Plante de grandeur naturelle.
î . 2. Les bractées extérieures.
5. 4- Les bractées moyennes.
5. 6. 7. Les bractées intérieures.
8. Le périgone ouvert et étalé, avec les étamines.
9. Deux étamines.
10. Le pistil.