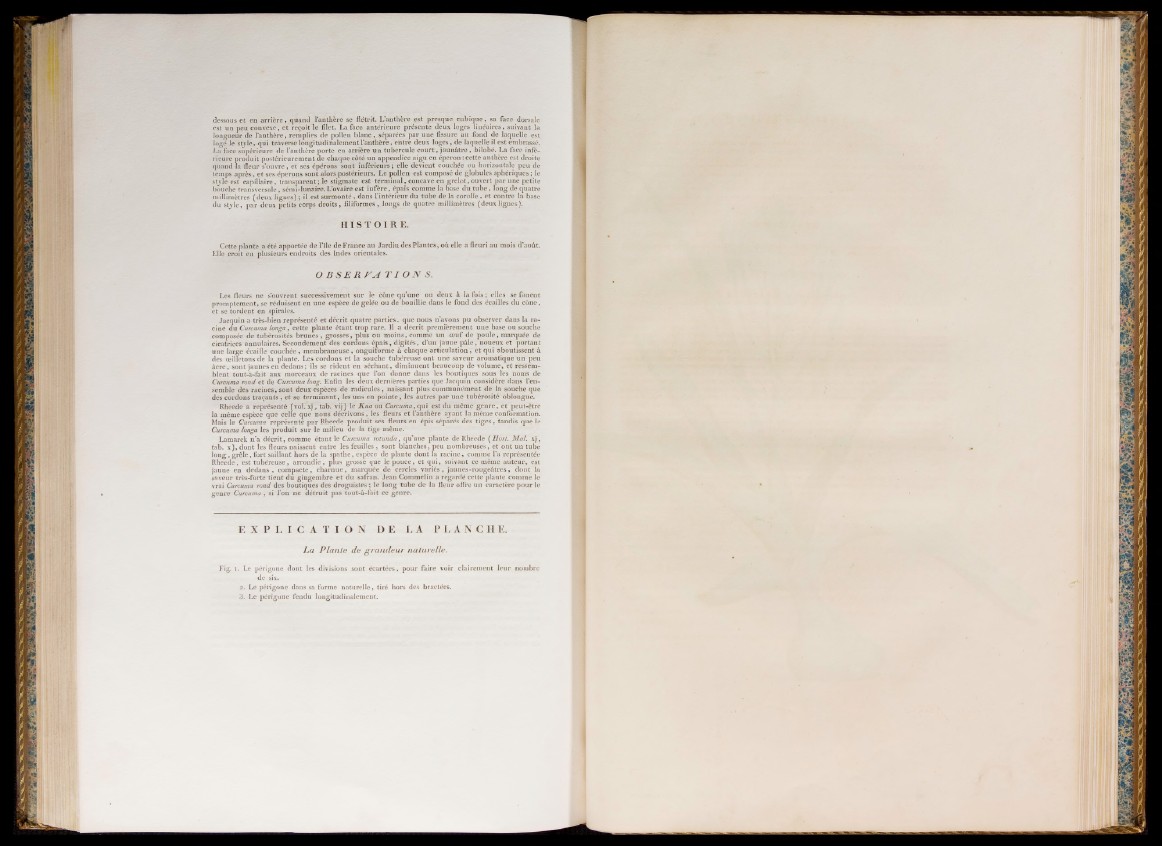
dessous et en a r r iè r e , quand l’anthère se flétrit. L’anthère est presque cu b iq u e , sa face dorsale
est un peu con vex e, e t reçoit le filet. L a face antérieure présente deux loges lin éa ires , suivant la
longueur de l'an th è re, remplies de pollen b la n c , séparées par une fissure au fon d de laquelle est
logé le s ty le , q ui traverse longitudinalemen t l’an th è re, entre deux lo g e s , de laquelle il est embrassé.
La face supérieure de l’anthère porte en arrière u n tubercule c o u r t , ja u n â t r e , bilobé. L a face inférieure
produit postérieurement de chaque côté un appendice aigu en éperon : cette anthère est droite
quand la fleu r s’o u v r e , e t ses épérons sont inférieurs ; elle devient couchée ou horizontale peu de
temps ap rè s , e t ses éperons sont alors postérieurs. Le pollen est composé de globules sphériques ; le
style est ca p illa ire , transparent ; le stigmate est te rm in a l, concave en g re lo t, ouvert par une petite
bouche transversale, sémi-lunaire. L’o vaire est in fè r e , épais comme la base du tu b e , lo n g de quatre
millimètres (deu x ligues) ; il est su rm on té , dans l’in térieur d u tub e de la co ro lle , e t contre la base
du s t y le , pa r deux petits corps d ro its , filifo rm e s , longs de quatre millimètres (d eu x lign e s ).
H I S T O I R E .
Cette plante a été apportée de l’Ile de F rance au Jardin des Plantes, où elle a fleu ri au mois d’août.
Elle croit eu plusieurs endroits des Indes orientales.
O BSER FA T I O N S.
Les fleurs ne s’ouvreut successivement su r le cône qu’une ou deux à la fois ; elles se fanent
promptement, se réduisent en une espèce de g e lé e ou de bouillie dans le fon d des écailles du côn e ,
et se tordent en spirales.
Jacquin a très-bien représenté e t décrit quatre p a rtie s , qu e nous n’avons pu observer dans la racine
du Curcuma longa, cette plante étan t trop rare. 11 a dé crit premièrement une base ou souche
composée de tubérosités b ru n e s , gro s se s , plus ou m o in s , comme un oe u f de p o u le , marquée de
cicatrices annulaires. Secondement des coraons ép a is , d ig ité s , d’u n jaune p â le , noueux e t portant
un e la rg e écaille co u ch é e , mem b ran eu se, onguiforme à chaque a r t icu la t io n , e t q u i aboutissent à
des oeilletons de la plante. Les cordons e t la souche tubéreuse ont une sa veur aromatique u n peu
â c r e , sont jaunes en dedans; ils se rid ent en sé chan t, diminu ent beaucoup de volume, e t ressemb
len t tout-à-fait aux morceaux de racines que l’on donne dans les boutiques sous les noms de
Curcuma rond et de Curcuma long. Enfin les deux dernières parties que Jacquin considère dans l’ensemble
des ra c in e s ,so n t deux espèces de rad icu le s , naissant plus communément de la souche que
des cordons tra ça n ts , et se te rm in an t, les uns en p o in te , les autres par une tubérosité oblongue.
Rheede a représenté (vo l. x j , tab. v i j ) le K u a ou Curcuma, qui est du même g en re , e t peut-être
la même espèce qu e ce lle qu e nous dé c r ivon s , les fleurs e t l’anthère ayant la même conformation.
Mais le Curcuma représenté pa r Rheede p rodu it ses fleurs en épis séparés des t ig e s , tandis qu e le
Curcuma longa les prod u it su r le milieu de la tige même.
Lamarck n’a d é c r it , comme étant le Curcuma rotunda, qu’une plante de Rheede ( Hort. M a l. x j ,
tab. x ) , dont les fleurs naissent entre les feu ille s , sont blanches, peu n ombreu ses , e t ont un tube
lo n g , g r ê le , fo r t saillant hors de la spa the , espèce de plante dont fa ra c in e , comme l’a représentée
R he ede , est tu b é re u se , a r ro n d ie , plus grosse que le p o u c e , e t q u i , suivant ce même au teu r , est
jaune en d e d a n s , com p a c te , ch a rn u e , marquée de cercles v a r ié s , ja un e s -ro u ge â tre s , dont la
sa veur très-forte tien t du g in g emb re e t du safran. Jean Commelin a regardé cette plante comme le
vrai Curcuma rond des boutiques des droguistes ; le lo n g tub e de la fleu r offre un caractère pou r le
gen re Curcuma , si l’on ne dé tru it pas tout-à-fa it ce genre.
E X P L I C A T I O N D E L A P L A N C H E .
La Plante de grandeur naturelle.
Fig. 1. Le périgone dont les divisions sont éc a rtées , pour faire voir clairement leu r nombre
de six.
2. Le périgone dans sa forme n a tu re lle , tiré hors des bractées.
3. Le périgone fendu longitudinalement.