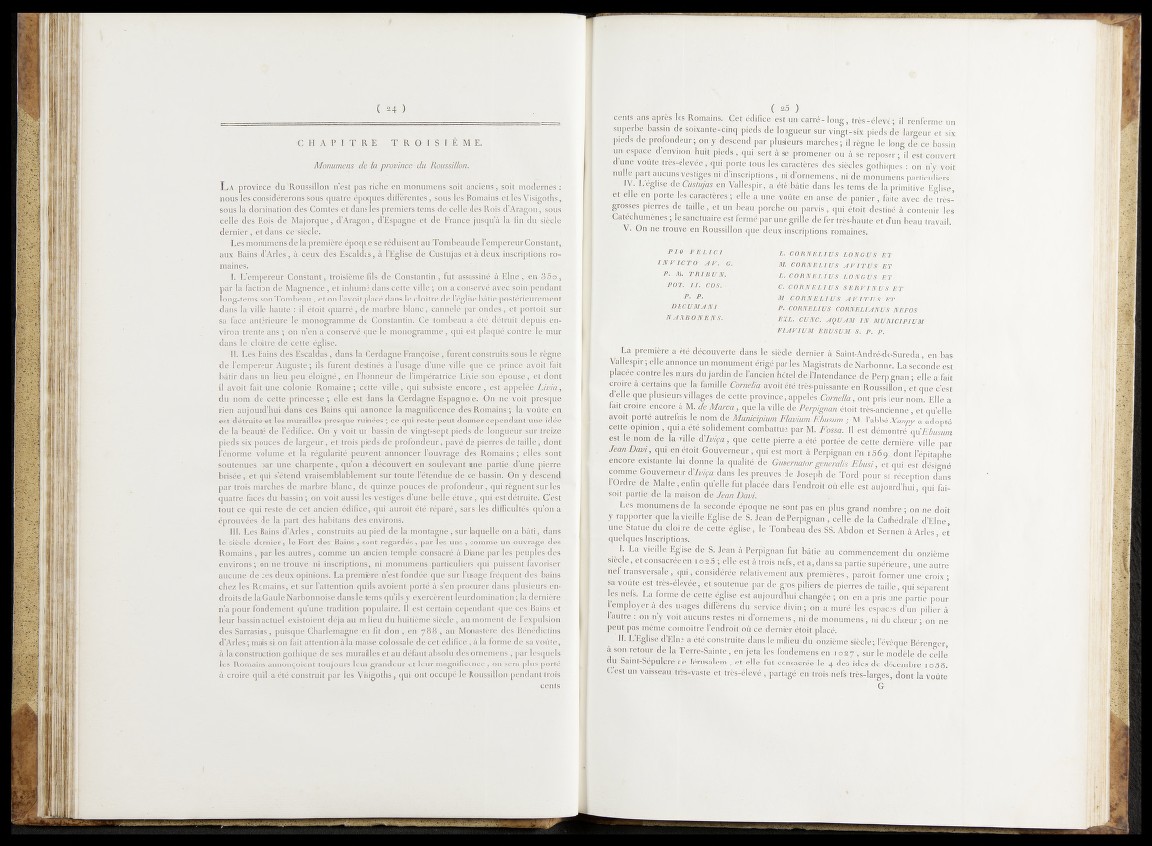
A iorium tn j'dt
;'Tï; 'tJ% s ^ g nif)'t^Sifci> :
Dj m- tflJf -:\ in5® v ,J
iraijjsjjg^JSM^nAi ojI.liss^fM'tgS'ët.dans les pi i mu i s u ms de celte dé s Uj*g®m]KMiSoe r S i j
iMPljaBlfgillÆffilr- MTTK)iqjy]^rAr.'K(in : ïlïï -jiagne r i tit, rflyK^jral la mi duj'iç|]|?
1 Ttu ^ ^jij^Jc l/ jy'C.yflitrç.uj*tC- '’f f iM w
^oiMJs-<h s^I'idnaw-a 1
I I ( 111 pei eur Constant -oi si ème?( i lgjMfë Cons tan ti n , fut asssassiné à Eine , eÄt$Ss;£
par la faction de Magnence, et inhumt dans cette ville ; on a conservé avec soin pendanl
long-tems sijfffom be lu , et oh l’avpil place dans ledôîtrc de l’église bâtie postérieurement
dans la ville haute : il idoit1 quairé", de marbre blanc, Cannelé'pair oedés..,,'ei porti)il sur
sa lacé antérieure le monogrànime de Constantin. Ce tombeau àiëté cléfrùi-t depuis eu-
virpnfftènfl ans ; oiïfiÇéh a conservé q;w fe le m o no gramm^S] u i est p la que contre le mur
dans le cloMïêidèreelte église.
II. L e s .Bains des Escaldas, dans la Cerdagne François®', lurent construits, sousle règne
de 1 empereur Auguste ; ils Jure ni destinés à l’usage d’une ville que ce prince ai||ip?d'ait
bâtir dans tin lieu peu éloigné, en l’honneur de l’impt ratric* I ivie s ôq‘. épouse, et dont
il avôit fait une colonie. Romaint ; cetIe vi(le , qui subsiste eiicon , est appelée L iv ia ,
du nom de cétte princesse ; elle est dans là C e r cl a gneEsp agnelle. On ne voit presque
rien aujourd’hui <1 ins ces Bains qui annonce la magnificence des Romains ; la voûte en
fstSR h ihm .&d?s muraille -,
dedarolannTl» jffijî|tb7rS(»n8^ ^ ^ np ^ ^iri d
•pieds six polices de largeur, et trois pieds'de profondeur, pavé de pierresjÉe-,taille, dont
l’énorme volume et la régul irité peuvent annoncer l’ouvrage des Romains ; elles sont
soutenues M i jm r .( harpt nlt , <n ù<K^ ^ lA ^ m i i Ji I B .111 mi iffi»
1l ia f i5 ? ^ « g iii's ’?t<,7V(l y r i*i>>cTiîihI;îh l jA n i t rT C m
par trois marches de marbre blanc, de quinze pouces de profondeur, qiui régnent sur les
quatre faces du bassin ; on /oit aussilès vestiges d’une belle étuve, qui est détruite a C’est
tout ce qüi reste de cet nu i< n édifie e , qui aurait été réparé, sans les difficultés qu’on a
éprouvées de la ( pai t des habitans des environs.
III. Les Bains d Arles , construits au pied d e la montagne , sur laquelle on a b;iti, dans
le siècle dernier, le Fort-des-Bai.ns , sont regardés. par les uns , comme un ouvrage des
Romains , par. les autres, comme un ancie n temple consacré à I liane par les peuples des
environs ; on ne trouve ni inscriptions, ni monumens particuliers qui puissent favoriser
aucune de ces deux opinions. I a première n’est fondée que sur l’usage fréquent des bains
èfiez les Romains, et sur l’attention qu’ils avoienl porté à s en procurer dans pWsié ®s endroits
de la Gaule Nai bonnoise dans le tems qu’ils y exercèrent leur doraint lion; l'a d^ÔMière
n’a pour fondement qu’une tradition populaire II est certain cependant que ces-'Bains et
leur bassin actuel existaient déjà au milieu d u huitième siée l e , £ u moment de l’expulsion
des Sarrasins, puisque Charlemagne en lit don , en , au Mona lèi 3 dt Bénédictins
d’A rles; mais si on fait attention à la masse colossale de cet édifice à la tonne de sa a où te,
à la construction golîïiqjte de ses murailles et au défaut absolu des orne ne ns . pat lesquels
lies'Romains ànnonçoient toujours leur grandeur et leur magnificence , on sei i plus porté
à croireïspSl a été construit par
( 2 5 )
1 ’i l t p i - In h ^ *p è s -é lè v é ^ jl Renferme un
E J ' ts-in Hr $ $ j f [ u (Ml ‘ " l o n g i \ u i ^ 4iÆ w ® é » d a t g e u r et sis
J 1 L ^ l 1 , i & f j u h long^dé*! o-ba-Hn
m i pVS, e‘ ffqb u ve 11
3 des siècles gothiques : on n’y 'w n ^ E j^ TO g i1 nu 'i'-‘ ;iîiiKSSn'ojmM.ii-- [ | H m E E
B K ; ffürtjmt* 1 i 9 1 1( M t N H I I ■ H
■" S S 11 t & M H
3 3 ?! ‘tfl11 ’Üp • 1 9 B 1H
n(r tiO(ia p R ^ I Jiu i. IhîiÂpuî-flt u\ nw,r rÜL#*^
I P IO F E L I C I
sfèpf u.
PO T . I I . COS. -
P . P .
D E C U M A N I
N A R B O N E N S .
n E 1
* ,;i À q t /-V r.-it
La première a été découverte dans le siècle dernier à Saint-André-de-Sureda, en bas
Vallespir ; elle annonce un monument M j ''il > i
n ^ ^ M ' l f r iî1 r T f 1 '*f ^ 't^V 'V lfllM iflfM lî1 r 11* Y l’’,|ï l \ l ^ ' 1 ‘:<T 1 'r" m ; elle a fait
r -av1 'oit porté autrefois h ■ TT^rI r b i L ' ® ^
est démontré qu E bu sum .
est le nom de la ville à ’Iv iç a , que cette pierre a été portée de cette dernière ville par
lL/^ ^ B a n n .1» ^ -b3.‘Jj . ta>i- g 1^ l^ r g ^ i^r. ’
soit f
y rapporter que la vieille Eglise de S. Jean de Perpignan, celle de la Cathédrale d’Elne
quelques
Slècle 1 r y l u tu ! u fîi^ u ^ r '
k - îJ(
es nels. La forme de cette église est aujourd’hui changée ; on en a pris une partie pour
D M "i t H
K 'eUt-‘P-oÏJï-emt E ^ ^ M M n ç jl^ lg l^ ^ g p g i,
II b’ Ls '^ - d i y i i c
à on 1 * , ortSjf
j ^ l h t - ^ a p f f l j r e d ^ J é | g s | f e ^ , . a S 11 t ^
E ’p t un-vàfss’p M ^ y a s t e I l i t liéontc