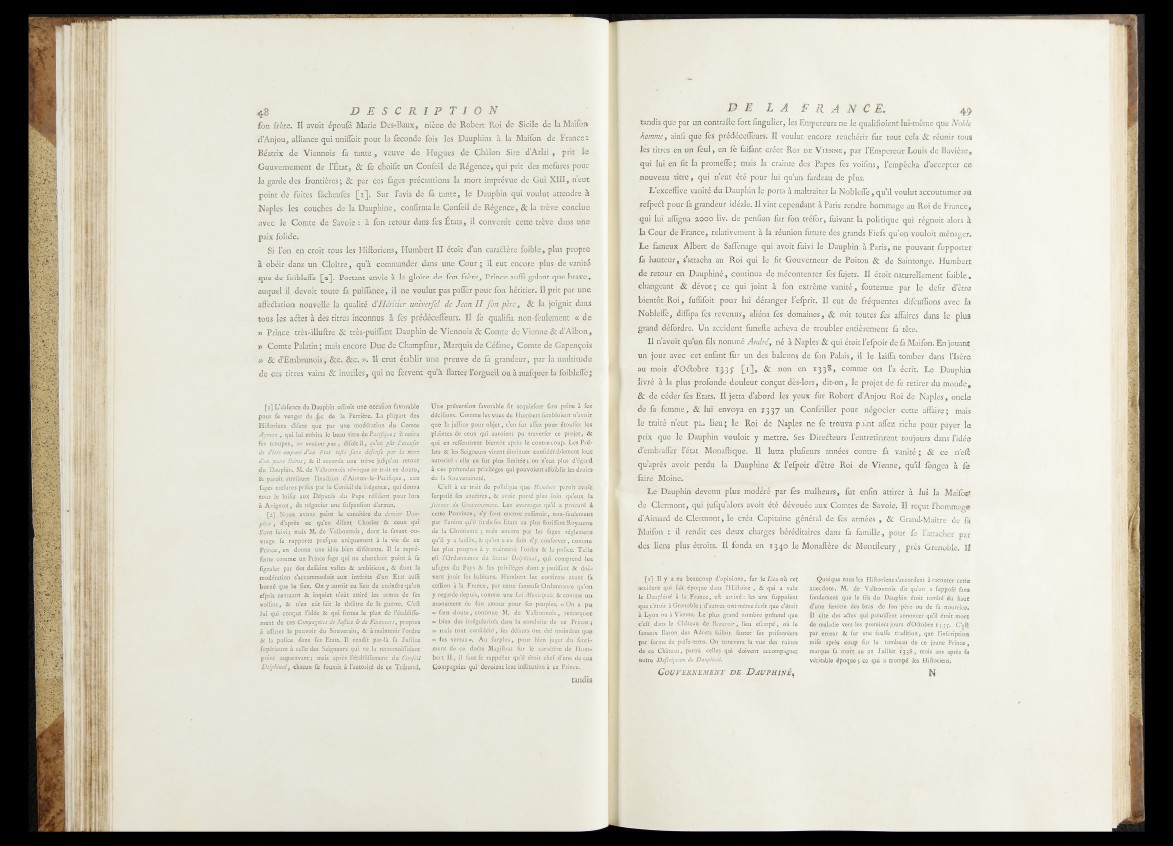
gg - D E S C R I P T I O N
fon frère. H ayoit-éporfé Marie Dès-Baux, nièce de Robert Roi de Sicile de la Maifon
d ’Anjou, alliance dm^niriLi: ppuoFla féconde fbSmes „^auphins à 'la- Maifon de France r
Béatrix de Viennois là tante., veuve de Hugues .de Châlon Sire .d’Arlai, prit le
/Gouvernement de l’État', & le choifit un Çonlèil de Régence.,, qui prit ag&nfefijxes "pour
la.gardecLi frontièfcs^^ par. çesiC'§£s«prétautioiis la moit 'mpié\u. d. X111, nie’}: -!
point de fuites fâche ufes [ i ] . Sur l’avis de là tante, le Dauphin qui voulut attendre à
■JJ pies les couche de la Dauphine, confirma le Confeil de Régence, & la t èv.e conclue
avec le Comte de Savoie :. à fon retour dans fes États, il convertit cette trëv.e danslune
paix folidetfi.'1
< Si “fonleni-croit tous les.Hjfôjien^f’Humbert II étetft d’un -carg&èi:.. fuiblej,4phis propre
à olWjtTms fin Gh rrc ,’^ ’ajîcpmniandcr jh n s une Cour ; j 1 c^t encore' mté
Que de foiblelîè [2] Portant envie à li gloire de Ion frère, Prince <ufîi g liant que brave,
auquel il de^ÿTtoute- fa pnmàhce, flâné_wn|St-pas palier pourÆ^4C4SSr" 4ffirlt p^atune
afîèélation nouvelle la qualité S H éritier univerfel. de Jean I I fo rt,p ire , & la joignit dans
^tous les aéles à des tiSesJ inconnus à lés prédécèfié'ursfclfôç, quahfia nonHeuleirifirït.« de
» Prince très-illullrc & très-puiflànt Dauphin de Viennois & Comte de Vienne & d’Albbn’,
» .Contre Palatin ; cma%ehf||j| Duc 3e Châmpfaur, Marquis dÿÇ éfi ne .‘âfeoinnSd e Gapin^ois
» & ÿ E m t e i n & ÿ î f& ç j .H erutîùhhrmiie.preuve deila grindeui, p 1 li 11,’ilnmde
de cês titres vains &z inutiles, qui ne fervent qu à flatter l’orgueil ou à mafquer la foiblefléj
’[ î] L’abfençë’du Dauphin offrolt une occafion favorable
pour îe ’venger du jfàe de la Perrière.. ;La ..plupart des
Hiftoriens difent que par : une .modération du Cjamte "
Aymo n , qui lui mérita le beau titre de 'Pacifique; il retira
fes troupes, ne voulant p a sA .difoitril, quon p ut l’ac cu fà j
de s être emparé i ’un Eta t lejlé fa n s déjenfe p ur la. mort
cCun jeune Héros; & il accorda une trêve jufqu’au retour
rdu Dauphin. M. de V^bofmois révoque ce trait en doute,
8c p aroît attribuer l’inaéfcion d’Aimon- le-Paci fi que , aux
fà g es||i|p ïr es prifès -pzfej’r&l^ ^M iî dé; ^Régéneë, qui donna
.tout -Ife .loïfîr aux Députés du. Pape, réfîdentl pour ,lor§
ïà '-A v^lo |f£^^ unèiTüfpenfîqn (fàrmes, . _
pi fa] $îo.Us - :av,ons peint le caradère du ~rdem ter Daü?
p hin f d'après ce qüeïl ;difënt Chorier & ceux : ^quÿ
i ^ n t ifiiivï;; mais M. de Valbonnois, .d o u b le -lavant .ouvrage
fe rapporte prefque uniquement à la.' vie.
Prince, en donné une idée bien différente. I l le repre?
fente comme, un Prince fage qui ne cherchoit'point ai fe
Îîgnaler par des deffeins vaftes & ambitieux.^ # dont la
modération s’accommodoit aux intérêts d’un Etat au®:
borné que le fién. O a y auroit eu lieu de craindré qu ûh
efprit remuant & iuqdiet n’eût attiré les -armes "de fes
ÿpïfîns j . & n’en eut fait le théâtre de la guerre. jC’eft,
-4 iii ,aui ^conçut fidé è & qui forma le plan de l ’é^bliifëÿ' '
ment de <xs\Çompagnies^e Jujlice & de Financées, propres
- ,à‘ âïfureï fe pouyooetîdu Souverain, & amaintenir l.?^rafe,
Sc !a, ipèl|çe dans fes Etats. I l rendit par-là fa Jufticë
fupérieure à celle des Seigneurs qui ne la reconnoiffoient
point »auparavant ; mais après fétabliflement d u WojjBÛ.
Velphinal2 chacun fe fournit à l’autorité de ce Tribunal,
'favoraiblë Éè acquiefcer fans ■ peine à feS
'degi-fîonsi -Comme les vues d e . Humbei^fem'broienit/'iiîavpiic
■ que la juftice pour/p'l^^^cfe en fut; affezi^pMï: ;ét<$uiffer les
plaintes de c eu x 'q u i7 .auroient pu traverfer' ce p ro jet, &
lats & les Seigneurs v iren t diminuer confidérablement leur
aufôrité : elle en fut -pl-us 'limitée ; on n’eu t ;plus / a égard
à; ces prétendus privilèges qui pouvoient affeiblk <les droits
de la Souveraineté.
G’eft tàfigb^tlaiyeaiP'blitiq ue ,que. ffaraôerr paroît .avoir
|forpalTé' fes >iancê|rë^, i'8e ta voir. jSs
Jpëflêe; L e s , avantages qu’if a procuré à
cette SÊoSfiudé^, s’y forît; ^jelfentj r -L ndhafeufemeiû:
par Ip h io p qiu’il fit de fes Etats au plus fïcuifTant Royaume
âàev la "Chrétienté > mais- :;ènçèrè .par ’ les :fagès. réglemehs
qu’il y a laides,.& qu’on a eu foin» id^y.-conferver, comme
les plus propres à y maintenir l’ordre & la police. Telle
ufages du Pays & les privilèges'dont y jouiffent & doiv
e n t lesL_:esM|Fnïâ' savant là
celEon à la‘-Erarice, 'par cette fameufe t3 rdWnan‘ee qu’on
y regardé depuis, comme un e Loi Municipale & comme un
monument de fon amour pour fes peuples, « Onc a' p u
» fansi>{dou|e,\continue M, de' ^albimnoip, rrèmàrquër
» bien des irrégularités-, dàh^ l^ poh'dtiite de ce Prince ;
^^^^^^^mTOgonl^éfé“^fe''s^aéfëiï^é-nt,v*été moindres qu^
33 fes. vertus.», jugé|h^dw fenti-«
ment de çe doâie; Magiftrat fur le c^raâère' de Hum-i
b e rt I f ÿ ilf ra^KleJrappellei? flüîil; é toit chef d’une de ces
Compagnies qui* d@voient leur inilitution. à ce Erince«;
tandis
& Ë L A F R A N C S . &
.J a n & Æ fo ri^ ^K lr^ les etoe Nom
mi édt.Ct.Ll'.iiri., Il RS lut A c^^ j e y h it n lùr & réuiÿLf.touS
|||î> .c I 1 ' Cuu «-éei RplA ,,V ibnne, pai^ffimp^^^fepui«- de Bavi|i%
jioutLjU'^ntLer, jyH R J ^ .c * pÔ ^ lii> q -^ ^ ^Â é au déplus., /, ’■
. L’excefliv 0 v 1 '1 \ '(.uhit aCCout^Mto
rmjs^^rtiid.'ii) îPc J Æftmt t j cvd'j.i t , F lusjyAHcÂEi m0.
qui >lu; 1 frire |
>Jà Ce i iÆ t ln 11 Z a j ü K JM i™ 11 u lcjef s g ta jd s f I . v ^Li j ^ S n \ SQ.clne c j,
t a 'Â|b.n dçjSjjhfi > i \ o n .-lié 1 ilSB^up.j|Mt.'P.11s. 'nl^oiivant-.ifüpporfef
fi. hauteur ^attacha iu g |lq i qui ciiî.eiÎJd^ Sitau f i .d vihJü^n^C.Î;! lluii b. et
h4- 4ÜP11 VÎP uflJLnii> ,to, rifi ^ ^ll> rs llKi tfSySn y.?* ‘-j r
gjangeant 8t dévot defir d etra
pjcdto'- RoifKfu‘i.loii ' Çoue A u ^ nMi.v r Vclpn.i,. 3M | | c'HlnSfteÄJkli« ‘uUion j \ei*bË
Ë ^ jljS j^ l'llIl'i’ Icg^A^ rir a g dliéî'i^ics'jtd'o’mam.^. éL i'I /^ t^ i'c iff.i^ ^ ^K d a n s le plus
l.ia'id^jl'JI&di.. Ç11 iccid n hiîîelt. ulic 1 d .y ^M J a c jn L r .p en 1 iiÆ
li"u!^ j™ q f^ n j ll,.^ m u c Ar, pie &. qui / p ] u M lion.Enj ni
un jour avec cet uiîj (I^ lm c^ iT ücÆcmaBàlâ sj -al L ^liihTifa^ ü . 'rt djiu^il'Kèf J
au mois d’Oélobre 133J [1 3 , & J.c D u jh i #
îlivré à la phKproio Wc djùkui < onriu d.Xlois, dit 011,J *PI»1.‘l
& ts. Il jet lAibord les y .ux , lui
: ’ . n ù J *
h^ iIt■ ~ i^ 'iV c '^ ^ ^ r d P ^ - ,<>-:*trnllN a Td.
p iv. «latjMLJit aipl inAauluit y m.lTc.
^ P ^ ^ ^ ^ g ^ ^ » B B i.if liq \ie II lutta pluii.uts
| l 4 pr. a . vo i<fp.udu la ?D.aujj&naj& l’elpoir ^^trê iB oi ^^,yjennïè'>ï'<|®" M^ea à lé
1 i t . M q m c . 1
»^æ^afôfi}fedteVenu*iulus^™'id&Fél.p,a^fesajmalheujs.. Æ t M a i l ô i j
•Ç^GLrm e u u ^ . e n - T ^ t v . j ï v . g I
^ . ‘ViM-T i m ^ g h r iiiQ iu i, lefc 1 .â feC 1 L u u e t e e a u i 3 c l . L \ , & . m -i 1 a j a d  a | t | | . | e
ffilii'fpi,! : il tend ! ee^jÆux ch.ii^àHc/rédityK^.d ‘ns jptaïf ifc l’i Lt u hëf -pat
M e ji^ 'ïîp lusy tiq lÉ'. Il ® T i 3 4 0 -le Monaftère de Mogtfteury.3 près'Ôienphle. H
[1] I l y a êu beàdeo;U:§ d’opinions, fur le; îùeu qü^cèt.
accident qui fait époque dans l’Hiftoire , & qui a valu
îe Dauphiné à la F ian c e , eft arrivé : les uns: ià^|i^fenfe
•iqiuê.:e^i©i^' à Giebo’bîil; ‘d’autres o n t même écri|'^u ^ ;. c étoit
à Ly o n ou à Vienne. lie; pîus; grand hombte préténd que,
. c’eft. dans le Château, de Beauvoir , lieu efearpé, ©ù lé.
fameux Baton des Admets. fauter les ^tifènhiersi
g a r' forme de pan^ftemsO^^j ^ ô h v era, la, v,üe;.4ès, ruines
•flfe" c ^G h â te a u , parmi celles qui? 'idpivent, âCcompagnét
, notre; De/e«j>tio/i duiJÈJauphinjé^^^
J^ütqrqùe, tous ®^^ormns!sXccdrdërit à fâcôntër' cetè>t
kueedote, Mi -ydë^ l B ^ |n a ^ ^ ^ P ù |on a' ft^ ^ ifd ’ßuil
fondement que> le fils dü^Dauphin étoit tomb^dii'' îiaiié.'
d une fenêtre dés bras dé du de &ÿë&atâêl^'.
t l ,cite des aÂésl,''qüi parbi^mï^^^^^æfêqij^il étoit- morÉ
^ÆBmmadie vers lVs1 3y< C’elk
g a r^^eur fur iln e^ ^ ^ ^ -^ ^ it io n i qüe iünfériptiâft
après ’^çùp für lëf- TOm^ ^lVHë Æmiëan^'^rinp^.
marqué^ fà, niÔEtfeü âfc ' l i l t e : trois, ân^: après fâ
véritable époque ; ce qUi a trompé les Hiftorienst'