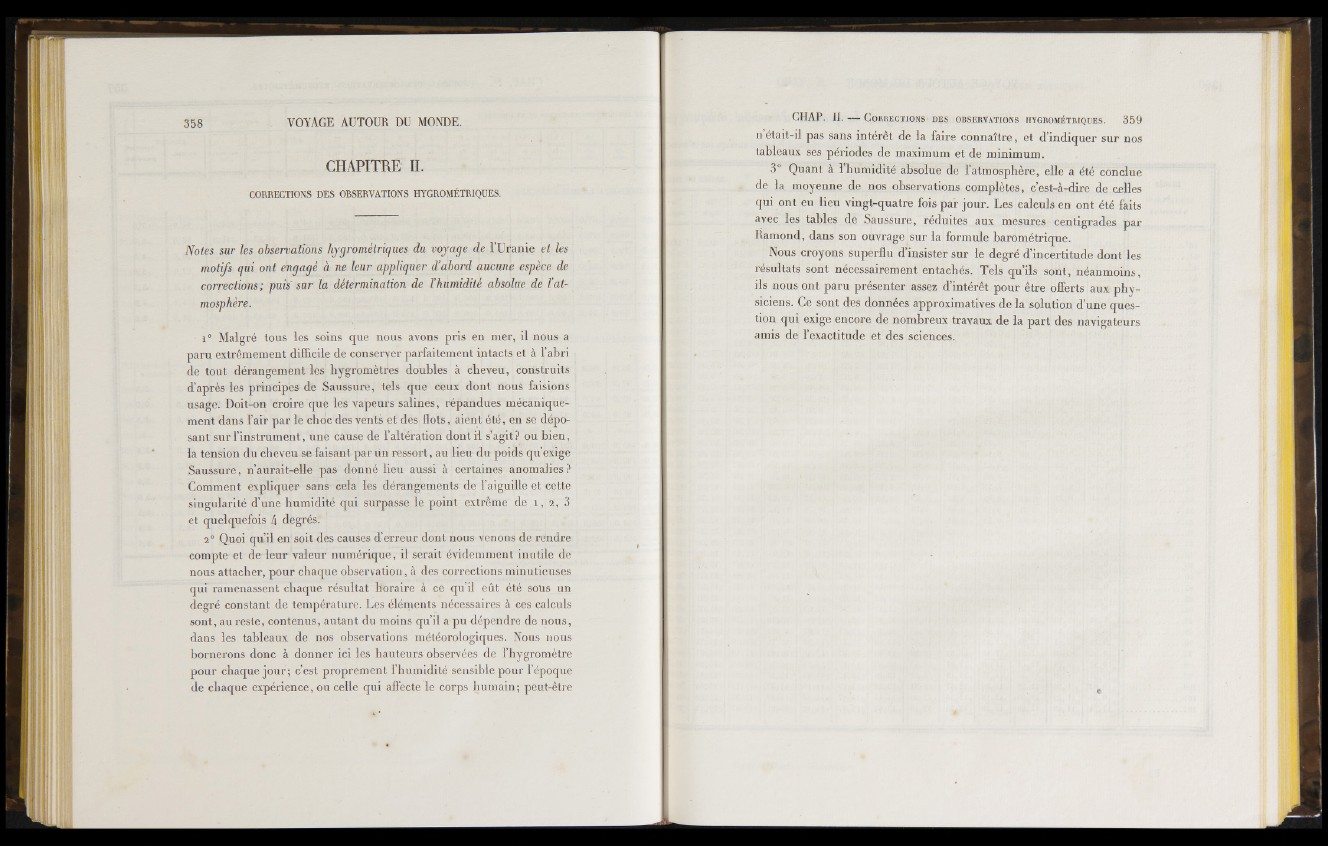
ri
:i| ,1
CHAPITRE II.
CORRECTIONS DES OBSERVATIONS HYGROMÉTRIQUES.
Noies sur les observations hygrométriques du voyage de l ’Uranie e t les
motifs qui o n t engagé à ne leur appliquer d ’abord aucune espèce de
corrections; puis su r la détermination de l’humidité absolue de l’a tmosphère.
1° Malgré tous les soins que nous avons pris en mer, il nous a
paru extrêmement difficile de conserver parfaitement intacts et à l’abri
de tout dérangement les hygromètres doubles à cheveu, construits
d’après les principes de Saussure, tels que ceux dont nous faisions
usage. Doit-on croire que les vapeurs salines, répandues mécaniquement
dans l’air par le choc des vents et des flo ts, aient été, en se déposant
sur l’instrument, une cause de l’altération dont il s’agit? ou bien,
la tension du cheveu se faisant parmi ressort, au lieu du poids qu’exige
Saussure, n’aurait-elle pas donné lieu aussi à certaines anomalies?
Comment expliquer sans cela les dérangements de l’aiguille et cette
singularité d’une humidité qui surpasse le point extrême de i , 2, 3
et quelquefois 4 degrés.
2° Quoi qu’il en soit des causes d’erreur dont nous venons de rendre
compte et de leur valeur numérique, il serait évidemment inutile de
nous attacher, pour chaque observation, à des corrections minutieuses
qui ramenassent chaque résultat horaire à ce c[u’il eût été soüs un
degré constant de température. Les éléments nécessaires à ces calculs
sont, au reste, contenus, autant du moins qu’il a pu dépendre de nous,
dans les tableaux de nos observations météorologiques. Nous nous
bornerons donc à donner ici les hauteurs observées de l’hygromètre
pour chaque jour; c’est proprement l’humidité sensible pour l ’époque
de chaque expérience, ou celle qui affecte le corps humain; peut-être
CHAP. 11. — C o i i r .E c iTO N S d e s o b s e r v a t i o n s h y g k o m é t e i q u e s . 359
n était-il pas sans intérêt de la faire connaître, et d’indiquer sur nos
tableaux ses périodes de maximum et de minimum.
3° Quant à l’humidité absolue de l’atmosphère, elle a été conclue
de la moyenne de nos observations complètes, c’est-à-dire de celles
qui ont eu lieu vingt-quatre fois par jour. Les calculs en ont été faits
avec les tables de Saussure, réduites aux mesures centigrades par
Ramond, dans son ouvrage sur la formule barométrique.
Nous croyons superflu d’insister sur le degré d’incertitude dont les
résultats sont nécessairement entachés. Tels qu’ils sont, néanmoins,
ils nous ont paru présenter assez d’intérêt pour être offerts aux p h y siciens.
Ce sont des données approximatives de la solution d’une question
qui exige encore de nombreux travaux de la part des navigateurs
amis de fexactitude et des sciences.