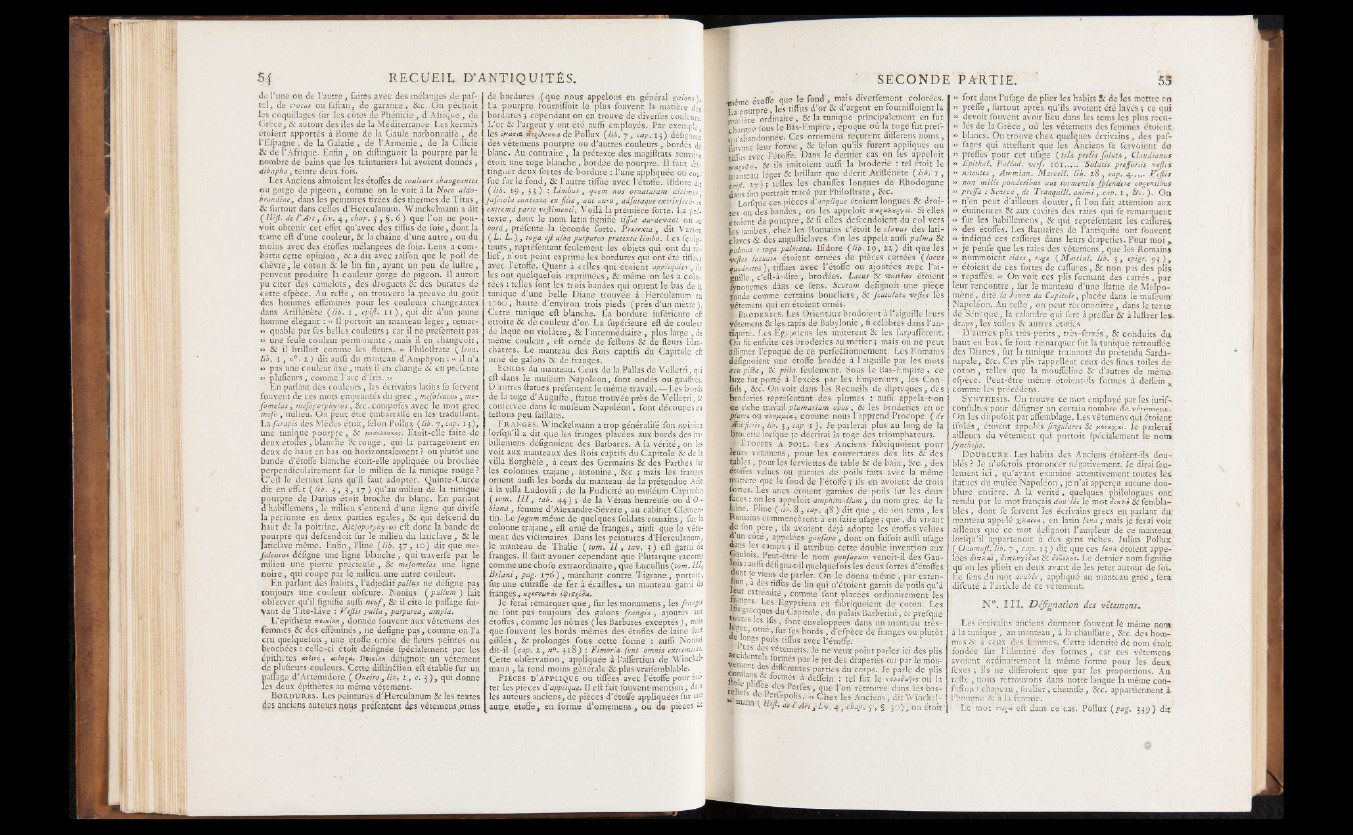
RECUEIL $ 4 D’ANTIQUITÉS.
de l’ une ou de l’autre , faitès avec des mélanges .de paf-
te l, de crocus ou fafran, de garance, &c. On pêchoit
les coquillages fur les côtes de Phénicie, d 'Afrique , de
Grèce, & autour des Îles de la Méditerranée. Les kermès
étoient apportés à Rome de la Gaule narbonnaife, de
l ’Efpagne, de la Galatie, de l’Arménie, de la Cilicie
te ae l’Afrique. Enfin, on diftinguoit la pourpre par le
nombre de bains que les teinturiers lui avoient donnés,
dibapha, teinte deux fois.
Les Anciens aimoient les étoffes de couleurs changeantes
ou gorge de pigeon, comme on le voit à la Noce aldo-
brandinedans les peintures tirées des thermes de T itu s ,
te furtout dans celles d’Herculanum. Winckelmann a dit
( Hift. dè VArt, liv. 4 , chap. 5 , §. 6 ) que l’ on ne pou-
voit obtenir cet effet qu’avec des tiffus de foie, dont la
trame eft d’une couleur, & la chaîne d’ une autre, ou du
moins avec des étpffes mélangées de foie. Lens a combattu
cette opinion, & a dit avec raifon que le poil de
chèvre, le coton & le lin fin, ayant un peu de lullre,
peuvent produire la couleur gorge de pigeon. Il auroit
pu citer des camelots, des droguets te des burates de
cette efpèce. Au refte, on trouvera kupreuve du goût
des hommes efféminés pouf les couleurs changeantes
dans Arifténète ( lib. 1 , epi.fi. 1 1 ) , qui dit d’un jeune i
homme élégant hi< Il portoit un manteau lég er, remar- :
» quable par fes belles couleurs 3 car il ne préfentoit pas !
»9 une feule couleur permanente , mais il en changeoit,
» & il brilloit comme les fleurs. » Philoltrate ( lcon.
lib. 1 , n0'. 2 ) dit auffi du manteau d’Amphyon : « Il n’a
w pas une couleur fixé , mais il en change & en préfente
» plufieurs, comme l ’arc d’ iris. ^
' En parlant dès couleurs, les écrivains latins fe fervent
fou vent de ces mots empruntés du g re c , mefoleucos, me-
fomêlas, mefoporpkyros3 &c.,compofés avec le mot grec
mefo, milieu. On peut être embarraffé en les-traduifant.
La farapis des Me des étoit, félon Pollux {lib. 7 , cap. 13),
une tunique pourpre, & fcto-oxtuxos. Etoit-elle faite-.de
deux étoffes, blanche te rouge, qui la partageaient en
deux de haut en bas ou horizontalement ? ou plutôt une
bande d’étoffe blanche étoit-elle appliquée ou brochée
perpendiculairement fur le milieu de la tunique rouge ?
C ’eft le dernier Tens qu’il faut adopter. Quinte-Curce
dit en effet (lib . 3 , 3, 1 7 ) qu’au milieu de la tunique
pourpre de Darius étoit broché du blanc. En parlant
d habillemens, le milieu s’entend d’une ligne qui divife
la perfonne en deux parties égales, & qui defcend du
haut de la poitrine. Mefoporphyros eft donc la bande de
pourpre qui defcendoit fur le milieu du laticlave , & le
Iaticlave même. Enfin, Pline ( lib. 37,< 10) dit que mefoleucos
défigne une ligne blanche, qui traverfe par le
milieu une pierre pré.cieufe , & mejotnelàs une ligne
n o ire , qui coupe par lè milieu, une autre couleur.
En parlant des habits, l’adjeétif pullus ne défigne pas
toujours une couleur obfcure. Ko ni us ( pullum ) fait
obferver qu’il fignifie auffi neuf3 te il cité le palîage fui-
Vant de Tite-Live : f^eftis pulla 3 purpurea, amp la.
L ’épithète irtnclx*}, donnée fouvent'aux'vêtemens des
femmes te des efféminés , ne défigne pas, comme 011 l’a
cru quelquefois , une étoffe ornée de fleurs peintes ou
brochées : celle-ci étoit défignée .fpéeial'ement par les
épithètes « v f t / y î j d é f i g n o i t un vêtement
de plufieurs. couleurs, Cette diftinétion eft établie fur un
pairage d’Artémidôre ( Ûneiro 3 lib. z;, c. 3 ) , qui donne
les deux épithètes.au même vêtement.
Bordur.es. Les peintures. d’Herculanum & les textes
des ancien? auteurs nous prtentent dssvêtçmens .ornés
de bordures <(,que nous appelons en général galons),
La pourpre fourniffoit le plus fouvent la matière des
bordures 5 cependant on en trouve de diverfes couleurs,
L’or te l’argent y ont été aulfi employés. Par exemple
les IpÛTia. £tçl\tvxct de Pollux (lib. 7 , cap. 13) défignent
des vêtemens pourpre ou d’ autres couleurs, bordés de
' blanc. Au contraire, la prétexte des magiftrats romains
étoit une toge blanche, bordée de pourpre. Il faut dif-
tinguer deux fortes de bordure : l’une appliquée ou cou-
I fue fur le fond, te l’autre tiffue avec l'étoffe, lfidore dit
: ( lib. 1.9, 33) : Limbus , quem nos ornaturam dicimus
fafciola contesta ex filis , a ut auro , adfutaque extnnfccùs /J I
extremâ parte veftimenti. Voilà la première forte. La prétexte,
dont le nom latin fignifie tijfue au-devant ou a«
bord, préfente la féconde forte. Prétexta, dit VarroJ
( L. L. ) , toga efi alba purpureo, prétexta limbo.. Les fculp-
teurs, reprefentant feulement les objets qui ont du relie
f , n’ont point exprimé les bordures qui ont été tifiets
avec-l’étoffe. Quant à celles qui étoient appliquéen} ils
les ont quelquefois exprimées, & même on les a coincées
: telles font les trois bandes qui ornent le bas de la
tunique d’une belle Diane trouvée à Herculanum en
1760, haute d’environ trois pieds (près d’un mètre).
Cette tunique eft blanche. La bordure inférieure eft
étroite &c de couleur d’ or. La fupérieure eft de couleur
de laque ou violâtre, te l’ intermédiaire , plus large, de
même couleur, eft ornée de feftons & ae fleurs blanchâtres,
Le manteau des Rois captifs du Capitole eft
orné de galons ’& de franges.
. -Bords du manteau.. Ceux de la Pallas de V elletri, qui
eft dans le muféum Napoléon, font ondés ou gauflrés.
D ’autres ftatues préfentent le même travail. — Lès bords
de la toge d’ Augufte, ftatue trouvée près de Velletri, &
: confervée dans le muféum Napoléon, font découpés en
feftons peu faillans.
Franges. Winckelmann a trop généralifé fon opinion
lqrfqu’ il a dit que les franges placées, aux bords des ha*
billemens défignoient des Barbares. A la vérité, on les
' voit aux,manteaux des Rois captifs du Capitole & de la
villa Borghèfe , à, ceux des Germains & des Parthes fur
les colonnes trajane, antonine, &c. ; mais les franges
ornent aufli les bords du manteau de la prétendue Ane
à la villa Ludovifi 3 de la Pudicité au muféum Capitolin
(tom. I I I , tab. 4 4 )5 de la Vénus heureufe ou d'O;-
biana, femme d’Alexandre-Sévère , au cabinet Glémen-
tin. Le fagum même de quelques foldats romains^ -fur la
colonne trajane, eft orné de franges., ainfi que le vêtement
des viétimaires. Dans les peintures d’Herculanum,
le manteau de Thalie (tom. I I , tav. 3) eft garni de
franges. Il faut avouer cependant que Plutarque raconte
comme une chofe extraordinaire, que Lucullus (tom. 111,
Briani,. pag. 1 7 6 ) , marchant contre Tigrane, portoit,
fur une cuiraffe de fer à é.cailles , un manteau garni de
franges, xçocoTairjjv t<ptsç!£'u.
Je ferai remarquer que, fur les monumens, les franges
ne font pas toujours des galons frangés , ajoutés aux'
étoffes, comme les nôtres (les Barbares -exceptés), mais
que fouvent les bords mêmes des étoffes de laine font
effilés, & prolongés fous cette forme : auffi Nonius
dit-il (cap. Z3 n°. 318) : Fimbria funt omnis extrémités.
Cette observation, appliquée à l’affertion de Winckel*
mann , la rend moins générale & plus-vraifemblable.
Pièces d’applique ou tifïees avec l’étoffe pour imiter
les pièces d'applique.. Il eft fait fouvent mention, dans
les auteurs anciens, de pièces d’ étoffe appliquées fur uns
autre étoffe, en .forme d’ornçmens., ou de pièces d«
SECONDE PARTIE. $ 5
Ênême étoffe que le fon d, mais diverfement colorées.
La pourpre, les tiflus d’ or & d’ argent en fournifïoient la
£ a t 1ère ordinaire, & la tunique principalement en fut
chargée fous le Bâs-Empire, époque où la toge fut pref-
Qu’abandonnée. Ces ornemens reçurent différeils noms,
iuivanc leur forme, & félon qu’ils furent appliqués où
liifas âvêc l’étoffe. Dans le dernier cas on les appeloit
n.a?ut?!Î; & ils imitoient auffi la broderie 4 tel étoit le
Irtanteau léger & brillant que décrit Arifténète ( lib. 1 ,
irifi. 27) ;• telles les chauffes longues de RJiodogûne
dans fon portrait tracé par Philoftrate, & c .
| Lorfque ces pièces Rapplique étoient longues & droites
ou des bandes, on les appeloit Tra.guXvgyts. Si elles
étoient de pourpre, & fi elles defcendoient du col vers
les jambes , chez les Romains c’étoit lé clavus des lati-
claves & des angufticlaves. On les appela auffi paima &
valmus : toga palmata. lfidore (lib. 19, i l ) dit que les
méfiés IacuatA étoient ornées de pièces carrées-' ('-lacas
iuadratos )r, tiffues avec l’étoffe ou ajoutées avec l’aiguille,
c’eft-à-dire, brodées, Lacus t e 7txivêioi> étoient
Anonymes dans ce fens. Scutum défignoit une pièce1
fonde comme certains boucliers, & fcatulatu vefies lès
|Bêtemens qui en étoient ornés.
S Broderies, Les Orientaux brodoient à l’ aiguille leurs
«êtemens & les tapis de-Babylonie, fi célèbres- dans l’an-
tâquité. Lés. Egyptiens les imitèrent te les furpaffèrent.
On fit enfuite ces broderies au métier'; mais on ne peut
afligner l’époque de ce perfectionnement. Les Romains
défignoient une étoffe brodée à l’aiguille par les mots
acu picla, te pitta feulement. Sous le Bas-Empire, ce
|uxe fut porté à l’excès par les; Empereurs, les C o n fiés,
&c. On voit dans les Recueils de diptyques, des
Broderies reprefentant des plumes- : auffi appela-t-bn
èe riche travail plumarium opus, te lés broderies en or
jglum& ou vXxp.p.iàt, comme nous l ’apprend Procope ( de
Mdfijiis, lib. 3., cap -i ) . Je parlerai plus au long de la
broçerie lorfque je décrirai la toge des triomphateurs.
» E toffes a poil. Les Anciens fabriquoient pour
leurs vêtemens, pour- les couvertures des lits & des
tables, pour les ferviettes de table te de bain , tec. , des
Étoffes velues ou garnies de poils faits avec la même
matière' que le fond de l’étoffe ils en avoient de trois
fortes. Les unes étoient garnies de poils'fur les deux
feces : on les appeloit- amphïnudlum , du nom grec dé la
Line. Pline ( lio. 8, cap. 48 ) dit q u e , de fon tems, les
Romains commencèrent à en faire tifa-gé ; que-, du vivant
d® fon^père, ils avoient déjà adopté les étoffes velues
d’un coté , appelées gaufapa, dont on faifoit auffi ufage
dans les camps 3 il attribue cette double invention aux
Ipaulois. Peut-être le nom gaufapum venoit-il des Gaulois
1 Pllir, ____f . J ...... r . . . . j , n- . feis : auffi défigna-t-il quelquefois les deux fortes d’ étoffes '
«ont ]e viens de parler. On Je donna même, par ext
leur p3 'S ^ liS de hn qui n’ étoient garnis de poils qu'à
fion
feur extrémité, comme font placées ordinairement1 les
ipnges. Les Egyptiens eh fabriquoient de coton. Les
ps grecques du Capitole, du palais Barberini, te prefque
entes les Ifis, font enveloppées dans un manteau très-
orne 3 fur fes bords, d’éfpèee de franges ou plutôt
w longs poils tiffus avec l’étoffe.
.L • j IS‘ vêtemens. Je ne veux- point parler ici des plis
'vp*Lentj fpTpés par- le jet des draperies ou par le môu-
nt o différentes parties du corps. Je parle de plis
f i ï r T J ? f?rmés à deffein : tel fut le ou la
• e Pl'iiee des Perfes , que l’on retrouve dans les bas-
w s f Perfépoli-s^ « Chez les Anciens , dit Winckel-
FQiann( Hifi. c k lA h S-Iv. 4 3 chapvf> §. 30), on étoit*
» fort dans l’ufage de plier les habits & de fes mettre en
93 preffe, furtout après qu’ils avoient été lavés 3 ce qui
»» devoir fouvent avoir lieu dans les tems les plus rec-u-
33 lés de la G rèce, où les vêtemens des femmes étoient
» blancs. On trouve chez quelques écrivains, des paf-
>3 fages qui atteftent que les Anciens fe fervoient de
” preffes pour cet ufage ( tels, prclis fo lu u , Claudianus
»» Epithal. Pallad. verf. 101...... Sotutis prefforiis vefies
>3 nitentes, Ammian. Marcell. lib. 28, cap. 4. .... Veftis
” non mille pondehbus aut tormentis fplendere cooentibus
»» preffa : Seneca , de Tranquill. animi , cap. 1 , &c. ) . On
»3 n’en peut d’ailleurs douter, lï l’on fait attention aux
33 éminences ,&.aux cavités des raies qui fe remarquent
” fur les habillemens, te qui repréfentent les caffure-s,
>> des étoffés. Les ftatuaires de l’antiquité ont fouvent
33 indiqué ces caffures dans leurs draperies. Pour m o i,
331 je penfe que les raies des vêtemens, que les Romains
»3 nommoient rides, rug& ( Martial, lib. 3 , epigr. 93 ) ,
33 étoient de ces fortes de caffures, te non pas des plis
33 repaffés. On voit ces plis formant des carrés , par
l'eur rencontré, fur le manteau d’une ftatue de Melpo-
mene, dité lalunott du Capitole, placée dans le muféum'
Napoléon. Au refte, ,on' peut recomroître, dans lè texte
f de Sénèque, là calandre qui fert à preffer-& à luftrer lesv
draps , l’es' toiles & autres étoffés.
D’autres plis très-petits, très-ferrés, & conduits du
haut en bas, fe font remarquer fur la tunique retrouflée
des Dianes , fur la tunique tramante du prétendu Sarda-
napàle, tec. Ces plis rappellent ceux des fines toiles de
• co to n , telles que la mouffeline te d’autres de même
efpèce. Peut-être même étoient-ils formés à deffein ,
| comme les précédens.
Syn th è s is . On trouve ce mot employé par Tes jurife
confultes pour défigner un certain nombre de vêtemens.
On lés difpofoit par affemblage. Les vêtemens qui étoient
ifo lé s , étoient appelés fingulares te Je parlerai
ailleurs du vêtement qui. portoit fpéciâlement le non».
fynthefis.
D q ü b lu r e . Les habits des Anciens étoient-ils doublés
? Je h’ oferoîs prononcer négativement. Je dirai feu-*
lement i c i , qu’ayant examiné attentivement toutes; les
ftatues du mufée Napoléon , je'n’ ai apperçu aucune doublure
entière. A la vérité, quelques philologues ont
; rendu par le mot français doublée le mot èWa») te fembla-
! b lé s , dont fe fervent les écrivains grecs en parlant du.
manteau appelé , en latin Una ; mais jè ferai voir
ailleurs que ce mot défignoit l’ ampleur de ce manteau,
lorfqu’ il appartenoit à des gens riches. Julius Pollux
( Onomafi. lib. 7 , cap. i 3 ) dit que ces Una étoient appelées
è'tvxetit iïiwto'/là'as & ciîùXxs. Le dernier nom fignifie
qii’on les plioit eh deux avant de les jeter autour de foi.
Le fens du mot double, appliqué au manteau grec , fera
difeuté à l’article de ce vêtement.
N°. I II . Déjîgnation des vêtemens,
Les écrivains- anciens donnent fouvent le même nom
à la tunique, au manteau, à la chauffure, tec. des hommes
te à ceux des femmes. Cette identité de nom étoit
fondée fur l’identité d’es formes , car ces vêtemens
avoient ordinairement la même forme pour les deux
fexes ; ils ne différoient que par les proportions. Au
refte, nous retrouvons dans notre langue la même con-
fufion : chapeau, foulier, chemife, tec. appartiennent à
i ’îrômme te à la femme.
i Le mot eft dans ce cas. Pollux (pag. 339) dit