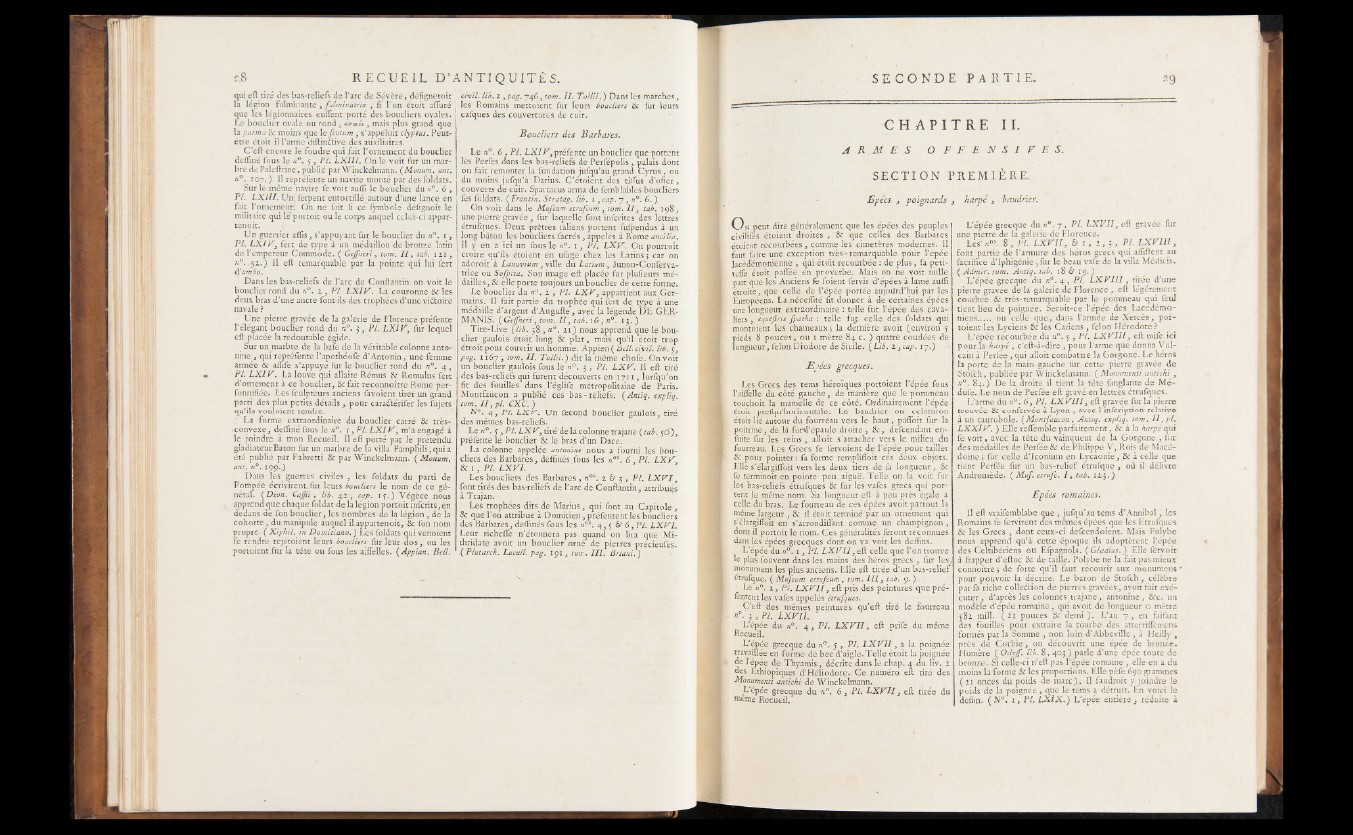
qui eft tiré des bas-reliefs de Tare de Sévère, défigneroit
la légion fulminante, fulminatrix , fi l'on étoit affûté ;
que les légionnaires euffent porté des boucliers ovales.
Le bouclier ovale ou rond, arzriss mais plus grand que
la parma & moins que le feutum 3 s’appeloit clypeus. Peut-
être étoit il l’arme diftinétive des auxiliaires.
C ’eft encore le foudre qui fait l’ ornement du bouclier
deffmé fous le «°. 11 PL LXIIÏ. On le voit fur un marbre
dePaleftrine, publié par Winckelmann. (Monum. ant.
n°. 207. ) Il repréfente un navire monté par des foldats.
Sur le même navire fe voit auflî le bouclier du n°. 6 ,
PI. L X l ll . Uni ferpent entortillé autour d’une lance en
fait l’ornement*: On ne' fait fi ce fymbole défignoit le
militaire qui lé5 portoit ou le corps auquel celui-ci appar-
tenoit.
Un guerrier affis, s’appuyant fur le bouclier du n°. 1 ,
PL LX IV 3 fert de type à un médaillon de bronzé latin
de l’empereur Commode. ( Gejfneri, tom. I I , tab.l i t 3
n°. .32.) 11 eft remarquable par la pointe qui lui fert
d'umbo.
Dans lés bas-reliefs de l ’arc de Conftantin on voit le
bouclier rond du n°. 2 3 PL LX 1V . La couronne & les
deux bras d’une ancre font-ils des trophées d’ une victoire
navale ?
Une pierre gravée de la galerie de Florence préfente
l’élégant bouclier rond du n°. 3 , PL LX1V3 fur lequel
eft placée la redoutable égide.
Sur un marbre de la bafe de la véritable colonne antonine,
qui repréfente l’apothéofe d’Antonin,-une femme
armée & affife s’appuye fur le bouclier rond du n°. 4 ,
PL LX 1V. La louve qui allaite Rémus & Romulus fert
d’ornement à ce bouclier, & fait reconnoître Rome per-
fonnifiée. Les fculpteurs anciens favoient tirer un grand
parti des plus petits détails, pour caraétérifer les fujets
qu’ ils vouloient rendre.
" La forme extraordinaire du bouclier carré & très-"
.convexe, deffmé fous le n°. 5 , PL L X IV 3 m’a engagé à
le joindre à mon Recueil. Il eft porté par le prétendu
gladiateur Bâton fur un marbre de la villa Pamphili, qui a
été publié par Fabretti & par Winckelmann. ( Monum.
ant. n°. 15)9.)
Dans les guerres civiles , les foldats du parti de
Pompée écrivirentJur leurs boucliers le nom de ce gênerai.
(Dion. Cajfîi, lib. 4 2 , cap. i f . ) Végèce nous
apprend que chaque foldat de la légion portoit infcrits,en
dedans de fon bouclier, les nombres de la légion, de la
cohorte, du manipule auquel ilappartenoit, & fon nom
propre. ( Xiphil. in Domitiano.') Les foldats quivenoient
fe rendre rejetoient leurs boucliers fur leur d o s , ou les
portoient fur la tête ou fous les aiffelles. ( Appian. Bell.
civil.lib. 1 , pag. 746 3 tom. II. To/lii.) Dans les marches,
les Romains mettoient fur leurs boucliers & fur leurs
cafques des couvertures de cuir.
Boucliers des Barbares.
Le n°. 6 3 PL LX IV 3 préfente un bouclier que portent
les Perfes dans les bas-reliefs de Perfépolis, palais dont
on fait remonter la fondation jufqu’au grand Cyrus , ou
du moins jufqu’à Darius. C ’etoient des tilïus d’ofier,
couverts de cuir. Spartacus arma de femblables boucliers
fes foldats. ( Frontin. Stratag. lib. 1 , cap. 7 , n°. 6. )
On voit dans le Mufeum etrufeum , tom. U 3 tab. 198,
une pierre gravée, fur laquelle font inferites des lettres
étrufques. Deux prêtres iàliens portent fufpendus à un
long bâton les boucliers facrés, appelés à Rome ancilia.
11 y en a ici un fous le n°. 1 , PL LX V . On pourroit
croire qu’ ils étoient en ufage chez les Latins 5 car on
adoroit à Lanuvium , ville du Latium, Junon-Conferva-
trice ou Sofpita. Son image eft placée fur plufieurs médailles,
& elle porte toujours un bouclier de cette forme.
Le bouclier du n°. 2 , PL L X P , appartient aux Germains.
11 fait partie du trophée qui fert de type à une
médaille d’ argent d’Augufte, avec la légende DE GER-
MANIS. (Gejfneri, tom. I I , tab. 16 , n°: 13 .)
Tite-Live (//£» 38 , n°. 21) nous apprend que le bouclier
gaulois étoit long & plat, mais qu’il étoit trop
étroit pour couvrir un homme. Appien ( Bell, civil, lib. y,
pag. 1 16 7 - tom. II. Tollii.) dit la même chofe. On voit
un bouclier gaulois fous le n°. 3 , PI. L X V . Il eft tiré
des bas-reliefs qui furent découverts en 1 7 1 1 , lorfqu’ on
fit des fouilles dans l’églife métropolitaine de Paris.
Montfaucon a publié ces bas-reliefs. (Antiq. expliq.
tom. I I 3 pi. CXC. )
N°. 4 , PL L X V . Un fécond bouclier gaulois, tiré
des mêmes bas-reliefs.
Le n°. y , PL L X V 3 tiré de là colonne trajane (tab. fô )3
préfente le bouclier & le bras d’ un Dace.
La colonne appelée antonine nous a fourni les boucliers
des Barbares , deffmés fous les nos. 6 , PL LX V .
& 1 , PL LX V I .
Les boucliers des Barbares , noS. 2 & 3 , Pl. L X V I ,
font tirés des bas-reliefs de l’ arc de Conftantin, attribués
à Trajan.
Les trophées dits de Marius, qui font au Capitole ,
& que l ’on attribue à Domitien, préfentent les boucliers
des Barbares, deffmés fous les nos. 4 , j & 6 3 Pl. LX V I.
Leur richeffe n’étonnera pas quand on lira que Mi-
thridate avoit Un bouclier orné de pierres precieufes.
( Plutarch. Lucull. pag. 1 9 1 tom. I II. Briani. )
CHAPITRE II.
A R M E S O F F E N S I V E S .
S E C T I O N P R EM I È R E .
Epées , poignards , harpe , baudrier.
O n peut dire généralement que les épées des peuples
civilifes étoient droites , & que celles des Barbares
étoient recourbées, comme les cimetères modernes. Il
faut faire une exception très - remarquable pour l’épée
lacédémonienne , qui étoit recourbée : de plus, fa peti-
teffe étoit paffée en proverbe. Mais on ne voit nulle
part que les Anciens fe foient fervis d’ épées à lame aufli
étroite, que celle de l’épée portée aujourd’hui par les
Européens. La néceffité fit donner à de certaines épées
une longueur extraordinaire : telle fut l’ épée des cavaliers
, equejlris fpatka : telle fut celle des foldats qui
montoient les chameaux; la dernière avoit (environ y
pieds 8 pouces, ou 1 mètre 84 c ..) quatre coudées de
longueur, félon Diodore de Sicile.- '(Lib. 2 , cap. 17.)
Epées grecques.
Les Grecs des tems héroïques portoient l’épée fous
l’aiffelle du coté gauche, de maniéré que Je pommeau
touchoit la mamelle de ce côté. Ordinairement l’épée-
étoit prefqu’horizontale. Le baudrier ou ceinturon
étoit lié autour du fourreau vers le haut, paffoit fur la
poitrine, de là fur^I’ épaule droite , & , defeendant en-
fuite fur les reins, alloit s’attacher vers le milieu du
fourreau. Les Grecs fe fervoient de l’épée pour tailler
& pour pointer : fa forme rempliffoit ces deux objets.
Elle s’ ëlargiffoit vers les deux tiers de fa longueur, &
fe terminoit en pointe peu, aiguë. Telle on la voit fur
les bas-reliefs étrufques & fur les vafes grecs qui portent
le même nom. Sa longueur eft à peu près égale à
celle du bras.. Le fourreau de ces épées avoit partout la
même largeur , & il étoit terminé par un ornement qui
s’élargiffoit en s’arrondiffant comme un champignon,
dont il portoit le nom. Ces généralités feront reconnues
dans les épées grecques dont ou va voir les deffins.
L’épée du n°. 1 , Pl. L X V 11, eft: celle que l’on trouve
le plus fouvent dans les mains des héros grecs , fur les/
mbnumens les plus anciens.-Elle.eft tirée d’ un bas-relief
étrufque..( Mufeum etrufeum, tom. I I I , tab. 9. ) .
Le n°. 2, PL L X V I I , eft pris des peintures que préfentent
les vafes appelés étrufques.
C’eft des mêmes peintures qu’eft tiré le fourreau
n° • 3 , PL LX V II.
L?éj>ée du n°.. 4 , P l. L X V I I 3 eft prife du même
Recueil.
L’épée grecque du n°. y , Pl. L X V I I , a la poignée
travaillée en forme de bec d’aigle. Telle étoit la poignée
de l’épée de Thyamis, décrite dans le chap. 4 du liv. 2
des Ethiopiques d’Héliodore. C e numéro eft tiré des
Monumenti antiçhi de Winckelmann.
L'épée grecque du n°. 6 3 PL L X V H 3 eft tirée du
fâeme Recueil.
L’épée grecque du n°. 7 , PL L X V I I , eft gravée fur
une pierre de la galerie de Florence.
Les' n ° l 8 , PL L X V I I , & 1 , 2 , 3 , PL L X V 1I I ,
font partie de l’armure des héros grecs qui afliftent au
facrifice d’ Iphigénie, fur le beau vafe de la villa Médicis.
(Admir. rom. Antiq. tab. 18 & 19. ) •
L ’épée grecque du n°. 4 , PL L X V I I I , tirée d’une
pierre gravée de la galerie de Florence , eft légèrement
courbée & très-remarquable par le pommeau qui feul
tient lieu de poignée. Seroit-ce l’épee des Lacédémoniens..^.,
ou celle que, dans l’armée de Xercès, portoient
les Lyciens & les Cariens , félon Hérodote ?
L’épée recourbée du n°. 5 , PL LX V I I I , eft mife ici
pour la harpe , c ’eft-à-dire, pour l ’arme que donna Vul-
cain à Perfée, qui alloit combattre la Gorgone. Le héros
la porte de la main gauche fur cette pierre gravée de
Stofch, publiée par Winckelmann. ( Monumenti antichi ,
«°. 84.) De la droite il tient la tête fanglante de Mé-
dufe. Le nom de Perfée eft gravé-en lettres étrufques.
L’ arme du n°. 6 , PL L X V I I I , eft gravée fur la pierre
trouvée & confervée à Lyon, avec l’infeription relative
à un taurobole. (Montfaucon, Antiq. expliq. tom. I l 3pl.
L X X IV . ) Elle reffemble parfaitement, & à la harpe qui
fe v o it , avec la tête du vainqueur de la Gorgone , fur
des médailles de Perfée & de Philippe V , Rois de Macédoine
; fur celle d’Iconium en Lycaonie, & à celle que
tient Perfée fur un bas-relief étrufque , où il délivre
Andromède. (M u ß etrufe. / , tab.. 123.)
Epées romaines.
Il eft vraifemblabe q u e , jufqu’ au tems d’ Annibal, les
Romains fe fervirent dés mêmes épées que les Etrufques
& les Grecs , dont ceux-ci defeendoient. Mais Polybe
nous apprend qu’ à cette époque ils adoptèrent l’épée
des Geltibériens ou Efpagnojs. (Gladius.) Elle fervoit
à frapper d’ eftoc & de taille. Polybe ne la fait pas mieux
connoître ; de forte qu’il faut recourir aux monumens
pour pouvoir la décrire. Le baron de Stofch, célèbre
par fa riche eolleétion de pierres gravées, avoit fait exécuter
, d’après les colonnes trajane, antonine, & c . un
modèle d’ épée romaine, qui avoit de longueur o mètre
y 82 mill. ( 21 pouces & d em i) . L’ an 7 , en faifant
des fouilles pour extraire la tourbe des atterriffemens
formés par la Somme , non loin d’Abbeville, à Heilly ,
près de C o rb ie , on découvrit une épée de bronze.
Homère ( Odyjf. lib. 8,403 ) parle d’une épée toute de
bronze. Si ceÜe-ci n’eft pas l’epée romaine, elle en a du
moins la forme & les proportions. Elle pèfe 690 grammes
(2 1 onces du poids de- marc). Il fauaroit y joindre le
poids de la poignée, que le tems a détruit. En voici le
deflin. ( N°. 1 , P l .L X lX . ) L’épée entière, réduite à