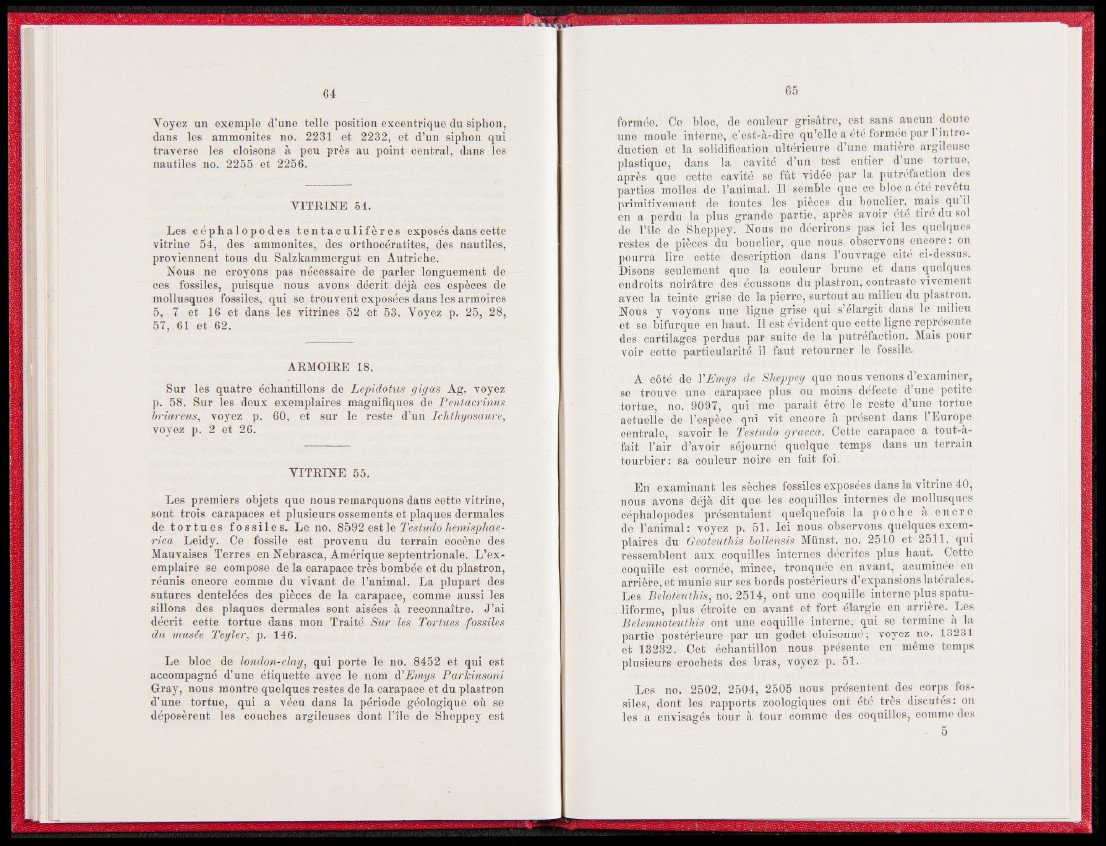
Voyez un exemple d’une telle position excentrique du siphon,
dans les ammonites no. 2231 et 2232, et d’un siphon qui
traverse les cloisons à peu près au point central, dans les
nautiles no. 2255 et 2256.
VITRINE 54.
Les c é phal opodes t e n t a c u l i f è r e s exposés dans cette
vitrine 54, des ammonites, des orthocératites, des nautiles,
proviennent tous du Salzkammergut en Autriche.
Nous ne croyons pas nécessaire de parler longuement de
ces fossiles, puisque nous avons décrit déjà ces espèces de
mollusques fossiles, qui se trouvent exposées dans les armoires
5, 7 et 16 et dans les vitrines 52 et 53. Voyez p. 25, 28,
57, 61 et 62.
ARMOIRE 18.
Sur les quatre échantillons de Lepidotus gigas Ag. voyez
p. 58. Sur les deux exemplaires magnifiques de Pentacrinus
briareus, voyez p. 60, et sur le reste d’un Ichthyosaure,
voyez p. 2 et 26.
VITRINE 55.
Les premiers objets que nous remarquons dans cette vitrine,
sont trois carapaces et plusieurs ossements et plaques dermales
de t o r t u e s fossi les. Le no. 8592 est 1 e Testudo hemisphae-
rica Leidy. Ce fossile est provenu du terrain eocène des
Mauvaises Terres en Nebrasca, Amérique septentrionale. L’exemplaire
se compose de la carapace très bombée et du plastron,
réunis encore comme du vivant de l’animal. La plupart des
sutures dentelées des pièces de la carapace, comme aussi les
sillons des plaques dermales sont aisées à reconnaître. J ’ai
décrit cette tortue dans mon Traité Sur les Tortues fossiles
du musée Teyler, p. 146.
Le bloc de london-clay, qui porte le no. 8452 et qui est
accompagné d’une étiquette avec le nom à’Emys Parkinsoni
Gray, nous montre quelques restes de la carapace et du plastron
d’une tortue, qui a vécu dans la période géologique où se
déposèrent les couches argileuses dont l’île de Sheppey est
formée. Ce bloc, de couleur grisâtre, est sans aucun doute
une moule interne, c’est-à-dire qu’elle a été formée par 1 introduction
et la solidification ultérieure d’une matière argileuse
plastique, dans la cavité d’un test entier d’une tortue,
après que cette cavité se fût vidée par la putréfaction des
parties molles de l’animal. Il semble que ce bloc a été revêtu
primitivement de toutes les pièces du bouclier, mais qu il
en a perdu la plus grande partie, apres avoir ete tire du sol
de l’île de Sheppey. Nous ne décrirons pas ici les quelques
restes de pièces du bouclier, que nous observons encore : on
pourra lire cette description dans l’ouvrage cité ci-dessus.
Disons seulement que la couleur brune et dans quelques
endroits noirâtre des écussons du plastron, contraste vivement
avec la teinte grise de la pierre, surtout au milieu du plastron.
Nous y voyons une ligne grise qui s’élargit dans le milieu
et se bifurque en haut. Il est évident que cette ligne représente
des cartilages perdus par suite de la putréfaction. Mais pour
voir cette particularité il faut retourner le fossile.
A côté de VEmys de Sheppey que nous venons d’examiner,
se trouve une carapace plus ou moins defecte d une petite
tortue, no. 9097, qui me paraît être le reste d’une tortue
actuelle de l’espèce qui vit encore à présent dans 1 Europe
centrale, savoir le Testudo graeca. Cette carapace a tout-a-
fait l’air d’avoir séjourné quelque temps dans un terrain
tourbier: sa couleur noire en fait foi,
En examinant les sèches fossiles exposees dans la vitrine 40,
nous avons déjà dit que les coquilles internes de mollusques
céphalopodes présentaient quelquefois la poche à encre
de l’animal: voyez p. 51. Ici nous observons quelques exemplaires
du Geoteuthis hollensis Münst. no. 2510 et 2511, qui
ressemblent aux coquilles internes décrites plus haut. Cette
coquille est cornée, mince, tronquée en avant, acuminee en
arrière, et munie sur ses bords postérieurs d’expansions latérales.
Les Beloteuthis, no. 2514, ont une coquille interne plus spatu-
liforme, plus étroite en avant et fort élargie en arriéré. Les
Belemnoteuthis ont une coquille interne, qui se termine à la
partie postérieure par un godet cloisonné; voyez no. 13231
et 13232. Cet échantillon nous présente en même temps
plusieurs crochets des bras, voyez p. 51.
Les no. 2502, 2504, 2505 nous présentent des corps fossiles,
dont les rapports zoologiques ont été très discutés: on
les a envisagés tour à tour comme des coquilles, comme des