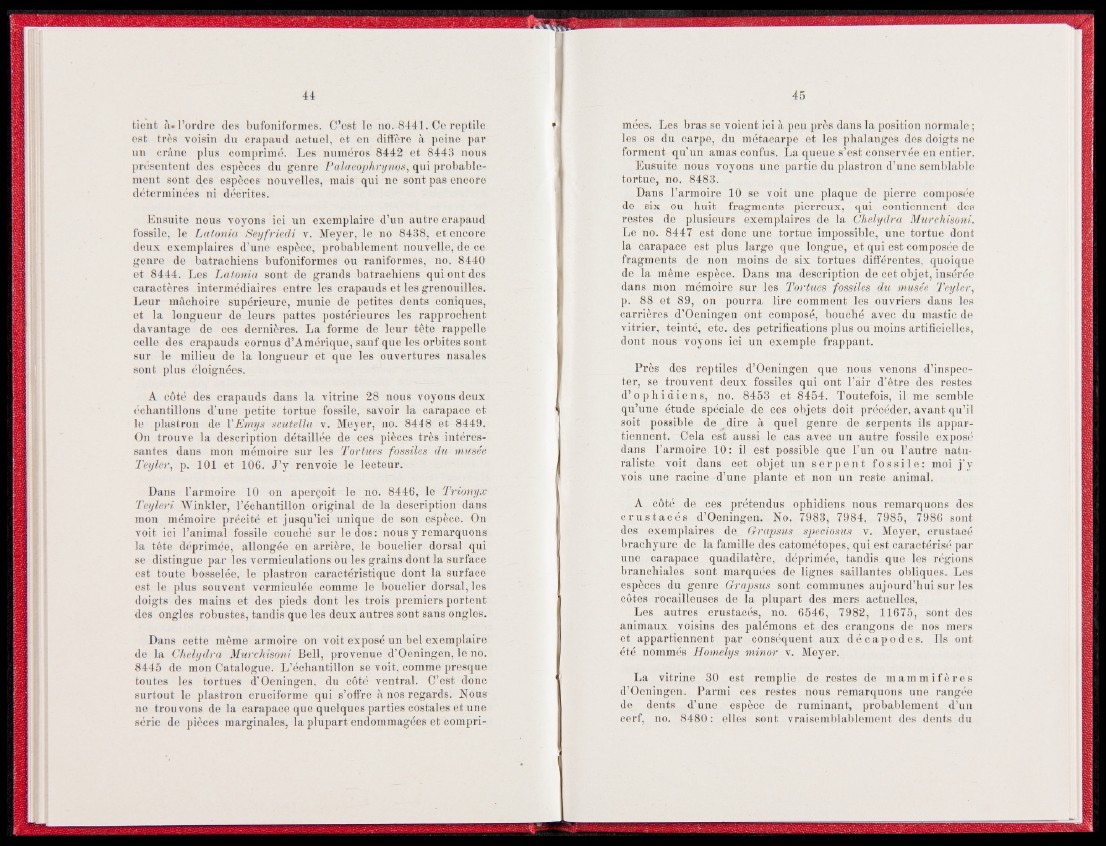
tient à. l’ordre des bufoniformes. C’est le no. 8441. Ce reptile
es t très y oisin du crapaud actuel, et en diffère à peine par
un crâne plus comprimé. Les numéros 8442 et 8443 nous
présentent des espèces du genre Palaeophrynos, qui probablement
sont des espèces nouvelles, mais qui ne sont pas encore
déterminées ni décrites.
Ensuite nous voyons ici un exemplaire d’un autre crapaud
fossile, le Lcitonia Seyfriedi v. Meyer, le no 8438, et encore
deux exemplaires d’une espèce, probablement nouvelle, de ce
genre de batrachiens bufoniformes ou raniformes, no. 8440
et 8444. Les Latonia sont de grands batrachiens qui ont des
caractères intermédiaires entre les crapauds et les grenouilles.
Leur mâchoire supérieure, munie de petites dents coniques,
et la longueur de leurs pattes postérieures les rapprochent
davantage de ces dernières. La forme de leur tête rappelle
celle des crapauds cornus d’Amérique, sauf que les orbites sont
sur le milieu de la longueur et que les ouvertures nasales
sont plus éloignées.
A côté des crapauds dans la vitrine 28 nous voyons deux
échantillons d’une petite tortue fossile, savoir la carapace et
le plastron de YEmys scutella v. Meyer, no. 8448 et 8449.
On trouve la description détaillée de ces pièces très intéressantes
dans mon mémoire sur les Tortues fossiles du musée
Teyler, p. 101 et 106. J ’y renvoie le lecteur.
Dans l’armoire 10 on aperçoit le no. 8446, le Trionyx
Teyleri Winkler, l’échantillon original de la description dans
mon mémoire précité et jusqu’ici unique de son espèce. On
voit ici l’animal fossile couché sur le dos: nous y remarquons
la tête déprimée, allongée en arrière, le bouclier dorsal qui
se distingue par les vermiculations ou les grains dont la surface
est toute bosselée, le plastron caractéristique dont la surface
est le plus souvent vermiculée comme le bouclier dorsal, les
doigts des mains et des pieds dont les trois premiers portent
des ongles robustes, tandis que les deux autres sont sans ongles.
Dans cette même armoire on voit exposé un bel exemplaire
de la Chelydra Murchisoni Bell, provenue d’Oeningen, le no.
8445 de mon Catalogue. L’échantillon se voit, comme presque
toutes les tortues d’Oeningen, du côté ventral. C’est donc
surtout le plastron cruciforme qui s’offre à nos regards. Nous
ne trouvons de la carapace que quelques parties costales et une
série de pièces marginales, la plupart endommagées et comprimées.
Les bras se voient ici à peu près dans la position normale ;
les os du carpe, du métacarpe et les phalanges des doigts ne
forment qu’un amas confus. La queue s’est conservée en entier.
Eusuite nous voyons une partie du plastron d’une semblable
tortue, no. 8483.
Dans l’armoire 10 se voit une plaque de pierre composée
de six ou huit fragments pierreux, qui contiennent des
restes de plusieurs exemplaires de la Chelydra Murchisoni.
Le no. 8447 est donc une tortue impossible, une tortue dont
la carapace est plus large que longue, et qui est composée de
fragments de non moins de six tortues différentes, quoique
de la même espèce. Dans ma description de cet objet, insérée
dans mon mémoire sur les Tortues fossiles du musée Teyler,
p. 88 et 89, on pourra lire comment les ouvriers dans les
carrières d’Oeningen ont composé, bouché avec du mastic de
vitrier, teinté, etc. des pétrifications plus ou moins artificielles,
dont nous voyons ici un exemple frappant.
Près des reptiles d’Oeningen que nous venons d’inspecter,
se trouvent deux fossiles qui ont l’air d’être des restes
d’ophidiens, no. 8453 et 8454. Toutefois, il me semble
qu’une étude spéciale de ces objets doit précéder, avant qu’il
soit possible de .dire à quel genre de serpents ils appartiennent.
Cela est aussi le cas avec un autre fossile exposé
dans l’armoire 10: il est possible que l’un ou l’autre naturaliste
voit dans cet objet un s e r p en t fossi le: moi j’v
vois une racine d’une plante et non un reste animal.
A côté de ces prétendus ophidiens nous remarquons des
crus tacés d’Oeningen. No. 7983, 7984, 7985, 7986 sont
des exemplaires de. Grapsus speciosus v. Meyer, crustacé
brachyure de la famille des catométopes, qui est caractérisé par
une carapace quadilatère, déprimée, tandis que les régions
branchiales sont marquées de lignes saillantes obliques. Les
espèces du genre Grapsus sont communes aujourd’hui sur les
côtes rocailleuses de la plupart des mers actuelles,
Les autres crustacés, no. 6546, 7982, 11675, sont des
animaux voisins des palémons et des crangons de nos mers
et appartiennent par conséquent aux décapodes. Ils ont
été nommés Homelys minor v. Meyer.
La vitrine 30 est remplie de restes de mammi fères
d’Oeningen. Parmi ces restes nous remarquons une rangée
de dents d’une espèce de ruminant, probablement d’un
cerf, no. 8480 : elles sont vraisemblablement des dents du