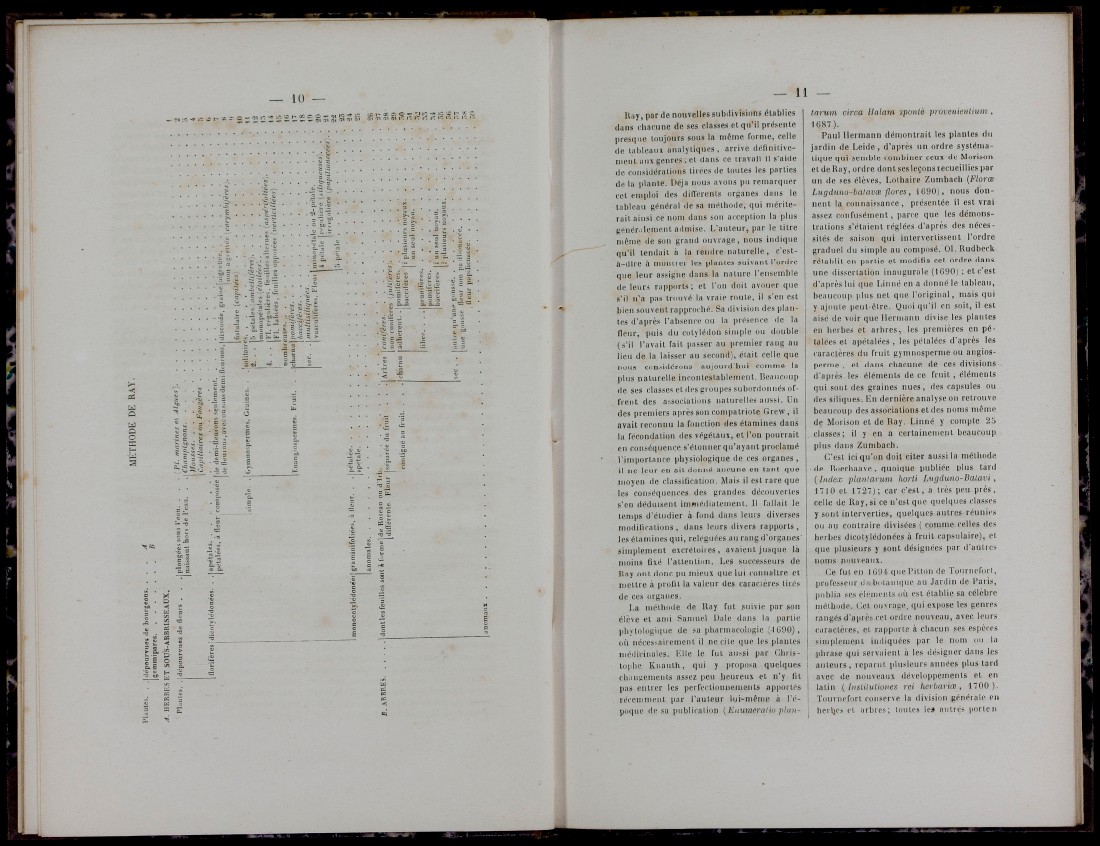
cc
w
Q
til
Q
O
1 0 —
^ :c ^ ^ X - o - ^ 'a î; « ^ I; ;; g ^ 5^1r : 'iλ- oCc?i c^ iCo J^ 1 Itto ic iciO i cc ci cI -i c" jei ':r .
s
O
V
a fl
• • - S
•so
i l
• t £
• —Î10 —.- 5 (A
. 5 • o3 ou >
S ' ? 2-s 2S: ^C i.o j ^
a
c o
a ^
o o
S w
Jo-- Sf l
c X
o
0) •
*
QO < V}
U .
3 3
A O • ¿ 1
u cc CO a>
t 5 . as TJ v>
S ^
< 1
3 «
P
t> •>s
u
1 S O
3
o
a S
C/2 a
"U o
-t3 HD H
U
v :
•CJ
T5
cc O)
ti «5 Bî C
w
.-3
a
>2
n
3«
c: = .1 o
S 5 rus; ayz
• V-0 -1O)
« 4«J
CnL C-«u
. ^ « o
• -^ o i 3-
• 5 «1 « «
? ii «
• 0«1 5^Q J ~ • -
• Cd.
o .
(^U ;0 £ E —
• • •
• VA ^
. • s
a
• .,1-g-
. U
.• a ^ - a j
3 -c an
. o bb^
a
C- .-î
. . <a .
2 o -i! o
C O 3 w>
2 O C c 3 <D ^
lb
ûO
w
a (u il 'Oai sc-3u
X
3 .
>-> -
i(f-t _c__
5 "=0) i3/l U3
"E. 3
W
• - ¿ sO ^C 3 • • «cfl cu^ja—
• ^ •
• C = •J a ) . uO co -na
X3 - Î3
i r
o s Ϋ
Ol
3 —
1) «
S= C OV
Uo - OQ -j.-a3
c ^
s
g 5
3
0J5
^ «
t
c
3
«5 3 !U -
1; ^
J<: rj
aa . •dj
5 g
a;
I J
3
CO
<tuf l (yc
a>
£
u
C/2
Lâ
CcnC cc
3
3
C3
&0
M
Kay, par de nouvelles subdivisions élabiies
dans chacune de ses classes el qu' i l présente
presque toujours sous la même forme, celle
d e tableaux analytiques, arrive définitivemeut
aux genres, et dans ce travail il s'aide
d e cousidératious tirées de toutes les parties
d e la plante. Déjà iu)us avons pu remarquer
cet emploi des dillerenls organes dans le
t a b l e a u général de sa méthode, qui mériter
a i t aiusi ce nom dans son acception la plus
f^enér.ilement admise. L'auteur, par le titre
même de son grand ouvrage, nous indique
q u ' i l tendait à la rendre naturelle, c'està
- d i r e à montrer les plantes suivant Tordre
que leur assigne dans la nature l'ensemble
d e leurs rapports; et l'on doit avouer que
s'il n'a pas Irituvé la vraie route, il s'en est
bien souvent rapproché. Sa division des plantes
d'après l'absence ou la présence de la
fleur, puis du cotylédon simple ou double
( s ' i l l'avait fait passer au premier rang au
lieu de la laisser au second), était celle que
nous considérons aujourd'hui comme la
|)lus naturel l e incontestablement. Beaucoup
île ses classes et des groupes subordonnés of-
IVeut des associations naturelles avrssi. Un
des premiers après son compatriot e Grew, il
avait reconnu la fonction des étamines dans
la fécondation des végétaux, et l'on pourrait
en conséquence s'étonner qu'ayant proclamé
i ' i m p o r t a n c e physiologique de ces organes,
il ne leur en ait donné aucune en tant que
moyen de classification. Mais il est rare que
les conséquences des grandes découvertes
s ' en déduisent immédiatement. Il fallait le
temps d'étudier à fond dans leurs diverses
m o d i i i c a t i o n s , dans leurs divers rapports,
les é tamines qui , reléguées aii rang d'organes"
s i m p l e m e n t excrétoires, avaient jusque là
moins fixé l'attention. Les successeurs de
Ray ont donc pu mieux qu€ lui connaître et.
m e t t r e à profit la valeur des caractères tirés
d e ces organes.
J.a méthode de Ray fut suivie par son
élève et ami Sanuiel Dale dans la partie
p h y t o l o g i q u e de sa pharmacologie (^1690),
o ù nécessairement il ne cite que les plantes
médivinales. Elle le fut aussi par Christophe
Knauth, qui y proposa quelques
c h a n g e m e n t s assez peu heureux et n'y fit
pas entrer les perfectionnements apportés
r é c e m m e n t par l'auteur lui-même à l'époque
de sa i)ublicaiion {Enuinerado plantarum
circa IJalarn spontè provenienlium ,
1 6 8 7 ) .
Paul Hermann démontrait les plantes du
j a r d i n de Leide, d'après un ordre systémat
i q u e qui semble combiner ceux de Morison
et de Ray, o rdr e dont ses leçons recueillies par
u n de ses élèves, Lolhaire Zumbach {Floroe
Lugduno-balavoe flores, 1690), nous donn
e n t la connaissance, présentée il est vrai
assez confusément, parce que les démonst
r a t i o n s s'étaient réglées d'après des nécessités
de saison qui intervertissent l'ordre
graduel du simple au composé. 01. Rudbeck
r é t a b l i t eu partie et modifia cet ordre dans
u n e dissertation inaugurale (1690) ; et c'est
d ' a p r è s lui que Linné en a donné le tableau,
beaucoup plus net que l'original, mais qui
y a jout e peut-être. Quoi qu'il en soit, il est
aisé de voir que Hermann divise les plantes
en herbes et arbres, les premières en pétalées
et apétalées, les pétalées d'après les
caractères du fruit gymnosperme ou angiosperme
, et dans chacune de ces divisions
d ' a p r è s les éléments de ce fruit, éléments
qui sont des graines nues, des capsules ou
des siliques. En dernière analyse on retrouve
beaucoup des associations et des noms même
de Morison et de Ray. Linné y compte 25
classes; il y en a certainement beaucoup
plus dans Zumbach,
C'est ici qu'on doit citer aussi la méthode
• d e Boerhaave, quoique publiée plus tard
{Index planlarum horti Lugduno-Baiavi,
17 10 et 1727); car c'est, à très peu près,
celle de Ray, si ce n'est que quelques classes
y sont interverties, quelques autres réunies
ou au contraire divisées ( c omme celles des
herbes dicotylédonées à fruit capsulaire), et
que plusieurs y sont désignées par d'autres
noms nouveaux.
Ce fut en i 6 9 4 que Pitton de Tournefort,
professeur di'uhotanique au Jardin de Paris,
publia ses élément s où est établie sa célèbre
méthode. Cet ouvrage, qui expose les genres
rangés d'après cet ordre nouveau, avec leurs
c a r a c t è r e s , et rapporte à chacun ses espères
simplenieiit indiquées par le nom ou la
phrase qui servaient à les désigner dans les
a u t e u r s , reparut plusieurs années plus tard
avec de nouveaux développements el en
l a t in { înstU'uliones rei herbarioe, 1700 ).
T t u i r n e f o r l conserve la division générale en
hevljcs et arbres; toutes les autres porten