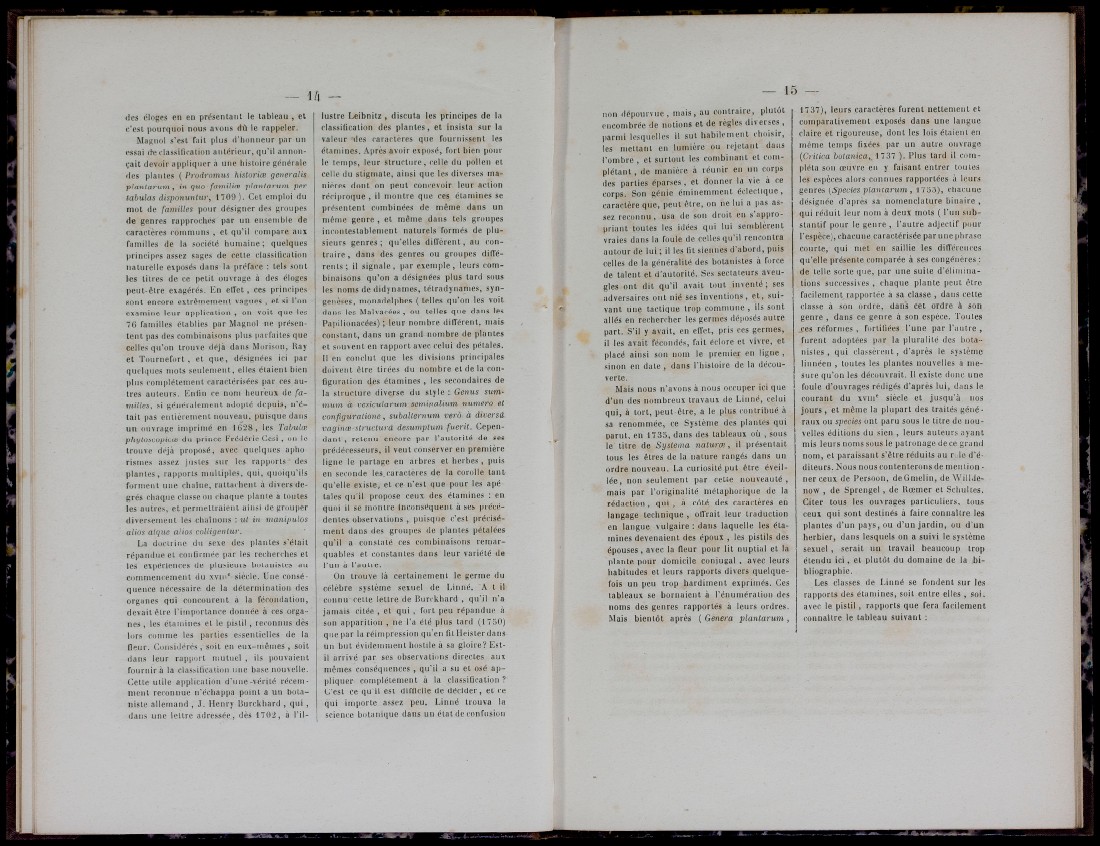
— ih - 1 5
(les éloges en en présentant le tableau, et
c'est pourquoi nous avons dû le rappeler.
Magnol s'est fait plus <i'lionneur par un
essai de classification antérieur, qu'il atinonçait
devoir appliquer à une histoire générale
des plantes { Prodromus historioe generalis
planlariitn, in quo farnilioe plmUarutn per
tabulas dispoyninlur, 1709 ). Cet emploi du
mot de familles; pour désigner des groupes
de genres rapprochés par un ensemble de
caractères communs , et qu'il compare aux
familles de la société tiumaiiie; quelques
principes assez sages de cette classification
naturelle exposés dans la préface : tels sont
les titres de ce petit ouvrage à des éloges
p e u t - ê t r e exagérés. En elï'et , ces principes
sont encore extrêmement vagues , et si Ton
examine leur ai)plication , on voit que les
76 familles établies par Magnol ne présentent
pas des combinaisons plus parfaites que
celles qu'on trouve déjà dans Morison, Ray
et Tournefort, et que, désignées ici par
quelques mots seulement, elles étaient bien
plus complètement caractérisées par ces autres
auteurs. Enfin ce nom heureux de familles,
si généralement adopté depuis, n'était
pas entièrement nouveau, puisque dans
u n ouvrage imprimé en 1628, les Tabuloe
phytoscopicoe du prince Frédéric Cesi, on le
trouve déjà proposé, avec quelques aphorismes
assez justes sur les rapports des
p l a n t e s , rapports multiples, qui, quoiqu'ils
forment une chaîne, rattachent à divers degrés
chaque classe ou chaque planie à toutes
les autres, et permettraient ainsi de grouper
diversement les chaînons : ut in manipulas
alios a(quG alios colligenlur,
La doctriiie du sexe des plantes s'élait
répandue et confirmée par les recherches et
les exitériences de plusieurs botanistes au
commencement du xvin® siècle. Une conséquence
nécessaire de la détermination des
organes qui concourent à la fécondation,
devait être l'importance donnée à ces organes
, les étarnines et le pistil , reconnus dès
lors comme les parties essentielles de la
fleur. Considérés, soit en eux-mêines , soit
dans leur rapport uiutuel , ils pouvaient
f o u r n i r a la classificaiion une base nouvelle.
Cette utile application d'une-vérité récem -
ment reconnue n'échappa point à un botaniste
allemand , J. Henry Uurckhard , qui ,
dans une lettre adressée, dès 1702, à l'illustre
Leibnitz, discuta les principes de la
classification des plantes, et insista sur la
valeur des caractères que fournissent les
étarnines. Après avoir exposé, fort bien pour
le temps, leur structure, celle du pollen et
celle du stigmate, ainsi que les diverses manières
dont on peut concevoir leur action
réciproque , il montre que ces étarnines se
présentent combinées de même dans un
même genre , et même dans tels groupes
incontestablement naturels formés de plusieurs
genres; qu'elles diffèrent, au cont
r a i r e , dans des genres ou groupes ditîér
e n t s ; il signale, par exemple, leurs combinaisons
qu'on a désignées plus tard sous
les noms de didynames, tétradynames, syngeiièses,
monadelphes ( telles qu'on les voit
dans les Malvacées, ou telles que dans les
Pai)ilionacées) ; leur nombre diiTérent, mais
constant, dans un grand nombre de plantes
et souvent en rapport avec celui des pétales.
Il en conclut que les divisions principales
doivent être tirées du nombre et de la configuration
des étamines , les secondaires de
la structure diverse du style : Genus summum
à vesicularum semiiialium numero et
configuraiione, suballernum vero- à diversâ
vaginoe-structuré desuniptum faerit. Cependant
, retenu encore par l'autorité de ses
prédécesseurs, il veut conserver en première
ligne le partage en arbres et herbes, puis
en seconde les.caractères de la corolle tant
qu'elle existe, et ce n'est que pour les apétales
qu'il propose ceux des étamines : en
quoi il se montre inconséquent à ses précédentes
observations , puisque c'est précisément
dans des groupes de plantes pétalées
qu'il a constaté ces combinaisons remarquables
et constantes dans leur variété de
l ' un à l'autre.
On trouve là certainement le germe du
célèbre système sexuel de Linné. A t il
connu cette lettre de Burckhard , qu'il n'a
jamais citée , et qui , fort peu répandue à
son apparition , ne Ta été plus tard (1750)
que par la réimpression qu'en fitHeister dans
un but évidemment hostile à sa gloire? Estil
arrivé par ses observations directes aux
mêmes conséquences , qu'il a su et osé appliquer
complètement à la classification?
C'est ce qu'il est difficile de décider, et ce
qui importe assez peu. Linné trouva la
science botanique dans un état de confusion
non dépourvue, mais, au contraire, plutôt
encombrée de notions et de règles diverses,
parmi lesquelles il sut habilement choisir,
les mettant en lumière ou rejetant dans
l'ombre , et surtout les combinant et comp
l é t a n t , de manière à réunir en un corps
des parties éparses, et donner la vie à ce
corps. Son génie éminemment éclectique,
caractère que, peut être, on ne lui a pas assez
reconnu, usa de son droit en s'appropriant
toutes les idées qui lui semblèrent
vraies dans la foule de celles qu'il rencontra
autour de lui ; il les fit siennes d'abord, puis
celles de la généralité des botanistes à force
de talent et d'autorité. Ses sectateurs aveugles
ont dit qu'il avait tout inventé; ses
adversaires ont nié ses inventions, et, suivant
une tactique trop commune , ils sont
allés en rechercher les germes déposés autre
part. S'il y avait, en ell'et, pris ces germes,
il les avait fécondés, fait éclore et vivre, et
placé ainsi son nom le premier en ligne ,
sinon en date, dans l'hisloii'e de la découverte.
Mais nous n'avons à nous occuper ici que
d'un des nombreux travaux de Linné, celui
qui, à tort, peut-être, a le plus contribué à
sa renommée, ce Système des plantes qui
parut, en 1735, dans des tableaux où , sous
le litre de Systema naturoe, il présentait
tous les êtres de la nature rangés dans un
ordre nouveau. La curiosité put être éveillée,
non seulement par ceue nouveauté,
mais par l'originalité métaphorique de la
rédaction, qui, à côté des caractères en
langage technique , oH'rait leur traduction
en langue vulgaire: dans laquelle les étamines
devenaient des époux , les pistils des
épouses, avec la fleur pour lit nuptial et la
plante pour domicile conjugal , avec leurs
habitudes et leurs rapports divers quelquefois
un peu trop hardiment exprimés. Ces
tableaux se bornaient à l'énumération des
noms des genres rapportés à leurs ordres.
Mais bientôt après ( Genera plantarum ,
17 37), leurs caractères furent nettement et
comparativement exposés dans une langue
claire et rigoureuse, dont les lois étaient en
même temps fixées par un autre ouvrage
{Criiica bolanica,, 1737 ). Plus tard il compléta
son oeuvre eu y faisant entrer toutes
les espèces alors connues rapportées à leurs
genres [Species plantarum, 1753), chacune
désignée d'après sa nomenclature binaire ,
qui réduit leur nom à deux mots ( l 'un substantif
pour le genre , l'autre adjectif pour
l'espèce), chacune caractérisée par une phrase
courte, qui met en saillie les dilïerences
qu'elle présente comparée à ses congénères :
de telle sorte que, par une suite d'éliminations
successives , chaque plante peut être
facilement rapportée à sa classe , dans cette
classe à son ordre, dans cet ordre a son
genre , dans ce genre à son espèce. Toutes
ces réformes, fortifiées l'une par l'autre ,
furent adoptées par la pluralité des botanistes
, qui classèrent, d'après le système
linnéen , toutes les plantes nouvelles à mesure
qu'on les découvrait. Il existe donc une
foule d'ouvrages rédigés d'après lui, dans le
courant du xvni® siècle et jusqu'à nos
j o u r s , et même la plupart des traités généraux
ou species ont paru sous le titre de nouvelles
éditions du sien , leurs auteurs ayant
mis leurs noms sous le patronage de ce grand
nom, et paraissant s'être réduits au r. le d'éditeurs.
Nous nous contenterons de ment ion -
ner ceux de Persoon, deGmelin, de Willdenow
, de Sprengel , de Roemer et Schultes.
Citer tous les ouvrages particuliers, tous
ceux qui sont destinés à faire connaître les
plantes d'un pays, ou d'un jardin, ou d'un
herbier, dans lesquels on a suivi le système
sexuel , serait un travail beaucoup trop
étendu ici, et plutôt du domaine de la ¡bibliographie.
Les classes de Linné se fondent sur les
rapports des étamines, soit entre elles , soio
avec le pistil, rapports que fera facilement
connaître le tableau suivant :