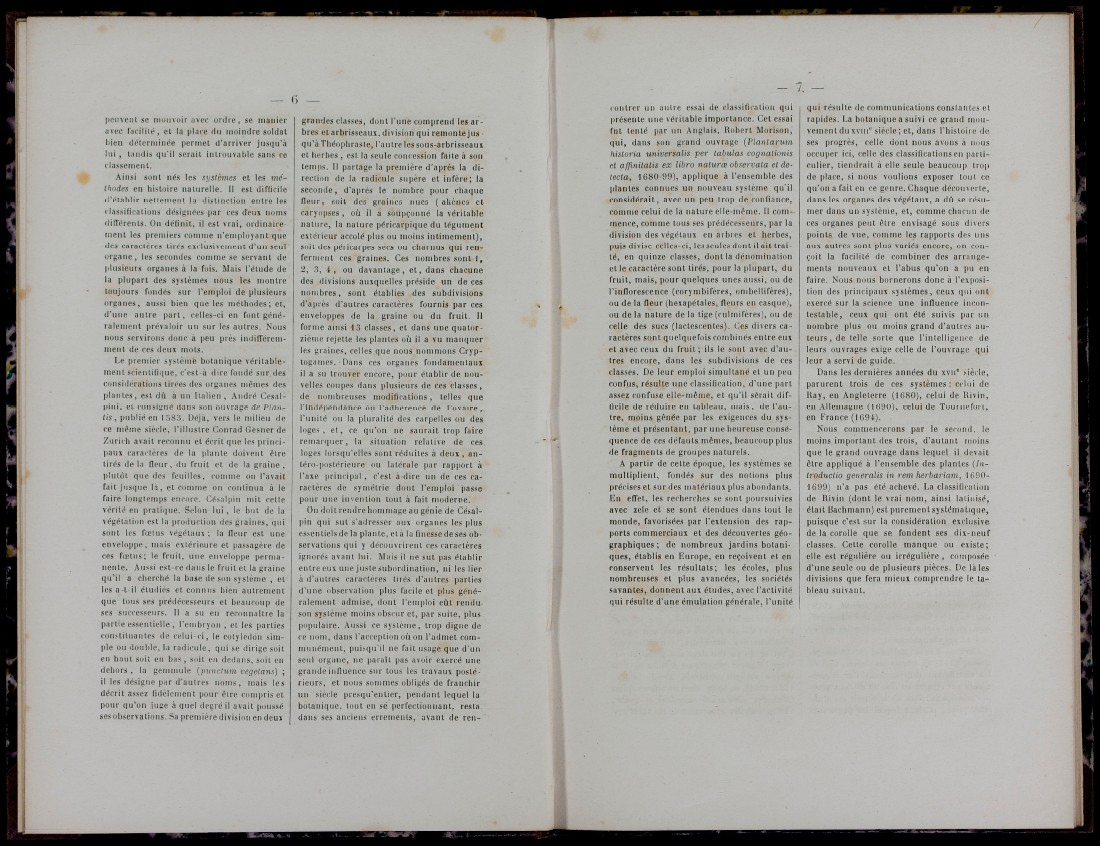
L
pciîveiit se niDuvoir iivec ordre, se inaiiier
iivec facililé, et la place (iii moindre soldai
l)ien déterminée permet d'arriver jusqu'à
lui , tandis qu'il serait introuvable sans ce
classernenL.
Ainsi sont nés les syslèmes et les méthodes
en histoire naturelle. Il est difiicile
(J'éiat)lir nettement la distinction entre les
classifications désignées par ces d'eux noms
(iiiTérents. On définit, il est vrai, ordinairement
les premiers comme n'emi)loyant que
iîes caractères tirés exclusivement d'un seul
o r g a n e, les secondes comme se servant de
plusieurs organes à la fois. Mais l'étude de
la plupart des systèmes nous les montre
toujours fondés sur rem[)loi de plusieurs
organes, aussi bien que les méthodes; et,
d ' u n e autre part, celles-ci en font généralement
prévaloir un sur les autres. Nous
nous servirons donc à peu près indiiTérernment
de ces deux mots.
Le premier système botanique véritablement
scientifique, c'est-à dire fondé sur des
considérations tirées des organes mômes des
plantes, est dû à un Italien , André Cesalpini,
et consigné dans son ouvrage de Playitis,
publié en 1583. Déjà, vers le milieu de
ce même siècle, l'illustre Conrad Gesner de
Zurich avait reconruï et écrit que les principaux
caractères de la plante doivent être
tirés de la fleur, du fruit et de ia graine,
plutôt que des feuilles, comme on Pavait
fait jusque là, et comme on continua à le
faire longtemps encore. Césalpin mit cette
vérité en pratique. Selon lui, le but de la
végétation est la pro<iuction des graines, qui
sont les foetus végétaux; la fleur est une
enveloppe, mais extérie.ure et passagère de
ces foetus; le fruit, une enveloppe permanente.
Aussi est-ce dans le fruit et la graine
quMl a cherché la base de son système , et
les a-t-il étudiés et connus bien autrement
que tous ses prédécesseurs et beaucoup de
ses successeurs. Il a su en reconnaître la
partie essentielle, l'embryon, et les parties
connituantes de celui-ci, le cotylédon simple
ou double, la radicule, qui se dirige soit
en haut soit en bas , soit eti dedans, soit en
d e h o r s , la gemmule {puncluyn vegetans) \
il les désigne par d'autres noms, mais les
décrit assez fidèlement pour être compris et
pour qu'on juge à quel degré il avait poussé
ses observations. Sa première division en deux
grandes classes, dont Tune comprend les arbres
elarbrisseaux, division qui remonlejus •
qu'à Théophraste, Taiitre les sous-arbrisseaux
et herbes , est la seule concession faite à son
temps. Il partage la première d'après la direction
de la radicule supère et infère; la
seconde, d'après le nombre pour chaque
fleur, soit des graines nues (akènes et
caryopses, où il a soupçonné la véritable
nature, la nature péricarpique du tégument
extérieur accolé plus ou moins intimement),
soit des péricarpes secs ou charnus qui renferment
ces graines. Ces nombres sont I,
2, 3, 4 , ou davantage, et, dans chacune
des divisions auxquelles préside un de ces
nombres, sont établies des subdivisions
d'après d'autres caractères fournis par ces
enveloppes de la graine ou du fruit. Il
forme ainsi 13 classes, et dans une quatorziètne
rejette les plantes où il a vu manquer
les graines, celles que nous nommons Cryptogames.
Dans ces organes fondamentaux
il a su trouver encore, pour établir de nouvelles
coupes dans plusieurs de ces classes,
de nombreuses modifications, telles que
l'indépendance ou l'adhérence de l'ovaire,,
l ' u n i t é ou la pluralité des carpelles ou des
loges, et, ce qu'on ne saurait trop faire
r e m a r q u e r , la situation relative de ces
loges lorsqu'elles sona réduites à deux , antéro
postérieure ou latérale par rapport à
Taxe principal, c'est-à-dire un de ces caractères
de symétrie dont l'emploi passe^
pour une invention tout à fait moderne.
On doit rendre hommage au génie de Césalpin
qui sut s'adresser aux organes les plus
essentielsdela plante, età la finessedeses observations
qui y découvrirent ces caractères
ignorés avant lui. Mais il ne sut pas établir
e n t r e eux une just e subordinat ion, ni les lier
à d'autres caractères tirés d'autres parties
d ' u n e observation plus facile et plus généralement
admise, dont l'emploi eût rendu
son système moins obscur et, par suite, plus
populaire. Aussi ce système, trop digne de
ce nom, dans l'acception où on l'admet communément,
puisqu'il ne fait usage que d'un
seul organe, ne paraît pas avoir exercé une
grande influence sur tous les travaux postér
i e u r s , et nous sommes obligés de franchir
u n siècle presqu'entier, pendant lequel la
botanique, tout en se perfectionnant, resta,
dans ses anciens errements, avant de rencontrer
un autre essai de classification qui
présente une véritable importance. Cet essai
fut tenté par un Anglais, Robert Morison,
qui, dans son grand ouvrage {Plantarum
liistoria universalis per tabulas cognalîonis
et affinitatis ex libro natures observaia et delecta,
1680-99), applique à Tensemble des
plantes connues un nouveau système qu'il
considérait, avec un peu trop de confiance,
comme celui de la nature elle-même. Il commence,
comme tous ses prédécesseurs, par la
division des végétaux en arbres et herbes,
puis divise celles-ci, les seules dont il ait traité,
en quinze classes, dont la dénomination
et le caractère sont tirés, pour la plupart, du
f r u i t , mais, pour quelques unes aussi, ou de
l'inflorescence (corymbifères, ombellifères),
ou de la fleur (hexapétales, fleurs en casque),
ou de la nature de la tige (culmifères), ou de
celle des sucs (lactescentes). Ces divers ca -
ractères sont quelquefois combinés entre eux
et avec ceux du fruit; ils le sont avec d'autres
encore, dans les subdivisions de ces
clas.ses. De leur emploi sinnultané et un peu
confus, résulte une classification, d'une part
assez confuse elle-même, et qu'il sérait difficile
de réduire en tableau, mais, de l'autre,
moins gênée par les exigences du système
et présentant, par une heureuse conséquence
de ces défaut s mêmes, beaucoup plus
de fragments de groupes naturels.
A partir de cette époque, les systèmes se
multiplient, fondés sur des notions plus
précises et sur des matériaux plus abondants.
En efl'et, les recherches se sont poursuivies
avec zèle et se sont étendues dans tout le
monde, favorisées par Textension des rapports
commerciaux et des découvertes géographiques
; de nombreux jardins botaniques,
établis en Europe, en reçoivent et en
conservent les résultats; les écoles, plus
nombreuses et plus avancées, les sociétés
savantes, donnent aux études, avec l'activité
qui résulte d'une émulation générale, l'unité
qui résulte de communicat ions constantes et
rapides. La botanique a suivi ce grand mouvement
duxvm' ' siècle; et, dans l'histoire de
ses progrès, celle dont nous avons à nous
occuper ici, celle des classifications en particulier,
tiendrait à elle seule beaucoup tro])
de place, si nous voulions exposer tout ce
qu'on a fait en ce genre. Chaque découverte,
dans les organes des végétaux, a dû se résumer
dans un système, et, comme chacun de
ces organes peut être envisagé sous divers
points de vue, comme les rapports des uns
aux autres sont plus variés encore, on conçoit
la facilité de combiner des arrangements
nouveaux et l'abus qu'on a pu en
faire. Nous nous bornerons donc à l'exposition
des principaux systèmes, ceux qui ont
exercé sur la science une influence incontestable,
ceux qui ont été suivis par un
nombre plus ou moins grand d'autres aut
e u r s , de telle sorte que l'intelligence de
leurs ouvrages exige celle de l'ouvrage qui
leur a servi de guide.
Dans les dernières années du xvn® i^iècle,
parurent trois de ces systèmes : celui de
Ray, en Angleterre (1680), celui de Rivin,
en Allemagne (1690), celui de Tournefort,
en France (1694).
Nous commencerons par le second, le
moins important des trois, d'autant moins
que le grand ouvrage dans lequel il devait
être appliqué à l'ensemble des plantes {In~
troductio generalis in rem herbarium, 1690-
1699) n'a pas été achevé. La classification
de Rivin (dont le vrai nom, ainsi latinisé,
étaitBachmann) est purementsystématique,
puisque c'est sur la considération exclusive
de la corolle que se fondent ses dix-neuf
classes. Cette corolle manque ou existe;
elle est régulière ou irrégulière, composée
d ' u n e seule ou de plusieurs pièces. De là les
divisions que fera mieux comprendre le tableau
suivant.