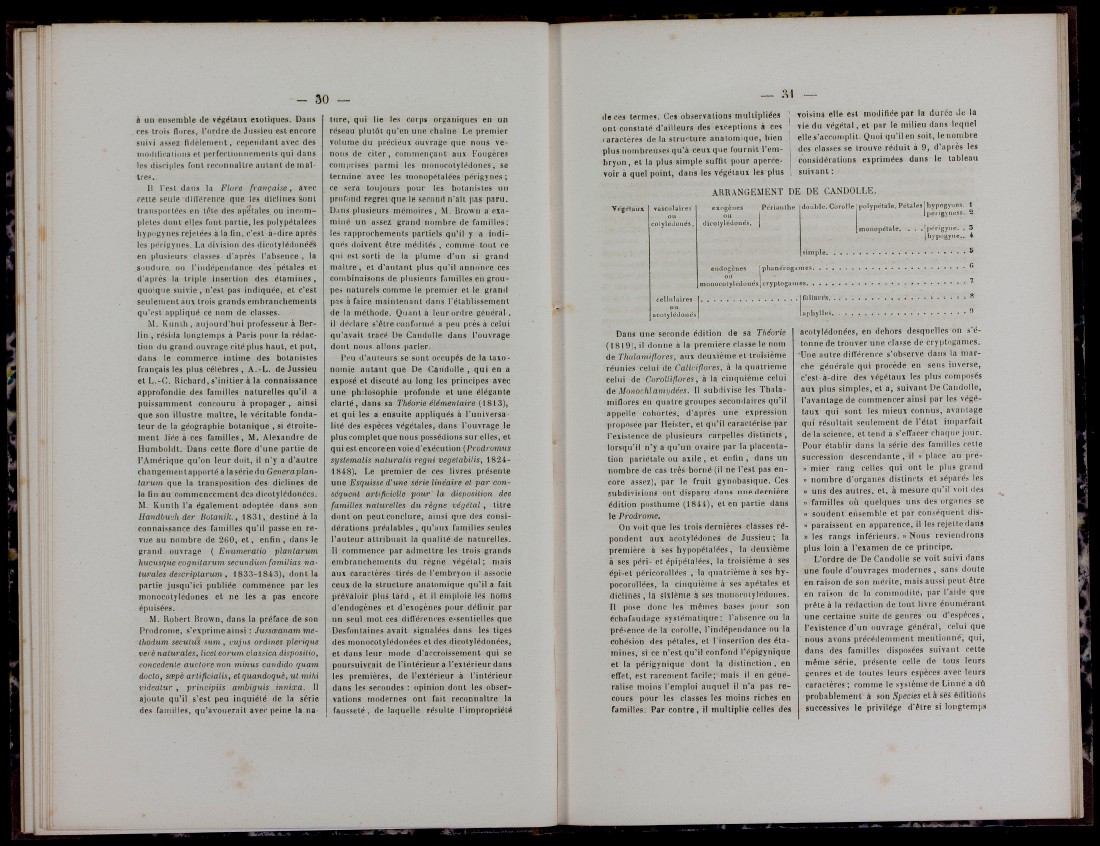
à un ensemble de végétaux exotiques. Dans
ces trois flores, l'ordre de Jussieu est encore
suivi iisspz fideleuient, cepen(i¡ml avec des
niodiiicaiions et, perfecUoi inenient s qui dans
ies disciples foui reconnaître autant de maîtres.
Il Test dans la Flore française, avec
cette seule dilVcrence que les diclines sont
traiis|iort^es en tete des ap'étales ou incompletes
dont elles font partie, les polypétaiées
hypogynes rejetées à la fin, c'est à-dire après
ies péri{zynes. La division des dicotylédonées
en plusieurs classes d'après Tabsence , la
soudure ou riiuiépeudance des pétales et
d'après la triple insertion des étamines,
quoique suivie , n'est pas indiquée, et c'est
seulement aux trois grands embranchements
q u ' e s t appliqué ce nom de classes.
M. KunUi, aujourd'hui professeur à Berlin
, résida longtemps à Paris pour la rédaction
du grand ouvrage cité plus haut , et put,
dans le commerce intime des botanistes
français les plus célèbres, A.-L. deJussieu
et L.-C. Richard, s'initier à la connaissance
approfondie des families naturelles qu'il a
puissamment concouru à propager, ainsi
que son illustre maître, le véritable fondat
e u r de la géographie botanique , si étroitement
liée à ces familles, M. Alexandre de
Humboldt. Dans cette flore d'une partie de
l ' A m é r i q u e qu'on leur doit, il n' y a d'autre
c h a n g e m e n t a p p o r t é à l a s é r i edu Gerteraplantarum
que la transposition des diclines de
la fin au commencement des dicotylédonées.
M. Runih Ta également adoptée dans son
Haììdbuch der Botanilc.j 1S31, destiné à la
connaissance des familles qu'il passe en revue
au nombre de 260, et, enfin , dans le
grand ouvrage ( EnumeraUo planiarum
huciisque cognilarum securidùm familias naturales
descriplarum , 1833-1843), dont la
p a r t i e jusqu'ici publiée commence par les
monocotylédones et ne les a pas encore
épuisées.
M. Robert Brown, dans la préface de son
Prodrome, s'exprime ainsi : Jussoeanam me-
Ihodum seculus sum, cujus ordines plerique
verè naturales, licei eorum classica disposino,
concedente auctore non minus candido quam
docto, soepè aríificialis, etquandoquè, ut miki
videatur , principiis amhiguis innixa. II
a j o u t e qu'il s'est peu inquiété de la série
des familles, qu'avouerait avec peine la nat
u r e , qui lie les corps organiques en un
réseau plutôt qu'en une chaîne Le premier
volume du précieux ouvrage que nous venons
de citer, commençant aux Fougères
comprises parmi les monocotylédones, se
termine avec les monopétalées périgynes;
ce sera toujours pour les botanistes un
profond regret que le second n'ait pas paru.
D.ins plusieurs mémoires, M. Brown a examiné
un assez grand nombre de familles;
les rapprochements partiels qu'il y n indiqués
doivent être médités , comme tout ce
qui est sorti de la plume d'un si grand
m a î t r e , et d'autant plus qu'il annonce ces
combinaisons de plusieurs familles en groupes
naturels comme le premier et le grand
p.-as à faire maiiitenant dans l'établissement
de la méthode. Quant à leur ordre général ,
il déclare s'être conformé a peu près à celui
q u ' a v a i t tracé De Candolle dans l'ouvrage
dont nous allons parler.
P f u d'auteurs se sont occupés de la taxonornie
autant que De Candolle , qui en a
exposé et discuté au long les principes avec
une philosophie profonde et une élégante
c l a r t é , dans sa Théorie élémentaire (1813),
et qui les a ensuite appliqués à l'universalité
des espèces végétales, dans l'ouvrage le
plus complet que nous possédions sur elles, et
qui est encore en voie d'exécut ion {Prodromns
systematis naturalis regni vegetahilis, 1824-
1848). Le premier de ces livres présente
u n e Esquisse d'une série linéaire et par conséquent
artificielle pour la disposition des
familles naturelles du règne végétal , titre
dont on peutconclurej ainsi que des considérations
préalables, qu'aux familles seules
l ' a u t e u r attribuait la qualité de naturelles.
Il commence par admettre les trois grands
embranchements du règne végétal; mais
aux caractères tirés de l'embryon il associe
ceux de la structure anatomique qu'il a fait
prévaloir plus tard , et il emploie les noms
d'endogènes et d'exogènes pour définir par
u n seul mot ces dilîérences essentielles que
Desfontaines avait signalées dans les tiges
des monocotylédonées et des dicotylédonées,
et dans leur mode d'accroissement qui se
poursuivrait de l'intérieur à l'extérieur dans
les premières, de l'extérieur à l'intérieur
dans les secondes : opinion dont les observations
modernes ont fait reconnaître la
f a u s s e t é , de laquelle résulte Timpropriélé
d e c e s termes. Ces observations multipliées
ont constaté d'ailleurs des exceptions à ces
( a r a c t c r e s de la stru'-ture anatomique, bien
plus nonïbreuses qu' à ceux que fournit l'emb
r y o n , et la plus simple suffit pour apercevoir
à quel point, dans les végétaux les plus
voisins elle est modifiée par la durée Je la
vie du végétal, et par le milieu dans lequel
elle s'accompl i t. Quoi qu'il en soit, le nouibre
des classes se trouve réduit à 9, d'après les
considérations exprimées dans le tableau
suivant :
Végétaux vasciilaires
ou
colylédonés,
ARRANGEMENT DE DE CANDOLLE.
exngeiies Pé r i a n the
ou
dicoty tédoués.
endogènes phane'rog
ou
mouocotyl(ido nés
double. Corolle polypétale. Peíales
hypogyiies. 1
péiigyncss. 2
Iperigyne.
[hypogyne.
monopétale, . . .
simple.
cellulaires
ou
acotylédonés
cryptogames
foliacés ^
- . ii
Dans une seconde édition de sa Théorie
(1819), il donne à la première classe le nom
de Thalamifiores, aux deuxième et troisième
réunies celui de Caliciflores, à la quatrième
celui de CoroUiflores, à la cinquième celui
de Monochlamydées. Il subdivise les Thalamiflores
en quatre groupes secondaires qu'il
appelle cohortes, d'après une expression
proposée par Heister, et qu'il caractérise par
l'existence de plusieurs carpelles distincts,
lorsqu'il n'y a qu'un ovaire par la placentation
pariétale ou axile , et enfin, dans un
nombre de cas très borné (il ne l'est pas encore
assez), par le fruit gynobasique. Ces
subdivisions ont disparu dans une dernière
édition posthume (1844), et en partie dans
le Pi'odrome.
On voit que les trois dernières classes répondent
aux acotylédonés de Jussieu ; la
première à ses hypopétalées, la deuxième
à ses péri- et épipétalées, la troisième à ses
épi-et péricorollée.s , la quatrième à ses hypocorollées,
la cinquième à ses apétales et
d i c l i n e s , la sixième à ses monocotylédones.
Il pose donc les mêmes bases pour son
échafaudage systématique: l'absence ou la
présence de la corolle, l'indépendance ou la
cohésion des pétales, et Tinsertion des étamines,
si ce n'est qu'il confond répigynique
et la périgynique dont la distinction, en
effet, est rarement facile; mais il eu généralise
uioins l'emploi auquel il n'a pas recours
pour les classes les moins riches en
familles. Par contre, il multiplie celles des
aphytles
acotylédonées, en dehors desquelles on s'étonne
de trouver une classe de cryptogames.
Une autre ditlerence s'observe dans la marche
générale qui procède en sens inverse,
c ' e s l - à - d i r e des végétaux les plus composés
aux plus simples, et a, suivant De Caridolle,
l ' a v a n t a g e de commencer ainsi par les végétaux
qui sont les mieux connus, avantage
qui résultait seulement de l'état imparfait
de la science, et tend à s'effaeer chaque jour.
Pour établir dans la série des familles celte
succession descendante , il « place au pre-
» mier rang celles qui ont le plus grijud
» nombre d'organes distincts et séparés les
1) uns des autres, et, à mesure qu'il voit des
» familles où quelques uns des orgfiiies se
H soudent ensemble et par conséquent dis-
» paraissent en apparence, il les rejet t e dans
» les rangs inférieurs. » Nous reviendrons
plus loin à l'examen de ce principe.
L ' o r d r e de De Candolle se voit suivi dans
u n e foule d'ouvrages modernes, sans doute
en raison de son mérite, mais aussi peut être
en raison de la commodité, par l'aide que
prête à la rédaction de tout livre énumérant
u n e certaine suite de genres ou d'espèces,
l'existence d'un ouvrage général, celui que
nous avons précédemment mentionné, qui,
dans des familles disposées suivant cette
même série, présente celle de tous leurs
genres et de toutes leurs espèces avec leurs
caractères ; comme le sysième de Linné a dû
probablement à son 5pecies et à ses éditions
successives le privilège d'être si longtemps
te
m