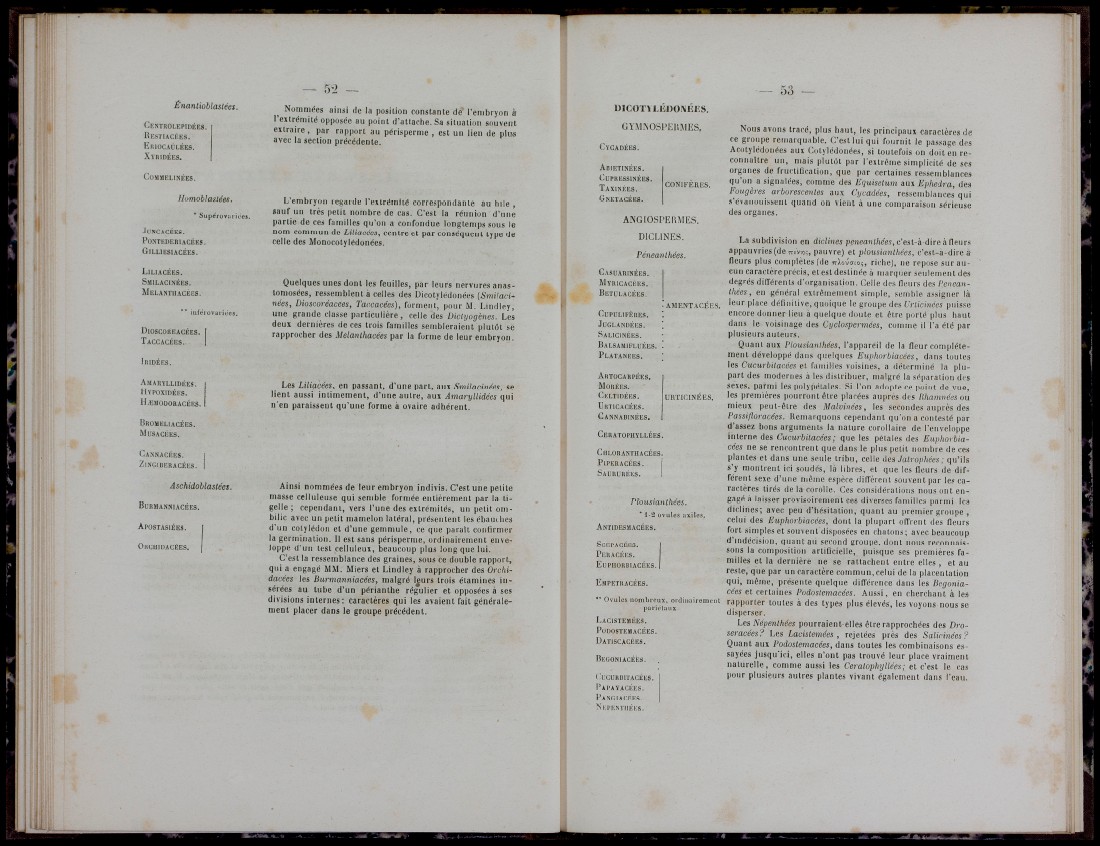
rrl
Énantiohlastées.
? ì
S i
CENTUOLEPIDÉES.
RESTÎACÉES.
KNIOCAULÉES.
XYR IDÉES,
COMilELINÉES.
Homobiastées.
Supérovaiices.
JUNCACÉES.
PONTEDERIAGÉES.
GILLIESIACÉES.
LILÌACÉES.
SMILACINÉES.
MELANTUACËES.
iiii'erovarities.
DiOSCOREAOÉES.
TACCÂGÉES.
IRIDÉES.
AMARYLLIDÉES.
HYPOXIDÉKS.
H.^MODOaACÉES,
BROMELIACEES.
MUSAGÉES.
CANNACÉES.
ZiNGiBERACÉES.
Aschtdoblaslées.
BURMANNIACÉES.
APOSTASIÉES.
ORCHIDAGÉES.
Nommées ainsi de ia position constante de l'embryon à
rextrémité opposée au point d'attache. Sa situation souvent
e x t r a i r e , par rapport au périsperme , est un lien de plus
avec la section précédente.
L'embryon regarde l'extrémité correspondante au hile ,
sauf un très petit nombre de cas. C'est la réunion d'une
partie de ces familles qu'on a confondue longtemps sous le
nom commun de Liliacées, centre et par conséquent type de
celle des Monocotylédonées.
Quelques unes dont les feuilles, par leurs nervures anastomosées,
ressemblent à celles des Dicotylédonées [Smilacinées,
Dîoscoréacees, Tacxacées), forment, pour M. Lindiey,
une grande classe particulière, celle des Dictyogènes. Les
deux dernières de ces trois familles sembleraient plutôt se
rapprocher des Melanthacées par la forme de leur embryon.
Les Liliacées, en passant, d'une part, aux Smilacinées, se
lient aussi intimement, d'une autre, aux Amaryllidées qui
n'en paraissent qu'une forme à ovaire adhérent.
Ainsi nommées de leur embryon indivis. C'est une petite
masse celluleuse qui semble formée entièrement par la tigelle
; cependant, vers l'une des extrémités, un petit ombilic
avec un petit mamelon latéral, présentent les ébauches
d'un cotylédon et d'une gemmule, ce que paraît confirmer
la germination. Il est sans périsperme, ordinairement enveloppé
d'un test celluleux, beaucoup plus long que lui.
C'est la ressemblance des graines, sous ce double rapport,
qui a engagé MM. Miers et Lindiey à rapprocher des Orcliidacées
les Burmanniacées y malgré l^urs trois étamines insérées
au tube d'un périanthe régulier et opposées à ses
divisions internes: caractères qui les avaient fait généralement
placer dans le groupe précédent.
DSC0T\LÉl>0I\l5l!:S.
GYMNOSPERMES,
CVCADÉES.
ABIETINÉES.
CUPRESSINÉES.
TAXINÉES.
GNETAGÉES.
C O N I F E R E S .
ANGiOSPEIAMES.
DIGLINES.
Péneanthées.
AMENTACÉES.
U R T I C I N E E S .
CASUARINÉES.
MYRIGAGÉES.
BEÏULAGÉES.
CUPULIFÈRES.
JUGLANDÉES.
SALIGINÉES.
BALSAMIFLUÉES.
PLATANÈES.
ARTOGARPÉES.
M ORÉES,
CLILTMÉES.
URTICAGÉES.
CANNABINÉES.
CERATOPHYLLÉES.
CHLORANTHAGÉES.
P I PERÂGÉES.
SAURURÉES.
Plousianthées,
' l - â ovules axiles.
ANTIDESMAGÉES.
SGEPAGÉES.
P E R ÂGÉ ES.
EUPUORBIAGÉES.
EMPETUAGÉES.
** O v u l e s nombreux, ordinairement
p a r i é l a n x .
LAGISTEMÉES.
PODOSTEMAGÉES.
DATISC.-IGÉES.
BEGONIAGÉES.
(.'UGURBITAGÉES.
PÀPAYACÉES.
PANGIAGÉES.
NTIPENTUÉES.
Nous avons tracé, plus haut, les principaux caractères de
ce groupe remarquable. C'est lui qui fournit le passage des
Acotylédonées aux Cotylédonées, si toutefois on doit en reconnaître
un, mais plutôt par l'extrême simplicité de ses
organes de fructification, que par certaines ressemblances
qu'on a signalées, comme des Equisetum ¡mxEphedra, des
Fougères arborescentes aux Cycadées, ressemblances qui
s'évanouissent quand on vient à une comparaison sérieuse
des organes.
La subdivision en diclines peneani/iees, c'est-à-dire à fleurs
appauvries (de 7riv/)ç, pauvre) et plousianthées, c'est-à-dire à
fleurs plus complètes (de Tr^oucrtoç, riche), ne repose sur aucun
caractère précis, etestdest inée à marquer seulement des
degrés différents d'organisation. Celle des fleurs des Penean-
Ihées, en général extrêmement simple, semble assigner là
leur place déiiniLive, quoique le groupe des Urticinées puisse
encore donner lieu à quelque doute et être porté plus haut
dans le voisinage des Cyclospermées, comme il l'a été par
plusieurs auteurs.
Quant aux Plousianthées, l'appareil de la fleur complètement
développé dans quelques Euphorbiacées ^ dans toutes
les Cucurbitacées et familles voisines, a déterminé la plupart
des modernes à les distribuer, malgré la séparation des
sexes, parmi les polypétales. Si l'on adopte ce point de vue,
les premières pourront être placées auprès des lihamnées ou
mieux peut-être des Malvinées, les secondes auprès des
Passifloracées. Remarquons cependant qu'on a contesté par
d'assez bons arguments la nature corollaire de l'enveloppe
interne des Cucurbitacées; que les pétales des Euphorbiacées
ne se rencontrent que dans le plus petit tiombre de ces
plantes et dans une seule tribu, celle des Jatrophées ; qu'ils
s'y montrent ici soudés, là libres, et que les fleurs de différent
sexe d'une même espèce diflereiit souvent par les caractères
tirés de la corolle. Ces considérations nous ont engagé
à laisser provisoirement ces diverses familles parmi les
diclines; avec peu d'hésitation, quatit au premier groupe ,
celui des Euphorbiacées, dont la plupart oflVent des fleurs
fort simples et souvent disposées en chatons; avec beaucoup
d'indécision, quant au second groupe, dont nous reconnaissons
la composition artificielle, puisque ses premières familles
et la dernière ne se rattachent entre elles , et au
reste, que par un caractère commun, celui de la placentation
qui, même, présente quelque diiTérence dans les Begoniacées
et certaines Podostemacées. Aussi, en cherchant à les
rapporter toutes à des types plus élevés, les voyons-nous se
disperser.
Les Népenthées pourraient-elles être rapprochées des Droseracées?
Les Lacistemées , rejetées près des Salicinées?
Quant aux Podostemacéesf dans toutes les combinaisons essayées
jusqu'ici, elles n'ont pas trouvé leur place vraiment
n a t u r e l l e , comme aussi les Ceratophyllées; et c'est le cas
pour plusieurs autres plantes vivant également dans l'eau.