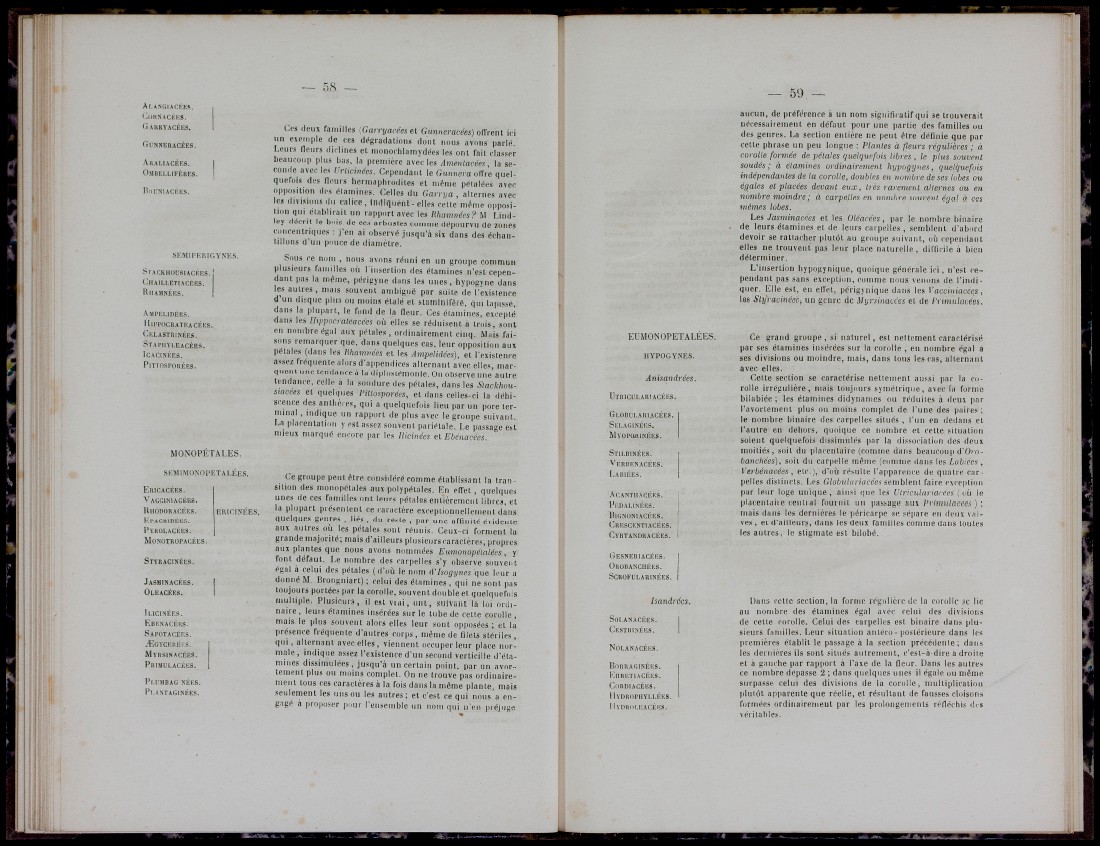
hi i
. I
hi i
I
Í>)HNAC¿KS.
(ÎAUKVACÉES.
OUNNERACÉES.
ARALIACÉF.S.
OMBEI.LIFÈHES,
L^U'NMACÉES.
SEMIPEIUGYNES,
SL-ACKHOUSIACKES. '
C'HAILLETIACÉES.
HIIAMNÉES.
AMPKLIDÉKS,
HLPPOCRATEACÉES.
Î^.KLASTRINÉES.
STAPHYLEACÉES.
iCAClNKES.
P i T i O S P O R É E S .
M O N O P É T A L E S .
SEIMIMOXOPETALÉES.
ERICACÉES.
VACCINIACÉES.
HHODORACÉES. ER F C I N É E S .
1M>ACIIIDÉES.
PVKOLAGÉES.
MONOTROPACÉES.
STYRACINÉES.
JASMINACÉES.
OLEACÉES.
ILICINÉES.
EBENACÉES.
SAPOTACÉES.
^^GYCEnÉi'S.
MYRSINACÉES.
PRIMULACÉES.
PI.UMBAG
PLANTAGINÉES.
5 8
Ces deux faniitles (GarryacëesH Gunneracées) oiïretM ici
nn exemple de ces dégradations dont nous avons park^
Leurs (leurs diclines et rnonochlamydées les ont fait classer
beaucoup plus bas, la première avec les Anmilacées, la seconde
avec les Urlicinées. Cependant le GunneraoWve quelquefois
des fleurs hermaphrodites et même pétalées avec
opposition des étamines. Celles du Garrya , aUernes avec
les divisions du calice, indiquent-elles cette même opposition
qui établirait un rapport avec les Hhanmées? J\L Lindley
décrit le bois de ces arbustes comme dépourvu de zones
concentriques : j 'en ai observé jusqu' à six dans des échantillons
d'un pouce de diamètre.
Sous ce nom , nous avons réuni en un groupe commun
plusieurs familles où l insertion des étamines n'est cependant
pas la même, périfiyne dans les unes, hypogyne dans
les autres, mais souvent ambiguë par suite de l'existence
d ' u n disque plus ou moins étalé et staminifèie, qui tapissé,
dans la plupart, le fond de la fleur. Ces étamines, excepté
dans Hippocrateocées où elles se réduisent à trois, sont
en nombre égal aux pétales, ordinairement cinq. Mais faisons
remarquer que, dans quelques cas, leur opposition aux
peíales (dans les Jihomvées et \es. Ampelidées), et l'existence
assez fréquente alors d'appendices alternant avec elles, marquent
une tendance à la diplostémonie. On observe une autre
tendance, celle à la soudure des pétales, dans les Stackhousiacees
et quelques IHttosporées, et dans celles-ci la déhiscence
des anthères, qui a quelquefois lieu par un pore tertninal
, indique un rapport de plus avec le groupe suivant.
La placentation y est assez souvent pariétale. Le passage est
mieux marqué encore par les Ilicinées elEbénacées,
Ce groupe peut être considéré comme établissant la tran -
siLion des monopétales aux polypétales. En eiTet , quelques
unes de ces familles ont leurs pétales entièrement libres, et
la plupart présentent ce caractère exceptionnellement dans
quelques genres , liés, du reste, par une afûnité évidente
aux autres où les pétales sont réunis. Ceux-ci forment la
grande majorité; mais d'ailleurs plusieurscaractères, propres
aux plantes qu€ nous avons nommées Eumonopétalées, y
font défauL Le nombre des carpelles s'y observe souvent
égal a celui des pétales (d'où le nom (Vlsogynes que leur a
donné M. Brongniart) ; celui des étamines , qui ne sont pas
toujours portées par la corolle, souvent double et quelquefois
fiiultiple. Plusieurs, il est vrai , ont , suivant la loi ordinaire
, leurs étamines insérées sur le tube de cette corolle ,
mais le plus souvent alors elles leur sont opposées ; et la
présence fréquente d'autres corps, même de filets stériles ,
q u i , alternant avec elles, viennent occuper leur place normale
, indique assez l'existence d'un second verticille d'étamines
dissimulées, jusqu'à uncertain point, par un avor--
tement plus ou moins complet. On ne trouve pas ordinairement
tous ces caractères à la fois dans la même plante, mais
seulement les uns ou les autres; et c'est ce qui nous'a engagé
a proposer pour l'ensemble un nom qui n'en préjuge
EUMONOPETALEES.
HYPOGYNES.
Ânimnàrées.
Ü T R l C ü L A R l A C É E S .
GLOBULARIACÉES.
SELAGINÉES.
MYOPO^ÏINÉES.
STILBINÉES.
VETÏBENACÉES.
Í.ABIÉES.
ACANTHACÉKS.
PEDALINÉES.
BIGNONIACÉES.
CRESGENTIACÉES.
CYRTANDRACÉES.
GESNERIACÉES.
OROBANCHÉES.
SCROFULARINÉES.
Isandrées.
SOLANACÉES.
CESTRINÉES.
NOLANACÉES.
BoRRAGI^^ÉES.
E n KEï i ÂGÉES.
C o R D l A C É E S .
IIVDROPIÏYLLÉES.
(IVNAOLEACÉES.
aucun, de préférence à un nom significatif qui se trouverait
nécessairement en défaut pour une partie des familles ou
des genres. La section entière ne peut être définie que par
cette phrase un peu longue : Plantes à fleurs régulières ; à
corolle formée de pétales quelquefois libres , le plus souvent
soudés; à élamnies ordinairement hypogyves, quelquefois
indépendantes de la corolle, doubles en nombre de ses lobes ou
égales el placées devant eux, tiès rarement alternes ou en
nombre moindre; à carpelles en 7iombre souvent égal à ces
mêmes lobes.
Les Jasminacées et les Oléacées ^ par le nombre binaire
de leurs étamines et de leurs carpelles, semblent d'abord
devoir se rattacher plutôt au groupe suivant, où cependant
elles ne trouvent pas leur place naturelle, difficile à bien
déterminer.
L'insertion hypogynique, quoique générale ici, n'est cependant
pas sans exception, comme nous venons de l'indiquer.
Elle est, en elVet, périgynique dans les Vacciniacées,
les StyracinéeSj un genre de Myrsinacées et de Primulacées,
Ce grand groupe, si naturel, est nettement caractérisé
par ses étamines insérées sur la corolle , en nombre égal à
ses divisions ou moindre, mais, dans tous les cas, alternant
avec elles.
Cette section se caractérise nettement aussi par la C(Îrolle
irrégulière, mais toujours symétrique, avec la forme
b i l a b i é e ; les étamines dldynarnes ou réduites à deux par
l'avortement plus ou moins complet de Tune des paires ;
le nombre binaire des carpelles situés , Tun en dedans et
l ' a u t r e en dehors, quoique ce nombre et cette situation
soient quelquefois dissimulés par la dissociation des deux
moitiés, soil du placentaire (comme dans beaucoup d'Oi-obanchées)
y soil du carpelle même (comme dans les Labiées,
Verbénacées y etc.], d'où résulte l'apparence de quatre carpelles
disiincts. Les Globnlaiiacées semblent faire exception
pa-r leur loge unique, ainsi que les Ulriculariacées (où ie
placentaire central fournit un passage aux Primulocees ) ;
mais dans les dernières le péricarpe se sé[)are en deux valves
, et d'ailleurs, dans les deux familles comme dans toutes
les autres, le stigmate est bilobé.
Dans cette section, la forme régulière de la corolle se lie
au nombre des étamines égal avec celui des divisions
de celte corolle. Celui des carpelles est binaire dans plusieurs
familles. Leur situation antéro-postérieure dans les
premières établit le passage à la section précédente; dans
les dernières ils sont situés autrement, c'est-à-dire à droite
et à gauche par rapport à l'axe de la fleur. Dans les autres
ce nombre dépasse 2 ; dans quelques unes il égale ou même
surpasse celui des divisions de la corolle, mullipHcation
plutôt apparente que réelle, et résultant de fausses cloisons
formées ordinairement par les prolongements réHéchls des
véritables.
LI