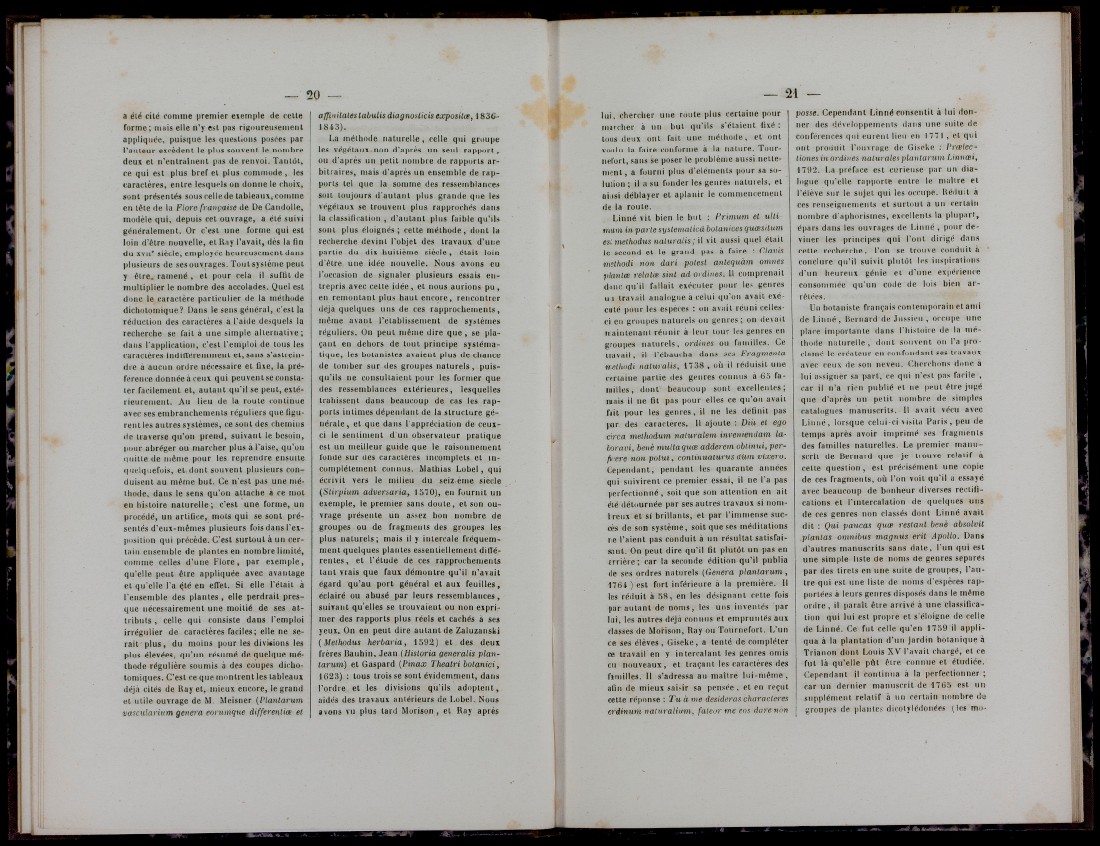
r "
2 0 —
s
a été cité ooniine premier exemple de celle
f o r m e ; tuais elle n'y esl pas rigoureusemetil
appliquée, puisque les questions postées par
l ' a u t e u r excèdent le plus souvent le nombre
deux et n'entraînent pas de renvoi. Tantôt,
ce qui est plus bref et plus commode , les
caractères» entre lesquels on donne le choix,
sont présentés souscellede tableaux,cotnme
en tête de la Flore française de De Candolle,
modèle qui, depuis cet ouvrage, a été suivi
g é n é r a l e m e n t . Or c'est une forme qui est
loin d'être nouvelle, et Ray Pavait, dès la fin
d u xvn'^ siècle, employée heureusement dans
p l u s i e u r s de ses ouvrages . Toutsysième peut
y être, ramené , et pour cela il suffit de
m u l t i p l i e r le nombr e de« accolades. Quel est
donc le caractère particulier de la méthode
d i c h o t o m i q u e ? Dans le sens général, c'est la
r é d u c t i o n des caractères a l'aide desquels la
recherche se fait à une simple alternative;
dans l'application, c'est l'emploi de tous les
c a r a c t è r es indilïéremment et, sans s'astreind
r e à aucun ordre nécessaire et fixe, la préférence
donnée à ceux qui peuvent se constater
facilement et, autant qu'il se peut, extér
i e u r e m e n t . Au lieu de la route continue
avec ses embr anchement s réguliers que figur
e n t les aut res systèmes, ce sont des chemins
d e traverse qu'on prend, suivant le besoin,
pour abréger ou marcher plus à l'aise, qu'on
( t u i t t e de même pour les reprendre ensuite
q u e l q u e f o i s , et dont souvent plusieurs conduisent
au même but. Ce n'est pas une méthode,
dans le sens qu'on attache à ce mot
en histoire naturelle; c'est une forme, un
procédé, un artifice, mots qui se sont présentés
d'eux-mêmes plusieurs fois d a n s l'exposition
qui précède. C'est surtout à un certain
ensemble de plantes en nombre limité,
comme celles d'une Flore, par exemple,
q u ' e l l e peut être appliquée avec avantage
et qu'elle Ta ^té en eflet. Si elle l'était à
l ' e n s e m b l e des plantes, elle perdrait presque
nécessairement une moitié de ses att
r i b u t s , celle qui consiste dans l'emploi
i r r é g u l i e r de caractères faciles; elle ne ser
a i t plus, du moins pour les divisions les
plus élevées, qu'un résumé de quelque méthode
régulière soumis à des coupes dichot
o m i q u e s . C'est ce que mont rent les tableaux
déjà cités de Ray et, mieux encore, le grand
et utile ouvrage de M. Meisner (P/anto'wm
vasvularium genera eonunque differentioe et
affin Haies tabalis diagnoslicis exposiloe, 183^-
1 8 4 3 ) .
La méthode naturelle, celle qui groupe
les végétaux non d'après un seul rapport,
ou d'après un petit nombre de rapports arb
i t r a i r e s , mais d'après un ensemble de rapports
tel que la somme des ressemblances
soit toujours d'autant plus grande que les
végétaux se trouvent plus rapprochés dans
la classification , d'autant plus faible qu'ils
sont plus éloignés; cette méthode, dont la
recherche devint l'objet des travaux d'une
p a r t i e du dix huitième siècle, était loin
d ' ê t r e une idée nouvelle. Nous avons eu
l'occasion de signaler plusieurs essais ent
r e p r i s avec celte idée , et nous aurions pu ,
en remontant plus haut encore, rencontrer
déjà quelques uns de ces rapprochements,
même avant rétablissement de systèmes
r é g u l i e r s . On peut même dire q u e , se plaçant
en dehors de tout principe systémat
i q u e , les botanistes avaient plus de chance
d e tomber sur des groupes naturels, puisq
u ' i l s ne consultaient pour les former que
des ressemblances extérieures, lesquelles
t r a h i s s e n t dans beaucoup de cas les rapports
intimes dépendant de la s t ructur e gén
é r a l e , et que dans 1 a p p r é c i a t i on de ceuxci
le sentiment d un observateur pratique
est un meilleur guide que le raisonnement
fondé sur des caractères incomplets et incomplètement
connus. Mathias Lobel, qui
écrivit vers le milieu du seiz.ème siècle
(Slirpium adversariay 1570), en fournit un
exemple, le premier sans doute, et son ouvrage
présente un assez bon nombre de
groupes ou de fragments des groupes les
plus naturels; mais il y intercale fréquemment
quelques plantes essentiellement diiï'ér
e n t e s , et l'étude de ces rapprochements
t a n t vrais que faux démontre qu'il n'avait
égard qu'au port général et aux feuilles,
éclairé ou abusé par leurs ressemblances,
suivant qu'elles se trouvaient ou non exprimer
des rapports plus réels et cachés à ses
yeux. On en peut dire autant de Zaluzanski
{Metkodus herbaria, 1592) et des deux
frères Bauhin, Jean {Historia generalis p/aniarum)
et Gaspard [Pinax Theatri botanicif
1623) : tous trois se sont évidemment , dans
l ' o r d r e et les divisions qu'ils adoptent,
aidés des travaux aniérieurs de LobeL Nous
avons vu plus lard Morison, et Ray après
21
l u i . chercher une route plus certaine pour
marcher à un but qu'ils s'étaient fixé:
tous deux ont fail utie méthode, et ont
voulu la faire conforme à la nature. Tournet'ort,
sans se poser le problème aussi nettem
e n t , a fourni plus d'éléments pour sa sol
u t i o n ; il a su fonder les genres naturels, et
ainsi déblayer et aplanir le commencement
d e la roule.
Linné vil bien le but : Primum et ulli
muni in parte systeniaiicd botanices quoesUum
est methodus naluralis; i\ vit aussi quel était
le second et le grand pas à faire : Clavis
methodi non dari potest antequàm omnes
plantoe relotoe sint adordines. Il comprenait
donc qu'il fallait exécuter pour les genres
u n travail analogue à ceUii qu'on avail exéc
u t é pour les espèces : on avait réuni cellesci
en groupes naturels ou genres; on devait
n i a i n t e n a n i réunir à leur louv les genres en
groupes naturels, ordines ou fatnilles. Ce
t r a v a i l , il l'ébaucha dans ses Fragmenta
inelkodi naturalis, 1738 , où il réduisit une
c e r t a i n e partie des genres connus à 65 familles
, dont beaucoup sont excellentes ;
mais il ne fit pas pour elles ce qu'on avait
fait pour les genres, il ne les définit pas
par des caractères. Il ajoute : Diù et ego
circa melhodum naluraleni invemendam laboravi,
benè multaquoe adderern obiinui, perfirere
non potui, continuaturus dùm vixero.
C e p e n d a n t , pendant les quarante années
qui suivirent ce premier essai, il ne l'a pas
p e r f e c t i o n n é , soit que son attention en ait
é t é détournée par ses aut res travaux si nombreux
et si brillants, et par l'immense succès
de son systètne, soit que ses méditations
n e l'aient pas conduit à un résultat satisfais
a n t . On peut dire qu'il fit plutôt un pas en
a r r i è r e ; car la seconde édition qu'il publia
d e ses ordres naturels (Genera plantarum,
1 7 6 4 ) est fort inférieure à la première. Il
les réduit à 58, en les désignant cette fois
par autant de noms, les uns inventés par
l u i , les aut res déjà connus et empruntés aux
classes de Morison, Ray ou Tournefort . L'un
d e ses élèves, Giseke, a lenié de compléter
ce travail en y intercalant les genres omis
ou nouveaux, et traçant les caractères des
familles. Il s'adressa au maître lui-même,
afin de mieux saisir sa pensée, et en reçut
c e t t e réponse : Tu à me desideros cho7'octeres
ordinufn na(uralium, fateor me eos dore non
posse. Cependant Linné consentit à lui donner
des développements dans une suite de
conférences qui eurent lieu en 1771 , et qui
ont produit l'ouvrage de GiscKe : Proelectionesinordhies
naturaies plantarum Linnoeiy
1792. La préface est curieuse par un dialogue
qu'elle rapporte entre le maître et
l ' é l è v e sur le sujet qui les occupe. Réduit à
ces renseignements et surtout a un certain
nombre d'aphorismes, excellents la plupart,
é p a r s dans les ouvrages de Linné , pour deviner
les principes qui l'ont dirigé dans
c e t t e recherche, l'on se trouve conduit à
conclure qu'il suivit plutôt les inspirations
d ' u n heureux génie et d'une expérieiue
consommée qu'un code de lois bien arrêtées.
Un botaniste français contemporai n et ami
de Linné, Bernard de Jussieu , occupe une
place importante dans rhisloite de ta méthode
naturelle, dont souvent on l'a proclamé
le créateur en confondant ses travaux
avec ceux de son neveu. Cherchons donc à
lui assigner sa pari, ce qui n'est pas facile ,
car il n'a rien publié et ne peut être ju^é
q u e d'après un petit nombre de simples
catalogues manuscrits. Il avait vécu avec
L i n n é , lorsque celui-ci vi.siLa Par is, peu de
temps après avoir imprimé ses fragments
des familles naturelles. Le premier manuscrit
de Bernard que je trouve relatif à
c e t t e question, est précisément une copie
d e ces fragments, où l'on voit qu'il a essayé
avec beaucoup de bonheur diverses rectifications
et l'intercalalion de quelques uns
d e ces genres non classés dont Linné avait
d i t : Qui paucas quoe restant benè absolvit
plantas omnibus magnus erit Apolio. Dans
d ' a u t r e s manuscrits sans date, l'un qui est
u n e simple liste de noms de genres séparés
par des tirets en une suite de groupes, Pau-
Ire qui est une liste de noms d'espèces rapportées
à leurs genres disposés dans le même
o r d r e , il paraît être arrivé à une classification
qui lui est propre et s'éloigne de celle
d e Linné. Ce fut celle qu'en 1759 il appliqua
à la plantation d'un jardin botanique à
T r i a n o n dont Louis XV l'avait chargé, et ce
f u t là qu'elle pût êire connue et étudiée.
Cependant il continua à la perfectionner ;
car un dernier manuscrit de 1765 est un
s u p p l é m e n t relatif à un certain nombre ÛQ
groupes de plantes dicolylédonées (les mo