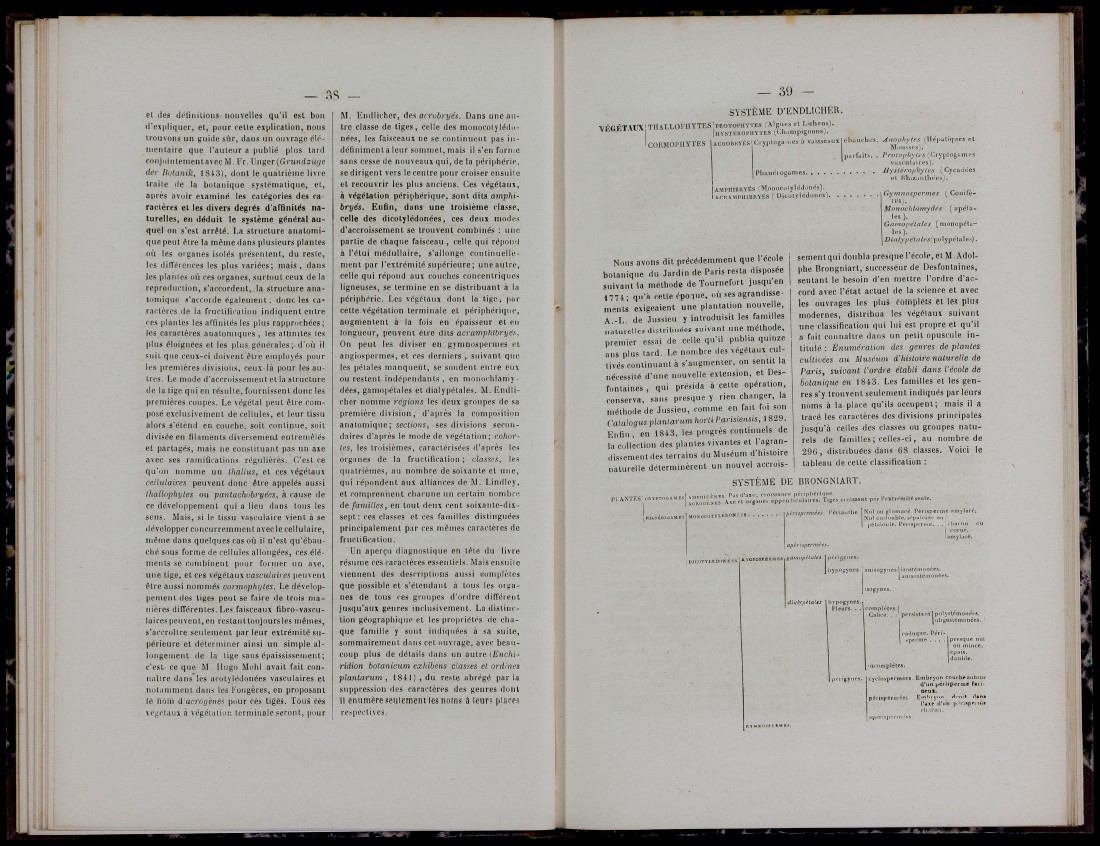
3S
et íies déíiiniions nouvelles qu'il est bon
(l'expliquer, et, pour cette explication, nous
trouvons un guide sûr, dans un ouvrage élémentaire
que l'auteur a publié plus tard
c o n j o i n t e n i e n t a v e c M. Fr . Hu^av{Grundzuge
der lîotajiik, lSi3), dont le quatrièïne livre
t r a i t e de la botanique systématique, et,
après avoir examiné les catégories des caractères
et les divers degrés d'arfinilés nat
u r e l l e s , en déduit le système général auquel
ou s'est arrêté. La structure anatomique
peut être la même dans plusieurs plantes
où les orgaiies isolés présentent, du reste,
les dinereiices les plus variées; mais, dans
ies planies où ces organes, surtout ceux de la
reproduction, s'accordent, la structure anatnrnique
s'accorde également: dóneles caractères
de la fructificaiion indiquent entre
ces plantes les affinités les plus rapprochées ;
les caractères anatoniiqucs , les affinités les
])!us éloignées et les plus générales; d'où il
suit que ceux-ci doivent être employés pour
les premières divisions, ceux-là pour les autres.
Le mode d'accroissement et la structure
de la tige qui en résulte, fournissent donc les
premières coupes. Le végétal peut être composé
exclusivement de cellules, et leur tissu
alors s' é t e n d en couche, soit continue, soit
divisée en filaments diversement entremêlés
et partagés, mais ne constituant pas un axe
avec ses ramifications régulières. C'est ce
q u ' o n nomme un Ihallus^ et ces végétaux
cellulaires peuvent donc être appelés aussi
Ihallophyles ou pantachohryées, à cause de
ce développement qtii a lieu dans tous les
sens. Mais, si le tissu vasculaire vient à se
d é v e l o p p e r c o n c u r r e m m e n t a v e c l e cellulaire,
même dans quelques cas où il n'est qu'ébauché
sous forme de cellules allongées, ces éléments
se combinent pour former un axe,
une tige, et ces végétaux vasculaires peuvent
ê t r e aussi nommés cormophyles. Le développement
des tiges peut se faire <ie trois manières
dirrérenies. Les faisceaux fibro-vascula
i res peuvent , en restant toujours les mêmes,
s'accroître seulement parleur extrémité sup
é r i e u r e et déterminer ainsi un simple allongement
de la tige sans épaississernent;
c'est ce que M. Hugo Mohl avait fait conn
a î t r e dans les acotylédonées vasculaires et
notamment dans les Fougères, en proposant
le nom d^acrogène^ pour ces tiges. Tous ces
végétaux à végétation terminale seront , pour
M. Eiid\khci\ des acrobryés. Dans une a!i~
t r e classe de tiges, celle des monocotylédonées,
les faisceaux ne se continuent pas iud
é f i n i m e n t à leur sommet , mais il s'en forme
sans cesse de nouveaux qui, de la périphérie,
se di r igent vers lecentre pour croiser ensuiie
et recouvrir les plus anciens. Ces végétaux,
à végétation périphérique, sont dits ainphibryés.
Enfin, dans une troisième classe,
celle des dicotylédonées, ces deux modes
d'accroissement se trouvent combinés : une
p a r t i e de chaque faisceau, celle qui répou(i
à l'étui médullaire, s'allonge continuellement
par l'extrémité supérieure; une autre,
celle qui répond aux couches concentriques
ligneuses, se termine en se distribuant à la
périphérie. Les végétaux dont la tige, par
cette végétation terminale et périphérique,
a u g m e n t e n t à la fois en épaisseur et eu
longueur, peuvent être dits acrarnphibryés.
On peut les diviser en gymnospermes et
angiospermes, et ces derniers , suivant que
les pétales manquent , se soudent entre eux
ou restent indépendants , en monochlamydées,
ganmpétales et dialypétales, M. Endlicher
nomme régions les deux groupes de sa
première division, d'après la composition
a n a t o m i q u e ; sections, ses divisions secondaires
d'après le mode de végétation; cohortes,
les troisièmes, caractérisées d'après les
organes de la fructification; classes, les
quatrièmes, au nombre de soixante et une,
qui répondent aux alliaiices de M. Lindley,
et com[)renhent cliacune un certain nombre
de fa.ï)iilles, en tout deux cent soixante-dixs
e p t : ces classes et ces familles distinguées
principalement par ces mêmes caractères de
f r u c t i f i c a t i o n .
Un aperçu diagnostique en tête du livre
résume ces caractères essentiels. Mais ensuite
viennent dés descriptions aussi complètes
que possible et s'étendant à tous les orj;anes
de tous ces groupes d'ordre diil'érent
j u s q u ' a u x genres inclusivement. La distinction
géographique et les propriétés de chaque
famille y sont indiquées à sa suite,
sommairement dans cet ouvrage, avec beaucoup
plus de détails dans un autre (Enc/iiridion
bolanicum exhibens classes et ord 'mes
plantarum , 1841) , du reste abrégé par la
suppression des caractères des genres dont
il énumèr e seulement les noms à leur? places
respectives.
39
VÉGÉTAUX THALLOPHYTES'PROTOPHYTEs CAlgii^PS et Lichens).
VLUIII/MJA IH Y S T É R O P H Y T E S (Champignons).
CORMOPUYTES
S Y S T È M E D'ENDLIGHER.
ES .(AlgiiPS et Lichens).
•YTES Ch.impignons).A C U O B R Y E S Cryptogames à vaisseaux ébauches. Annpiiytes (He'j>aliqMes cl
Mousses),
pai fuits. . ProlophyLes
vusculciiies).
Phanérogames HyslérophyLes (Cycadces
et Hhizanlhees).
A M P H I B R Y É S (Monocülylédonés).
A C R A M P H I B R Y É S ( Dicotylédones) Gymnospermes ( Coni fè-
Nous avons dit précédemment que l'école
b o t a n i q u e du Jardin de Paris resta disposée
s u i v a n t la méthode de Tournefor t jusqu'en
1 7 7 4 ; qu'à cette époiue, où ses agrandissements
exigeaient une plantation nouvelle,
A . - L . de Jussieu y introduisit les familles
naturelles distribuées suivant une méthode,
premier essai de celle qu'il publia quinze
ans plus tard. Le nombre des végétaux cultivés
cont inuant à s'augmenter, on sentit la
nécessité d'une nouvelle extension, et Desfoniaines
, qui présida à celte opération,
conserva, sans presque y rien changer, la
méthode de Jussieu, comme en fait foi son
Caialogus plantarum horii Parisienas, 1829.
Enfin en 1843, les progrès continuels de
la collection des plantes vivantes et l'agran-
(lissementdes terrains du Muséum d'histoire
n a t u r e l l e déterminèrent un nouvel accrois-
Mojiochl nmyd es ( a p é 1 a «
tes ).
Gamopétales ( monope'tales).
Dialypétales{Y>o\'^'^é{d.\Q9>).
s e m e n t q u i doubla presque l'école, et M.Adolphe
Brongniart, successeur de Desfontaines,
s e n t a n t le besoin d'en mettre l'ordre d'accord
avec Tétat actuel de la science et avec
l«s ouvrages les plus complets et les plus
modernes, distribua les végétaux suivant
u n e classification qui lui est propre et qu'il
a fait connaître dans un petit opuscule int
i t u l é : Énuméraiion des genres de plantes
cultivées au Muséum d'histoire naturelle de
PariSy suivant l'ordre élabli dans l'école de
botanique en 1843. Les familles et les genres
s'y trouvent seulement indiqués par leurs
noms à la place qu'ils occupent; mais il a
tracé les caractères des divisions principales
j u s q u ' à celles des classes ou groupes naturels
de familles; celles-ci, au nombre de
2 9 6 , distribuées dans 6S classes. Voici le
tableau de cette classification :
SYSTÈLME DE BRONGNÏART.
PLANTES'CRYPTOGAMES
PHiiîSEP.OiiAMES
A en
MONOCOTY-LÉDON litiS périspcrmées. i'érianthe Nul ou gliimacé. Périsperme amylacó.
Nul ou double, srpalnïtle ou
péliiloi'ie. Périsperiiie. ..Cliartiu ou
corné,
amylacé,
apévisperniées.
i DICOTYLEDON E L-:S ANGIOSPERMES gamopétales
dialypétales
perigyiies.
liypogynes anisogynes isostémonées.
a aisostémonées.
hypogynes.
Fleurs. . .
isogynes.
c o m p l è t P S . 1
Calice. . .'persistant polystémonéfs.
uligosLémonées.
raïUique. Péi
.sperme . . presque nul
ou mince,
épais,
double.
p t M - i g y r i e s .
iiiromplètcs.
cycloipermées. Embryon courbeaulour
d'un périsperme fm ioeus.
périspernices Embryon droit dans
l'axe d'un p '-risp^nnr
cli.iinu.
;ip«'ri,sp('rtf).'('.s.
¥
fiYMK<isr>-:nM v.s.