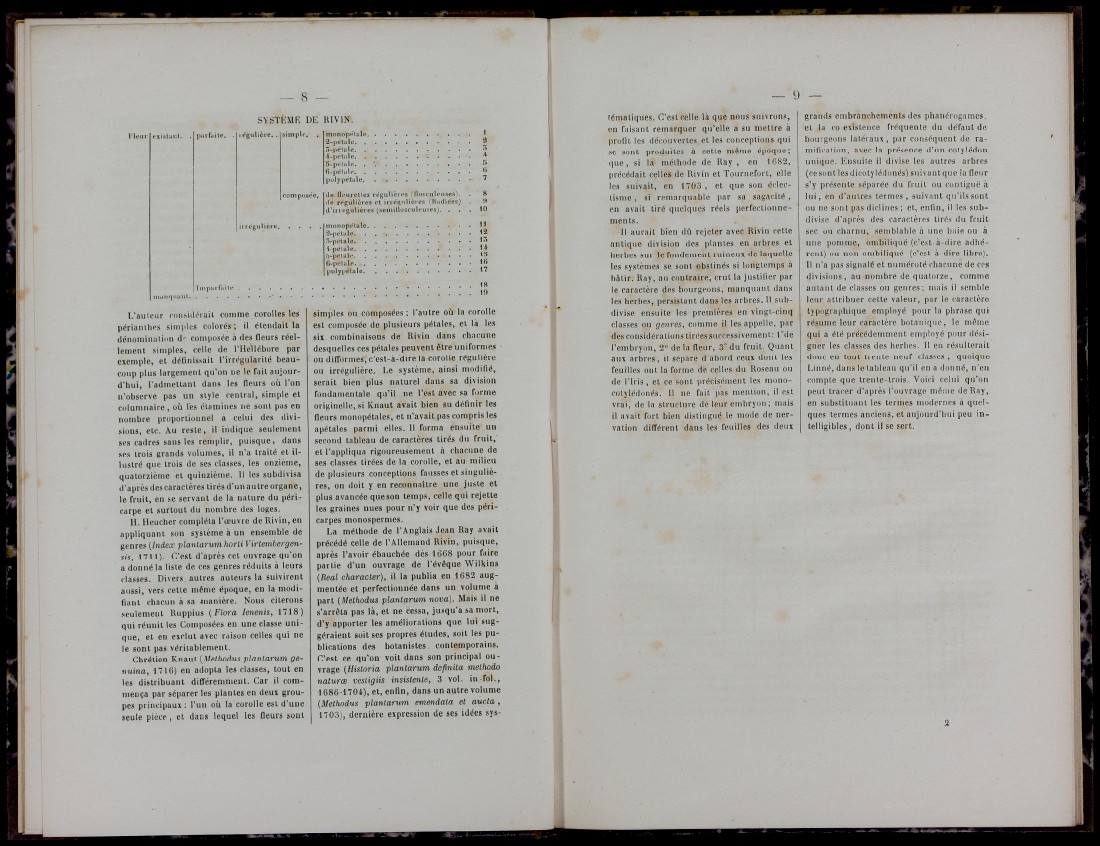
Fleur exislur.t. j)a ifuite. égnlière. . simple.
R I V I N .
1
2
4
(>
7
composée. de ilcurcties régulières (ilosculeuses).
fie régulières et irré^nlières (H;idiées)
d'irregulières (semiilosculeuses). . .
irregulière. monopélale.
^-pélîile. .
ô-pelale.
4-péiale. .
.^-pelalti.
6-pelale. .
polypélale.
Itiipa r
. . .
L'auteur consiiloraii comme corolles les
périaiiihes simples colorés; il étendait la
dénomination d^^ composée à des fleurs réellement
simples, celle de l'Hellébore par
exemple, et définissait Tirrégulariié beaucoup
plus largement qu'on ne le fait aujourd'hui,
l'admettant dans les fleurs où l'on
n'observe pas un style central, simple et
columnaire , où les eiamines ne sont pas en
nombre proportionnel a celui des divisions,
etc. Au reste, il indique seulement
ses cadres sans les remplir, puisque, dans
ses trois grands volumes, il n'a traité et illustré
que trois de ses classes, les onzième,
quatorzième et quinzième. Il les subdivisa
d'après des caractères tirés d'un autre organe,
le fruit, en se servant de la nature du péricarpe
et surtout du nombre des loges.
H. Heucher compléta l'oeuvre de Rivin, en
appliquant son système à un ensemble de
genres (Index planlarum horti Virtembergensis,
1711). C'est d'après cet ouvrage qu'on
a donné la liste de ces genres réduits à leurs
classes. Divers autres auteurs la suivirent
aussi, vers cette même époque, en la modifiant
chacun à sa inanière. Nous citerons
seulement Ruppius (Flora lenenis, 1718)
qui réunit les Composées en une classe unique,
et en exclut avec raison celles qui ne
le sont pas véritablement.
Chrétien ICnaut {Methodus plantarum genuina,
1716) en adopta les classes, tout en
les distribuant difl'éremnient. Car il commença
par séparer les plantes en deux groupes
principaux: Tuu où la corolle est d'une
seule pièce, et dans lequel les fleurs sont
S
9
10
11
12
15
14
lo
16
17
18
19
simples ou composées: l'autre où la corolle
est composée de plusieurs pétales, et là les
six combinaisons de Rivin dans chacune
desquelles ces pétales peuvent être uniformes •
ou difl'ormes, c 'es t -à-di r e la corolle régulière
ou irrégulière. Le système, ainsi modifié,
serait bien plus naturel dans sa division
fondamentale qu'il ne l'est avec sa forme
originelle, si Knaut avait bien su définir les
fleurs monopétales, et n'avait pas compris les
apétales parmi elles. 11 forma ensuite un
second tableau de caractères tirés du fruit,
et l'appliqua rigoureusement à chacune de
ses classes tirées de la corolle, et au milieu
de plusieurs conceptions fausses et singulières,
on doit y en reconnaître une juste et
plus avancée queson temps, celle qui rejette
les graines nues pour n'y voir que des péricarpes
monospermes.
La méthode de l'Anglais Jean Ray avait
précédé celle de l'Allemand Rivin, puisque,
après l'avoir ébauchée dès 1668 pour faire
partie d'un ouvrage de l'évêque Wilkins
{Real character), il la publia en 1682 augmentée
et perfectionnée dans un volume à
part {Methodus plantarum nova). Mais il ne
s'arrêta pas là, et ne cessa, jusqu' à sa mort,
d'y apporter les améliorations que lui suggéraient
soit ses propres études, soit les publications
des botanistes. contemporains.
C'est ce qu'on voit dans son principal ouvrage
{Historia plantarum definita méthode
naturoe vestigiis insistente, 3 vol. in-fol.,
1686-1704), et, enfin, dans un autre volume
{Methodus planlarum emendata et aucta ,
1703), dernière expression de ses idées sysy
iématiques. C'est celle là que nous suivrons,
en faisant remarquer qu'elle a su mettre à
profit les découvertes et les conceptions qui
se sont produites à cette même époque;
q u e , si la mét.hode de Ray, en 1682,
précédait celles de Rivin et Tournefort, elle
les suivait, en 1703, et que son éclectisme,
si remarquable par sa sagacité,
en avait tiré quelques réels perfectionnements.
11 aurai t bien dû rejeter avec Rivin cette
antique division des plantes en arbres et
herbes sur le fondement ruineux de laquelle
les systèmes se sont obstinés si longtemps à
bâtir. Ray, au contraire, crut la justifier par
le caractère des bourgeons, manquant dans
les herbes, persistant dans les arbres. Il subdivise
ensuite les premières en vingt-cinq
classes ou genres, comme il les appelle, par
des considérations tirées successivement: Tde
l'embryon, 2° de la fleur, 3" du fruit. Quant
aux arbres, il sépare d'abord ceux dont les
feuilles ont la forme de celles du Roseau ou
de r iris, et ce sont précisément les monocotylédonés.
Il ne fait pas mention, il est
vrai, de la structure de leur embryon ; mais
il avait fort bien distingué le mode de nervation
difl'érent dans les feuilles des deiix
grands embranchements des phanérogames,
et la co existence fréquente du défaut de
bourgeons latéraux, par conséquent de ramificauon,
avec la présence d'un cotylédon
unique. Ensuite il divise les autres arbres
(ce sont les dicotylédonés) suivant que la fleur
s'y présente séparée du fruit ou conllguc à
l u i , en d'autres termes, suivant qu'ils sont
ou ne sont pas diclines ; et, enfin, il les subdivise
d'après des caractères tirés du fruit
sec ou charnu, semblable à une baie ou à
une pomme, ornbiliqué (c'est-à-dire adhérent)
ou non ornbiliqué (c'est-à-dire libre).
Il n'a pas signalé et numéroté chacune de ces
divisions, au nombre de quatorze, comme
autant de classes ou genres; mais il semble
leur attribuer cette valeur, par le caractère
typographique employé pour la phrase qui
résume leur caractère botanique, le même
qui a été précédemment employé pour désigner
les classes des herbes. Il en résulterait
donc en tout trente-neuf classes, quoique
Linné, dans le tableau qu'il en a donné, n'en
compte que trente-trois. Voici celui qu'on
peut tracer d'après l'ouvrage même de Ray,
en substituant les termes modernes à quelques
termes anciens, et aujourd'hui peu intelligibles,
dont il se sert.
m