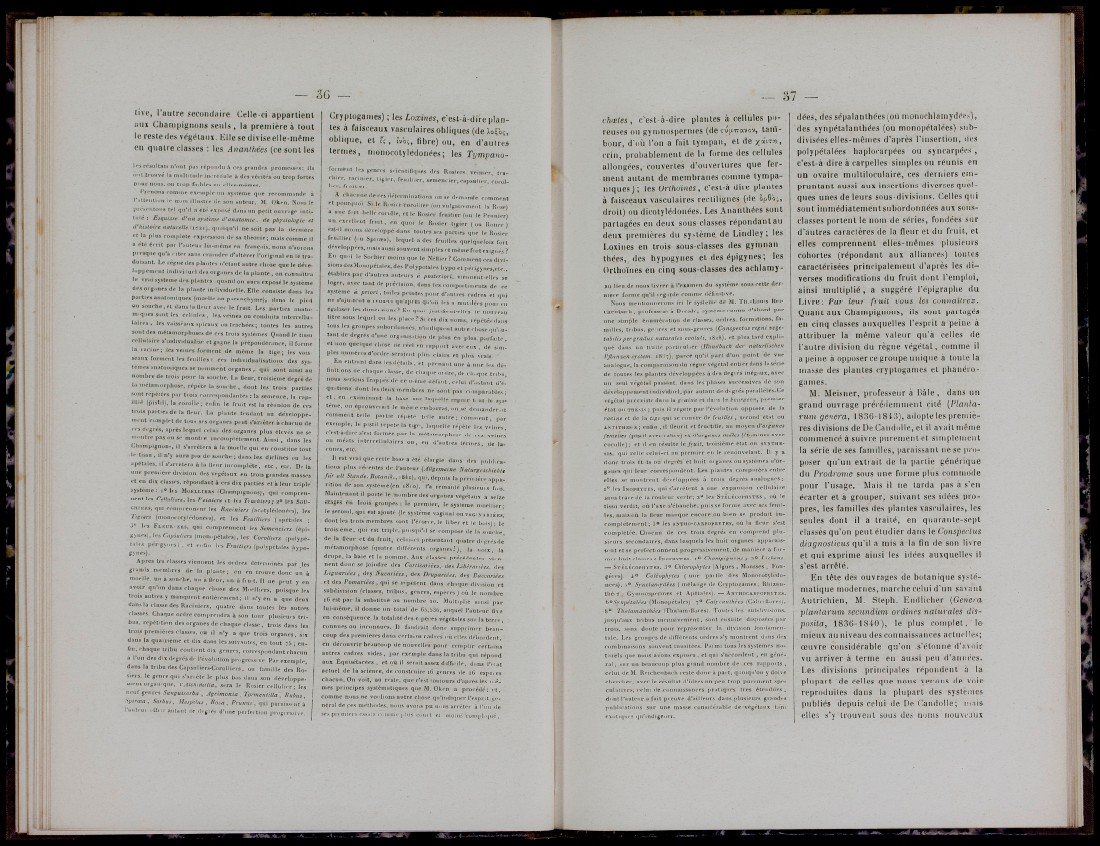
li '
; ì
1
1 Í
ij'G
tíve, l'autre secondiiire Celle-ci appartienl
;mx ChariipigijoMs seuls , la première à tout
le reste (les végétaux. El le se diviseelle-mème
en quatre classes : les Ananthées (ce sont les
Ji's r r s i iUa u n'ont pas rcpoiulu à ces giandrs promp.ss<>s: ils
t>)it t rouvé la nni l i i i iul o inrrcdul p à des vérités ou trop fortes
p n u r nous, ou tiup { .„h\ fs en clii-s-nièmes.
l ' r c n a n s cointne exfinpi f iiti système que rerocnmnmie à
r . i l t e i n i u n le nom jtlustrr uc son laiteur. M. Okcn. Nous k
p i «'sciitotis <]ii'il n (-tt- expos é d.ms un peiit ouvn.ge intitn
Ie : £squi.ise d'un systemf d'anatomie . de physiologie et
d'histoire natitrelle iinm^nW ne soi t pas la dernière
v t In plus coiïiptele cxptessiou de sa théorie; niais c omme il
a été é. i it pn. l'.uteur lui-u.ème eu fnmr.is. nous n'auions
p i e s q i i c qu' a - i t e r sans rraindre d'i.ltérer (''original en letra-
( i u i s a n t . Le réi iuedes plantes i.'etaut autre c h o s e que le dével
u p p e u i c n t iudivi lue! des o . g . n e s de la p U n t e , on Connaîtra
l e vrai systeoi e des punî tes qui.nd on aura exposé le système
d e s o r g . n e s de ta plante in Uviduel le. El l e consiste dans les
p a r t i e s anatnn. iques (moelle ou parenchyme) , dans le pied
o u souche,et dans la Ileiir avec le fruit. Les parties anatom
i q i . e s s . H i t les cellules, veines ou condiiils intcrcellul
a i r e s , les vaiss.-aux spi raux uu trachées ; tontes les autres
s o n t des niétauiorphoscsdp ces troi s systèmes Quand le tissu
c e l l u l a i r e s'individualise et gagne la prépondérance, il forme
la racine; les veines forment de même la tij-e; les vaiss
e a u x forment les feuilles : ces individualisatiouJ des syst
è m e s annou. ique s se m -mme n t organes , qui sont ainsi an
n o m b r e de trois pour la souche. La fleur, troisième degré de
l a n>étamori)hGse, répété ia snu( he , dont les trois parties
s o n t répétées par trois coi r e spóndanl e s : la semence, la caps
u l e (pistil), la corol le; eufin le fruit est la réunion de ces
i r o i s parties d e la fleur. La plante tendant au développenu
nt complet de tuu^ ses o igane s peut s 'ane t e r à cha cun de
c e s degrés, après lequel celui des organes plus élevés ne se
m o n t r e pas on se montre luromplétement. Ainsi , dans les
i : h a m p i g n o n > , il s'arrêtera à la moel l e qui en constitue tout
l e tissu , il n' y aura pas de sunche ; d ans les diclines ou les
a p é t a l e s , il s'arrêtera à la (leur incomplète, etc, etc. Delà
u n e pren.ière division des végétaux en trois g randes masses
e t en dix classes, r épondant à ces d i x parties et à leur triple
s y s t è m e : i« h s MOELHERS (Champignons;, qui comprenn
e n t les C e l l u l i e r s . l e s F e i n i c r s e t les T r a c h i a s ; 2 ° les Souc
n r K n s , qui comprennent les Raciiiiers (acutylédonées), les
Tigiars {rnonocotylédonées), et les Feuilliers (apétales ;
3 " les FL E U R - E K S , qui compr ennent [es Semenci,'rs (é p i -
g j n e s ) , les (m o n o p é t a l e s ) , les CorolUers (polypét
a i e s pér.gyues), et eníin les F/",n'iûr, (poUpétales hynog
y n e s ) .
A p r e s les classes v iennent les ordres déterminés par les
g r a n d s membres de la plante; on en trouve donc un à
m o e l l e , uu à souche, u.i à fl-ur, un à f iu- t . H ne peut y en
a v o i r qu'irn dans chaque classe des Moelliers, puisque les
t r o i s autres y manquent entièrement; il n'y en a que deux
d a n s la classe des R a c n u e r s , quatre dans toutes les autres
c l a s s e s . Chaque ordre comprendr a à son tour plusieurs trib
u s , répétition des o rganes de chaque classe, trois dans les
t r o i s p remières classes, ou il n'y a que trois organes, six
d a n s la quai r ieme et dix dans les suivantes , en tout -¡b ; enfin,
chaque tribu contient dix genres, correspondant chlcun
a l'un des dix degrés û> l 'évolution progressive Par exemple,
d a n s la tribu des Capsnl iers-Gorol l iers, ou famille des Ros
i e r s , le genre qui s 'anèt e le plus bas dans son développem
e n t organique, VJlc / iimilla, sera le Rosier cellulier ; les
genres Sa?iguisorba , J g r i t n o n i a . Tormentiiia , l i u L s ,
S p i r oe a , Sorèus, Mcspifus , liosa , P m m » , q u i parai s sant à
r - . u . t e u i ..iùir autant de <le^Mos d'une perfettion progressive.
Cryptogames) ; les Loccines, e'esl-à-dire plantes
à faisceaux vasculaires obliques (de
oblique, et Tç, tVo^, fibre) ou, en d'autres
termes, nionocotylédonêes; les Tympanof
o r m e n t les genres seientiiïqnes des Rosiers veinier, tiar
l i i e r . racinier, tigicr, feuiliier, semencier.capsul ier, coroll
i r r , fruitier.
A chaeunedeces déterminations on se demande rummen!
e t pourquoi Si le Rnsi^r corol l ier (ou vul^iairemont la Rose)
a une fort belle eorolle, et le Hosier fruitier (ou le l'ruuier)
i m excellent fruit, en quoi le Ro.sier tigier (ou Rnnce )
e s l - i l moins développé dans toutes ses parties que le Rosier
f e u i l i i e r (ou Spiiaea), lequel a des feuilles quelquefois fort
d é v e l o p p é e s , mais aussi s ouv ent s imples et m ême for t e x i gné s ?
E n quoi le Sorbier moins que le Néilier? Comment ces divis
i o n s des M o n o p é t a l e s , des Fol ype t a l e s bypoetpériëynes,eic..
é t a b l i e s par d'autres auteurs à posteriori, viennent-elles se
l o g e r , avec tant de précision, dans les eompart i ineut s de ce
s y s t è m e à priori , U> \Us pñutes pour d'antres cadres et qui
n e s'ajustent a ceux-ci qu'après qu'on les a muti lées pour en
é g a l i s e r les d imc i s.ons> En quoi justifient-elles le nouveau
t i t r e sous lequel on les p l a c e t s , ces dix noms, répété., dans
t o u s les groupes subordonnés, n'iudiquent antre rhoseqnVut
a n t de degrés d'une organisation de plus en plus parfaite ,
e t non quelque chose de réel en rappoit avec eux , de simp
l e s numéros d 'ordr e seraient plus clairs et plus vrais
E n entrant dans les d é t a i l s , et prenant une à une les définitions
de chaque , la.sse, de chaque oi d r e , de ch.qne trihn
n o u s serions frappés de ce n,éme u é fant , celui d'a...tant d'éq
u a t i o n s dont l e sdeuxmembi e s ne sont pas comparables;
e t , en examinant la base snr laquelle repose t. ut le sist
e m e , on éprouveiai t le même embarras, on se demander",it
c o m m e n t telle partie répète telle autre ; c omme n t , par
e x e m p l e , le pistil répété la t ige, laquelle répète les veines,
c ' e s t - à - d i r e s'e.si formée par la métamorphose de ces veines
o n méats intercellulaires on, en d'autres termes, de lac
u n e s , etc.
Il est vrai que cette hase a été élargie dans des publicat
i o n s i.Uis récenles de l'auteur {Altgcimine lyaeurgcsc / iic / itg
fur i,U Staude. Botanilx., i84x), qui , d epui s la p remièr e appar
i t i o n de son système(en 18,0), l'a remanié plusieuis fois.
M a i n t e n a n t il porte le nombre des u rganes végétaux à seize
é t a g e s en trois groupes: le premier, le sys tème moellier;
te second, qiii est ajouté (le sys t ème vaginal ou VAG-^ A M ÉES',
d o n t les trois membres sont l'écoree, le liber et le bois) ; le
t r o i s i è m e , qui est trijile, puisqu' i l se compose de la souche
d e la fleur et du fruit, celui-ci présentant quatre d- f;résde'
m é t a m o r p h o s e (quatre différents organes!), la noix, la
d r u p e , la baie et la pomme . Aux classes précédentes vienn
e n t donc se joindre des Cortican 'ées^ des J^ibérfiriées, des
Lignariées , d e s N u c a r i é e s , d e s Drupariées, de s Baccariées
e t des Pomariées , qui se répètent dans chaque division et
s u b d i v i s i o n (classes, tribus, g e n r e s , espèces) où le nombre
1 6 est par là substitué au nombre 10. Multiplié ainsi par
l u i - m ê m e , il donne un total de au q u e l l'auteur fixe
e n conséquence la totalité des e.^peces végétales sur la t e n e,
c o n n u e s ou inconnues. Il faudrait donc supprimer beauc
o u p des p r emi è r e sdans certains cadres on el les débordent,
e n découvrir beaucoup de nouvel les pour remplir certains
a n t r e s cadres vides, par exempl e dans la tribu qui répond
a u x Éqnisétacées , et où il serait assez di f f ici le, dans l'eiat
a c t u e l de la science, de construire 16 genres de i6 espei es
c h a c u n . On voit, au reste, que c'e.st toujour s d'après les n émes
principes systématiques que M. Oken a procédé: et,
c o m m e nous ne voi-lions autre cho.se qu' indiquer l'espi :t gén
é r a l de ces méthodes, TIOUS a v ons pu nous arrêter à l'iin de
se.s p r emi e r s ess^.is c omme |,ltis coui t ci moins Cutnid.qué,
— â7
chBles, c'est-à-dire piaules à cellules poreuses
ou gymnosperuies (deTV,tJ.'n:avov, tambour,
d'où Ton a f;iit lyrupan, et de
criu, probablement de la forme des cellules
allongées, couvertes d'ouvertures que ferment
autant de membranes comme lympau
i q u e s ) ; les Ortho'ines, c'est-à dire piaules
à faisceaux vasculaires recliligues (de opGo;,
droit) ou dicotylédonées. Les Anantbées sont
partagées eu deux sous classes répoudantau
deux premières du système, de Lindley; les
Loxines en trois sous-classes des gymnan
thées, des hypogynes et des épigynes; les
Onhoïnes en cinq sous-classes des achlamynu
lieu de nous l ivrer à l 'examen du système sous cet te derr
i è r e forme qu'il leg^.rde comme <Iéfiiiitive,
N o u s mentionnerons ici le système de M. Th. -Loui s Keic
l i e n b a < - h , professeur à IDt e s d e , système eoiinu d'abord par
u n e simple énumération de classes, ordres, formiitions, fam
i l l e s , tribus, genres et sous-genres (Conspectus regni vegetubilispergradus
nalurales evohiti, 18x8), et plus tard expliq
u é dans un traité particulier {Hïuidbuck der naturlischen
¡'Jlanzen-system. 18!7), parce qu'il part d'un poitit de vue
a n a l o g u e , la comimr a i so n du régne végétal ent ierdans lasérie
d e toutes les plantes développées à des degiés inégaux, avec
u n seul végétal passant, dans les phases successives de son
d é v e l o p p e m e n t i n d i v i d u e l , par dulant de degrés parallèles.Ce
v é g é t a l préexiste dans la graine et dans le bourgeon^ premier
é t a t ou THii.si,s ; pui s il végète par l'évolution opposée de In
racine et de la tige qui se couvr e de feuilles , second état ou
ANTITHESES ; enf i n , il lleurit et fruct i f ie, an moyen ù'organes
femelles (pistil avec calice) et organes males (étiimines avec
c o r o l l e ) ; et il en résulte le fruit, troisième état ou SYNTHESTS,
qui relie celui-ci au premier en le renouvelant. Il y a
d o n c trois ét..is ou degrés et huit organes ou systèmes d'org
a n e s qui leur correspondent. Les planf'S comparées entre
e l l e s .se montrent développées à trois degrés analogues :
l e s INOPHYTES, qui .s'ariètent à une expan.sion cellulaire
s a n s traee de la couleur verte; les STKLÉCOI-HYTES , oii !e
t l s s n verdit, où- l ' a x e s'ébauche, pui s se forme avec ses feuill
e s , mai s o ù la fleur manque encore ou bien se produit inc
o m p l è t e m e n t ; 30 les ANTUO-CABPOpiiyTES, OÙ la fleur s'est
c o m p l é t é e . Chacun de ces trois degrés en comprend plus
i e u r s secondaires, dans lesquels les hui t organes apparaiss
e n t e t s e perfectionnent progressivement .de manière a form
e r hui t clas.scs : I K O P I I Y T E S . Champignons ; Lichens.
— STIÎLKCOPMÎTES. 30 Chlorophytes (Algues , Mousses , Foug
è r e s ) - Coléuphyles (une partie des Monocotylédon
é e s ) . Synclamydées ( m é l a n g e de Cryptogames. Rhizanthé'
S , Gymnospermes et Apétales). — ATÎTIIOCA-RPOPHYTES,
(>^Synpétalées (M o n o p é t a l e . s ) 70 Calycnnthées (C a h c i f l o r e s j .
- 8 ° Tholamanthées (Thalamiiluiesj. Tout<'S les sul)divi.-,ions,
j u s q u ' a u x tribus inclusivement, sont ensuite disposées par
t r o i s , sans doute pour représenter la division ion<iament
a l c . Les groupes de différents ordres s'y montrent dans des
c o m b i n a i s o n s souvent inusitées. Paimi tous les s y s t ème s nat
i i r e l s que nuus avons exposés, et qui s'accordent , en géné-
)'al , .sur un beaucoup plus grand nombre de ces rappoits ,
c e l u i de M. Reichenbach l e s t e donc à p a r t , quoiqu'on y doive
c h e r t i i e r , avec ie résultat d'idées un peu trop purement spéc
u l a t i v e s , celui de cunnaissancps pratiques très étendues,
d o n t l'autcnr a fai t p reuve d'ailleurs dans plusieurs grandes
p u b l i c a t i o n s sur une masse considérable de végétaux ta'm
e x o l i ( i n e . 5 (ju'iudigcner.
dées, des sépalanlhées (ou monocîilamydi^iv';),
des synpétalanlhées (ou monopétalées) subdivisées
elles-mêuies d'après Tiusertion, des
polypéialées haplocarpées ou syncarpées ,
c'est-à dire à carpelles simples ou réunis en
u n ovaire mulliloculaire, ces derniers empruntant
aussi aux insertions diverses quelques
unes de leurs sous-divisions. Celles qui
sont immédiatementsubordonnées aux sousclasses
portent le nom de séries, fondées sur
d^autres caractères de la fleur et du fruit, et
elles comprennent elles-mêmes plusieurs
cohortes (répondant aux alliances) toutes
caractérisées principalement d'après les diverses
modifications du fruit dont remploi,
ainsi multiplié, a suggéré l'épigraphe du
L i v r e : Par leur fruit vous les conyiaîtrez.
Quant aux Champignons, ils sont partagés
en cinq classes auxquelles l'esprit a peine à
attribuer la même valeur qu'à celles de
l'autre division du règne végétal, comme il
a peine à opposer ce groupe unique à toute la
masse des plantes cryptogames et phanérogames.
M. Meisner, professeur à Baie, dans un
grand ouvrage précédetnmeul cité {Plantarum
genera, 1836-18Ì3), adopte les premières
divisions de De Caïuiol le, et il avait même
coiumencé à suivre purement et simplement
la série de ses familles, paraissant ne se jiroposer
qu'un extrait de la partie générique
du Prodrome sous une forme plus commode
pour l'usage. IMais il ne larda pas à s'en
écarter et à grouper, suivant ses idées propres,
les familles des plantes vasculaires, les
seules dont il a traité, eu quarante-sept
classés qu'on peut étudier dans \e Conspectus
diagnosticus qu'il a mis à la fin de son livre
et qui exprime ainsi les idées auxquelles ú
s'est arrêté.
E u tête des ouvrages de botanique systématique
modernes, marche celui d'un savant
Autrichien, M. Steph. Endlicher {Genera
plantaì'um secundùm ordinos naturales disposüa,
1836-1840), le plus complet, lemieux
au niveau des connaissances acUu-iles;
oeuvre considérable qu'on s'étonne d'avoir
vu arriver à terme en aussi peu d'années,
l.es divisions principales répondent à la
plupart de celles que nous venons de voir
reproduites dans la plupart des systèiues
publiés depuis celui de De Candolle;
el!C5 s'y trouvent sous des noms nouveaux
i i liit -