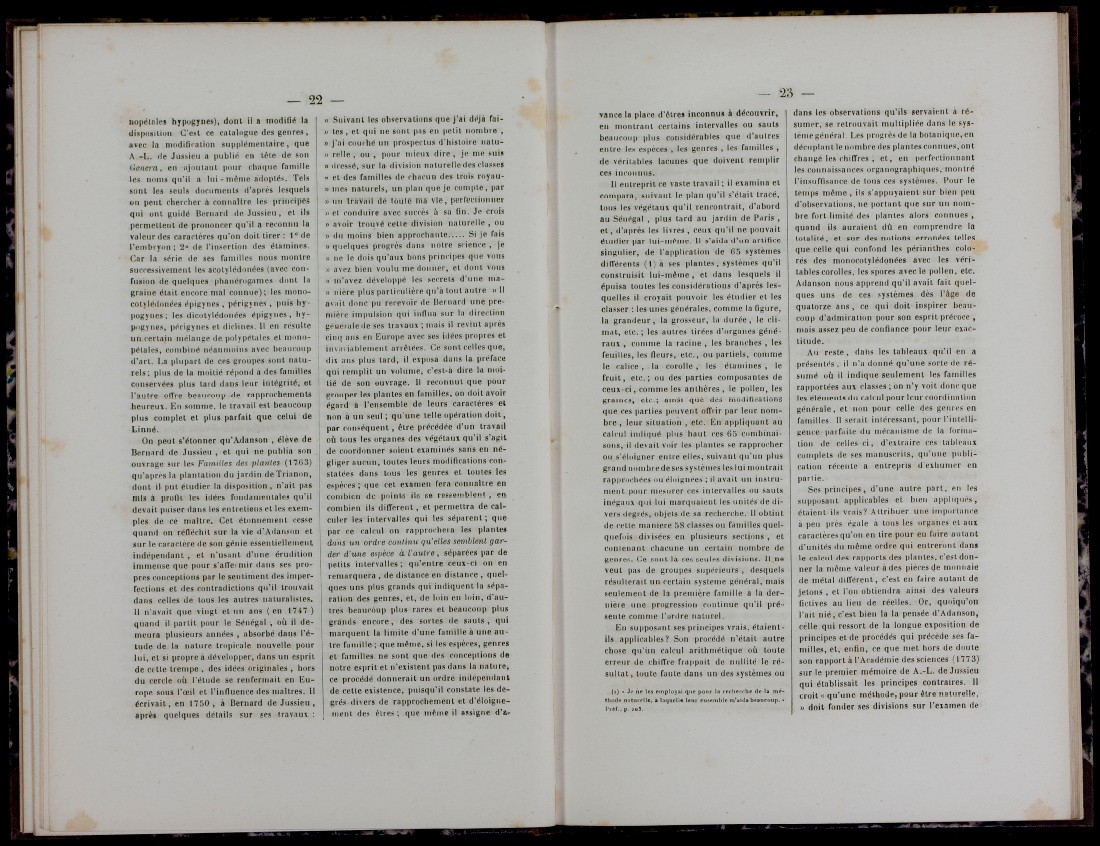
\
» o p é t j i l e s hypogynes), dont il a rnodiiié la
liisposilion. C'est ce calalogue des genres,
avec la rnodiiication snpplértienlaire, que
A . - L . <!e Jiissieii a publié en lête de son
( l e n e r a , en ¡ijimiant pour chaque famille
les noms quMl a hii - m ême adoptés. Tels
s o n t les seuls documeuLs d'après lesquels
o u peut chercher à coimaUre les principes
qui ont guidé Bernard deJussieu, et ils
p e r m e l l e n t de prononcer qu'il a reconnu la
v a l e u r des caractères qu'on doit tirer : 1 " de
l ' e m b r y o n ; 2° de l'insertion des étamincs.
Car la série de ses familles nous montre
s u c c e s s i v e m e n t les acotylédonées (avec conf
u s i o n de quelques [)hanérogames dont la
g r a i n e était encore mal connue); les monoc
o t y l é d o n é e s épi^iynes , périgynes , puis hyp
o g y n e s ; les dicotylédonées épigynes, hypogynes,
périgynes et diclines. li en résulte
u n certain mélange de polypétales et nïonopétah'S,
combiné néanmoins avec beaucoup
d ' a r t . La plupart de ces groupes sont natur
e l s ; plus de la miutié répond a des familles
Ci)nservées plus tard dans leur intégrité, et
l ' a u t r e ofVre beancoup de rapprochements
h e u r e u x . Eti somme, le travail est beaucoup
p i n s complet et plus parfait que celui de
L i n n é .
On peut s'étonner qu'Adanson , élève de
B e r n a r d de Jussieu , et qui ne publia son
o u v r a g e sur les Familles des plantes (17-63)
q u ' a p r è s la plantation du jardi n de Trianon,
d o n t il put étudier la disposition, n'ait pas
mis à profit les idées fondamentales qu'il
d e v a i t puiser dans les ent ret iens et les exemples
de ce maître. Cet étonnement cesse
q u a n d on réfléchit sur la vie d'Adanson et
s u r le caractèr e de son génie essentiellement
i n d é p e n d a n t , et n'usant d'une érudition
i m m e n s e que pour s'aiVemiir dans ses prop
r e s conceptions par le s e n t ime n t des imperf
e c t i o n s et des contradictions qu'il trouvait
d a n s celles de tous les autres naturalistes.
11 n'avai t que vingt et un ans ( en 1747 )
q u a n d il partit pour le Sénégal , où il dem
e u r a plusieurs années , absorbé dans l'ét
u d e de la ïiature tropicale nouvelle pour
l u i , et si propre à développer, dans un esprit
d e cft t e t rempe , des idées originales , hors
d u cercle où l'étude se renfermait en Eur
o p e sous l'oeil et l'influence des maîtres. 11
é c r i v a i t , en 1750 , à Bernard deJussieu,
a p r è s quelques détails sur ses travaux :
« Suivant les observations que j'ai déjà fai-
» les, et qui ne sont pas en [)etit nombre ,
)) j 'ai couché un prospectus d'histoire natu-
» relie, ou , pour niieux dire, je me suis
» dressé, sur la division naturelle des classes
» et des familles de chacun des trois royau-
» mes naturels, un plan que je compte, par
» nn travail de toute ma vie, perfectionner
)> et conduire avec succès à sa fin. Je crois
» avoir trouvé celte division naturelle , ou
» dti moins bien approchante Si j e fais
» q u e l q u e s progrès dans noire science, je
» ne le dois qu'a\ix bons principes que vous
)) avez bien voulu me donner , et dont vous
)> m'ave z développé les secrets d'une ma-
» nière plus part icul ière qu' à tout ant r e »11
avnit donc pu recevoir de Bernard une prem
i è r e impulsion qui influa sur la direction
g é u c r a l e de ses travaux ; mai s il revint après
: cinq ans en Europe avec ses idées propres et
i n v a r i a b l e m e n t arrêtées. Ce sont celles que,
i dix ans plus tard, il exposa dans la préface
qui remplit un volume, c'est-à dire la moitié
de son ouvrage. 11 reconnut que pour
g r o u p e r les plantes en famiUes, on doit avoir
é g a r d à l'ensemble de leurs caractères ei
non à un seul ; q u ' u n e telle opérat ion doit,
pa-r cons équent , être précédée d'un travail
o ù tous les organes des végétaux qu'il s'agit
d e coordonner soient examinés sans en négliger
aucun, toutes leurs modifications cons
t a t é e s dans tous les genres et toutes les
e s p è c e s ; que cet examen fera connaître en
combien de points ils se ressemblent, en
c o m b i e n ils different , et permettra de calc
u l e r les intervalles qui les séparent; que
p a r ce calcul on rapprochera les plantes
dans un ordre continu qu'elles semblent gardei'
d'une espèce àl'a.ulre, séparées par de
p e t i t s intervalles; qu'entre ceux-ci on en
r e m a r q u e r a , de dislance en dislance , quelques
uns plus grands qui indiquent la sépar
a t i o n des genres, et, de loin en loin, d'aut
r e s beauc6up plus rares et beaucoup plus
g r a n d s encore, des sortes de sauts, qui
m a r q u e n t la limite d'une famille à une aut
r e fami l le; que même , si les espèces, genres
e t familles ne sont que des conceptions de
n o t r e esprit et n'existent pas dans la nature,
ce procédé donnerait un ordre indépendant
d e cette existence, puisqu'il constate les degrés
divers de rapprochement et d'éloigné^
mont des êires ; que lïiême il assigne d'ar
vance la place d'êtres inconnus à découvrir,
en montrant certains intervalles ou sauts
b e a u c o u p plus considérables que d'autres
e n t r e les esjtèces , les genres , les familles ,
d e véritables lacunes que doivent remplir
ces incoiiims.
Il ent repr i t ce vaste travail ; il examina et
c o m p a r a , suivant le plan qu'il s'était tracé,
tous les végétaux qu'il rencontrait, d'abord
a u Sénégal , plus tard au jardin de Paris ,
e t , d'après les livres, ceux qu'il ne pouvait
é t u d i e r par lui-même. Il s'aida d'un artifice
s i n g u l i e r , de Tapplicalion de 65 systèmes
d i f i e r e n t s (1) à ses plantes, systèmes qu'il
c o n s t r u i s i t lui-même, et dans lesquels il
é p u i s a toutes les considérat ions d'après lesq
u e l l e s il croyait pouvoir les étudier et les
classe r : les unes générales, comme la figure,
la grandeur, la grosseur, la durée, le clim
a t , etc.; les autres tirées d'organes génér
a u x , comme la racine , les branches , les
f e u i l l e s , les fleurs, etc., ou partiels, comme
le calice , la corolle , les étamines , le
f r u i t , etc.; ou des parties composantes de
c e u x - c i , comme les anthères , le pollen, les
g r a i n e s , etc.; ainsi que des modifications
q u e ces parties peuvent offrir par leur nomb
r e , leur situation , etc. En appliquant au
calcul indii^ué plus haut ces 65 Citmbinaisons,
il devai t voir les plantes se rapprocher
ou s'éloigner entre elles, suivant qu'un plus
g r a n d nombr e de ses sys tèmes les lui montrait
rapproi',hées ou éloignées ; il avai t un instrum
e n t pour mesurer ces intervalles ou sauts
i n é g a u x qiii lui marquaient les uni tés de divers
degrés, objets de sa recherche. Il obtint
d e cette rnaniere 58 classes ou familles quelq
u e f o i s divisées en plusieurs sections , et
c o n i e n a n t chacune un certain nombre de
g e n r e s . Ce sont là ses seules divisions. Il ne
v e u t pas de groupes supérieurs , desquels
r é s u l t e r a i t un certain systerne général, mais
s e u l e m e n t de la pretnière famille à la dern
i è r e une progression contitme qu'il prés
e n t e con)me l'ordre naturel.
Eu supposant ses principes vrais, étaientils
applicables? Son procédé n'était autre
chose qu'iin calcul arithmétique où toute
e r r e u r de chiiTre frappait de nullité le rés
u l t a t , tout e faute dans un des systèmes ou
(i) • Je ne les employai que pour la recherrhe de la méthode
nritiirrllc, à laqucll« leur ctisenibic m'uiila beaucoup. >
Préf.. p. 2o3.
d a n s les observations qu'ils servaient à rés
u m e r , se retrouvait multipliée dans le système
général . Les progrès de la botanique, en
d é c u p l a n t le n omb r e des plantes connues , ont
c h a n g é les chiffres , et, en perfectionnant
les connaissances organographiques, montré
l ' i n s u f f i s a n c e de tous ces systèmes. Pour le
temps même , ils s'appuyaient sur bien peu
d ' o b s e r v a t i o n s , ne portant que sur un nomb
r e fort limité des plantes alors connues,
q u a n d ils auraient dû en comprendre la
t o t a l i t é , et sur des notions erronées telles
q u e celle qui confond les périanthes colorés
des monocotylédonées avec les vérit
a b l e s corolles, les spores avec le pollen, etc.
Adanson nous apprend qu'il avait fait quelq
u e s uns de ces systèmes dès l'âge de
q u a t o r z e ans, ce qui doit inspirer beaucoup
d'admiration pour son esprit précoce ,
mais assez peu de confiance pour leur exact
i t u d e .
Au reste, dans les tableaux qu'il en a
p r é s e n t é s , il n'a donné qu'une sorte de rés
u m é où il indique seulement les familles
r a p p o r t é e s aux classes ; on n'y voit donc que
les é lément s du calcul pour leur coordination
g é n é r a l e , et non pour celle des genres en
f a m i l l e s . Il serait intéressant, pour rintelligence
parfaite du mécanisme de la formation
de celles-ci, d'extraire ces tableaux
c o m p l e t s de ses manuscrits, qu'une public
a t i o n récente a entrepris d'exhumer en
p a r t i e .
Ses principes, d'une autre part, en les
s u p p o s a n t applicables et bien appliques,
é t a i e n t ils vrais? Attribuer une importance
à peu près é^ale à tous les organes et aux
c a r a c t è r e s qu'on en lire pour en faire autant
d ' u n i t é s du même ordre qui entreront dans
le calcul des rapports des plantes, c'est donn
e r la même valeur à des pièces (Je moiuiaie
d e métal dilTérent, c'est eu faire autant de
j e t o n s , et l'on obtiendra ainsi des valeurs
fictives au lieu de réelles. Or, quoiqu'on
l ' a i l nié, c'est bien là la pensée d'Adanson,
celle qui ressort de la longue exposition de
p r i n c i p e s et de procédés qui précède ses fam
i l l e s , et, enfin, ce que met hors de doute
son rapport à l 'Académi e des sciences (1773)
s u r le premier mémoire de A.-L. de Jussieu
q u i établissait les principes contraires. II
c r o i t qu'une méthode, pour être naturelle,
» doit fonder ses divisions sur l'examen de