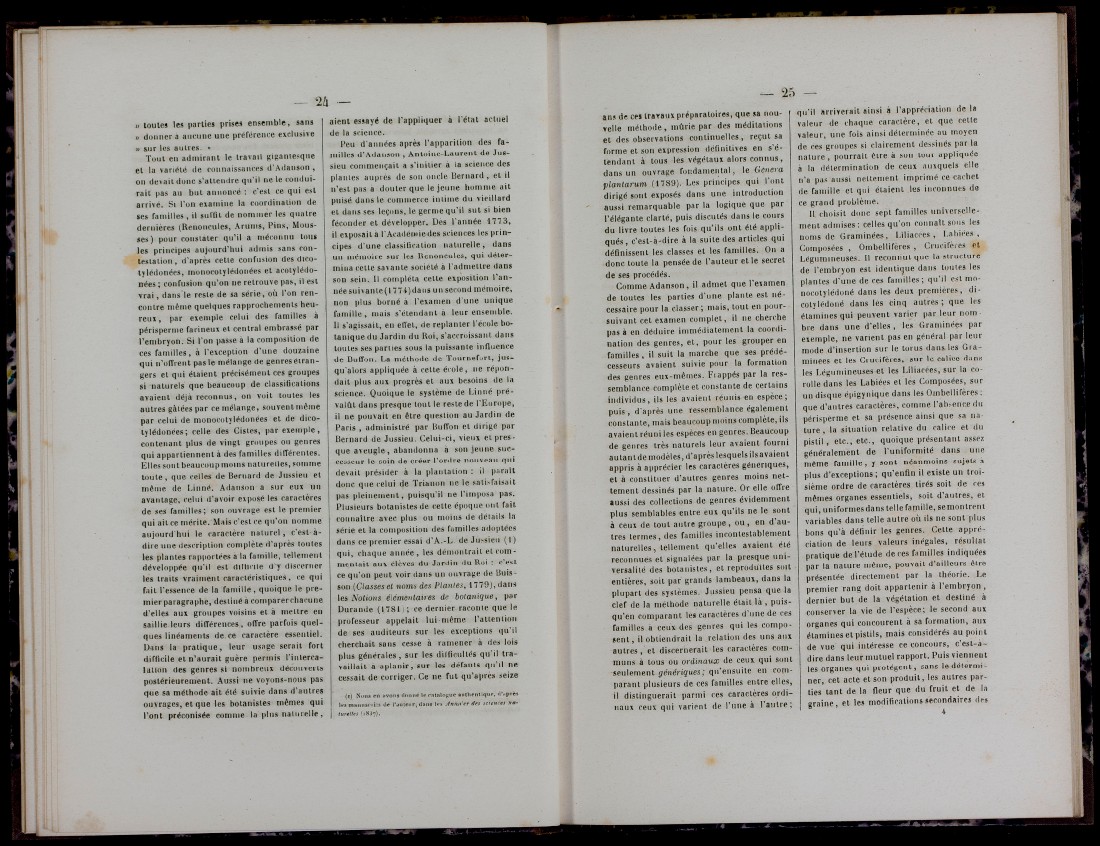
- 2/1
i) toutes les parties prises ensemble, sans
» donner a aucune une préférence exclusive
» sur les autres. "
Tout en admirant le travail gigantesque
et la vanéLé de connaissances d'Adanson ,
ou devait donc s^altendre qu^il ne le conduirait
pas au but annoncé : c'est ce qui est
arrivé. Si l'on exaniine la coordination de
ses familles , il suITU de nommer les quatre
dernières (Renoncules, Arums, Pins, Mousses)
pour cousiater qu'il a méconnu tous
les principes aujourd'hui admis sans contestation,
d'après cette confusion des dicolylédonées,
mouocoiylédonées et acoiylédonées
; confusion qu'on ne retrouve pas, il est
v r a i , dans le reste de sa série, où l'on rencontre
même quelques rapprochements heureux,
par exemple celui des familles à
périsperme farineux et central embrassé par
l'embryon. Si Ton passe à la composition de
ces familles, à l'exception d'une douzaine
qui n'offrent pas le mélange de genres étrangers
et qui étaient précisément ces groupes
si naturels que beaucoup de classifications
avaient déjà reconnus, on voit toutes les
autres gâtées par ce mélange, souvent même
par celui de monocotylédonées et de dicotylédonées;
celle des Cistes, par exemple,
contenant plus de vingt groupes ou genres
qui appartiennent à des familles différentes.
Elles sont beaucoup moins naturelles, somme
t o u t e , que celles de Bernard de Jussieu et
même de IJnné. Adanson a sur eux un
avantage, celui d'avoir exposé les caractères
de ses familles; son ouvrage est le premier
qui ait ce mérite. Mais c'est ce qu'on nomme
aujourd'hui le caractère naturel, c'est-àdire
une description complète d'après toutes
les plantes rapportées a la famille, tellement
développée qu'il est difficile d'y discerner
les traits vraiment caractéristiques, ce qui
fait l'essence de la famille, quoique le premier
paragraphe, destiné à comparerchacune
d'elles aux groupes voisins et à mettre en
saillie leurs différences, offre parfois quelques
linéaments de,ce caractère essentiel.
Dans la pratique, leur usage serait fort
difficile etn'aurait guère permis l'intercalation
des genres si nombreux découverts
postérieurement. Aussi ne voyons-nous pas
que sa méthode ait été suivie dans d'autres
ouvrages, et que les botanistes mêmes qui
Pont préconisée comme la plus nainrelle,
aient essayé de l'appliquer à i'élat actuel
de la science.
Peu d'années après l'apparition des familles
d'Adanson , Antoine-Laurent de Jussieu
conirnençait a s'initier à la science des
plantes auprès de son oncle Bernard , et il
n'est pas à douter que le jeune homme ait
puisé dans le commerce intime du vieillard
et dans ses leçons, le germe qu'il sut si bien
féconder et développer. Dès Tannée 1773,
il exposait à l'Acadéitiiedes sciences les principes
d'une classification naturelle, dans
un mémoire sur les Renoncules, qui détermina
cette savante société à l'admettre dans
son sein. Il compléta cette exposition Tannée
suivante( l 774)dans un second mémoire,
non plus borné à Texamen d une unique
f a m i l l e , mais s'étendant à leur ensemble.
Il s'agissait, en elTet, de replanter l'école botanique
du Jardin du Roi, s'accroissant dans
toutes ses parties sous la puissante influence
de BuiTon. La méthode de Tournefort, jusqu'alors
appliquée à cette école, ne répondait
plus aux progrès et aux besoins de la
science. Quoique le système de Linné prévalût
dans presque tout le reste de l'Europe,
il ne pouvait en être question au Jardin de
Paris , administré par BulTon et dirigé par
Bernard de Jussieu. Celui-ci, vieux et pres -
que aveugle, abandonna à son jeune successeur
le soin de créer Tordre nouveau qui
devait présider à la plantation : il paraît
donc que celui de Trianon ne le satisfaisait
pas pleinement, puisqu'il ne Timposa pas.
Plusieurs botanistes de cette époque ont fait
connaître avec plus ou moins de détails la
série et la composition des familles adoptées
dans ce premier essai d'A.-L, de Ju>sieu (I)
qui, chaque année, les démontrait et commentait
aux élèves du Jardin du Roi : c'est
ce qu'on peut voir dans un ouvrage de Buis -
son [Çlasseset noms des Pian/es, 1779),dans
les iVoiions élémentaires de botanique, par
Durande (1781) ; ce dernier raconte que le
professeur appelait lui même Tattention
de ses auditeurs sur les exceptions qu'il
cherchait sans cesse à ramener à des lois
plus générales, sur les diificultés qu'il travaillait
à aplanir, sur les défauts qu'il ne
cessait de corriger. Ce ne fut qu'après seize
(i) Nous en Jivons (Ifuiné If ratnlot;ue authentique, (l\.près
Us mannsnhs de l'auteur, dims les Ànna'es d(s sciences vttturel/
es (1H37),
ans de ces travaux préparatoires, que sa nouvelle
méthode, mûrie par des méditations
et des observations continuelles, reçut sa
forme et son expression définitives en s'étendant
à tous les végétaux alors connus,
dans un ouvrage foïÈdamental, le Généra
plantarum (1789). Les principes qui l'ont
dirigé sont exposés dans une introduction
aussi remarquable par la logique que par
Télégante clarté, puis discutés dans le cours
du livre toutes les fois qu'ils ont été appliqués
, c'est-à-dire à la suite des articles qui
définissent les classes et les familles. On a
donc toute la pensée de Tauteur et le secret
de ses procédés.
Comme Adanson , il admet que Texamen
de toutes les parties d'une plante est nécessaire
pour la classer ; mais, tout en poursuivant
cet examen complet, il ne cherche
pas à en déduire immédiatement la coordination
des genres, et, pour les grouper en
familles, il suit la marche que ses prédécesseurs
avaient suivie pour la formation
des genres eux-mêmes. Frappés par la ressemblance
complète et constante de certains
individus, ils les avaient réunis en espèce;
puis, d'après une ressemblance également
constante, mais beaucoup moins complète, ils
avaient réuni les espèces en genres. Beaucoup
de genres très naturels leur avaient fourni
autantdemodèles^d'aprèslesquelsilsavaient
appris à apprécier les caractères génériques,
et à constituer d'autres genres moins nettement
dessinés par la nature. Or elle offre
aussi des collections de genres évidemment
plus semblables entre eux qu'ils ne le sont
à ceux de tout autre groupe, ou, en d'autres
termes, des familles incontestablement
naturelles, tellement qu'elles avaient été
reconnues et signalées par la presque universalité
des botanistes, et reproduites soit
entières, soit par grands lambeaux, dans la
plupart des systèmes. Jussieu pensa que la
clef de la méthode naturelle était là , puisqu'en
comparant les caractères d'une de ces
familles à ceux des genres qui les composent
, il obtiendrait la relation des uns aux
a u t r e s , et discernerait les caractères communs
à tous ou ordinaux de ceux qui sont
seulement i/enengues; qu'ensuite en comparant
plusieurs de ces familles entre elles,
il distinguerait parmi ces caractères ordinaux
ceux qui varient de Tune à l'autre;
qu'il arriverait ainsi à l'appréciation de la
valeur de chaque caractère, et que cette
valeur, une fois ainsi déterminée au moyen
de ces groupes si clairement dessinés parla
n a t u r e , pourrait être à son tour appliquée
à la détermination de ceux auxquels elle
n'a pas aussi nettement imprimé ce cachet
de famille et qui étaient les inconnues de
ce grand problème.
11 choisit donc sept familles universellement
admises : celles qu'on connaît sous les
noms de Graminées, Liliacées , l.ahiées ,
Composées , Ombellifères , Crucifères et
Légumineuses. Il reconnut que la structure
de l'embryon est identique dans toutes les
plantes d'une de ces fam'illes; qu'il est monocotylédoné
dans les deux premières, dicotvlédoné
dans les cinq autres; que les
étamines qui peuvent varier par leur nombre
dans une d'elles, les Graminées par
exemple, ne varient pas en général par leur
mode d'insertion sur le torus dans les Graminées
et les Crucifères, sur le calice dans
les Légumineuses et les Liliacées, sur la corolle
dans les Labiées et les Composées, sur
un disque épigynique dans les Ombellifères :
que d'autres caractères, comme Tab^ence du
périsperme et sa présence ainsi que sa nature
, la situation relative du calice et du
p i s t i l , etc., etc., quoique présentant assez
généralement de l'uniformité dans une
même famille, y sont néanmoins sujets à
plus d'exceptions ; qu'enfin il existe un troisième
ordre de caractères tirés soit de ces
mêmes organes essentiels, soit d'autres, et
qui, uniformesdans telle famille, semontrent
variables dans telle autre où ils ne sont plus
bons qu'à définir les genres. Cette appréciation
de leurs valeurs inégales, résultat
pratique deTétude de ces familles indiquées
par la nature même, pouvait d'ailleurs être
présentée directement par la théorie. Le
premier rang doit appartenir à l'embryon ,
dernier but de la végétation et destiné à
conserver la vie de l'espèce; le second aux
organes qui concourent à sa formation, aux
étamines et pistils, mais considérés au point
de vue qui intéresse ce concours, c'est-àdire
dans leur mutuel rapport. Puis viennent
les organes qui protègent, sans le déterminer,
cet acte et son produit, les autres parties
tant de la fleur que du fruit et de la
graine, et les modifications secondaires des
il